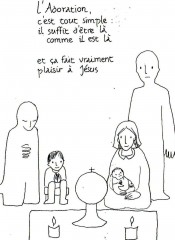Cinquantenaire oblige, les Presses Universitaires de Louvain rééditent « Vatican II et la Belgique », un ouvrage de 336 pages réalisé en 1996 sous la direction de Claude Soetens. Claude Soetens est historien de formation et il enseigne à la Faculté de Théologue de l’U.C.L. (Centre « Lumen Gentium »).
Commentaire de l’hebdomadaire «Le Vif » :
« Rome, printemps 1963. Au Concile Vatican II, commencé quelques mois plus tôt, on aborde enfin les questions essentielles. Beaucoup se rendent compte alors de l’influence sans pareille des évêques et théologiens belges sur le travail conciliaire. Dès mars 1963, le grand dominicain français Yves Congar, expert au Concile, décide de prendre ses quartiers au Collège belge de Rome, où résident les évêques belges. Car c’est là, selon lui, que « se fait pratiquement tout le travail ». Congar quitte sans regret l’Angelicum, l’université dominicaine de la capitale italienne, où l’on se méfie de ses idées réformatrices et où l’on subit le Concile plutôt qu’on ne le vit.
Le Collège belge est un véritable carrefour d’idées. L’ordre du jour du Concile et ses méthodes y sont réorganisés. Des projets de textes et des formules compromis y sont avancés. L’activité belge est à ce point intense que Vatican II a la réputation d’être « le Concile de Louvain qui s’est tenu à Rome ». Impressionnés par l’efficacité de la délégation emmenée par le cardinal Suenens, dont les effectifs correspondent grosso-modo à ceux d’une équipe de football, les journalistes italiens la baptisent, dès l’ouverture de la deuxième session du Concile, la squadra belga.
« Au début des travaux, les Belges ne formaient pas une équipe très soudée, nous confie Claude Soetens, professeur émérite d’histoire de l’Eglise à l’UCL et spécialiste de Vatican II. Lors de leur arrivée à Rome, les évêques belges, très individualistes, n’avaient même pas pensé à se faire accompagner par des théologiens. La collaboration avec les conseillers s’est organisée sur place, petit à petit. Suenens, archevêque de Malines-Bruxelles, était présent lors des quatre sessions plénières, mais le Concile s’est surtout joué pendant les intersessions, hors de Saint-Pierre. C’est ainsi que des textes soumis au vote de l’assemblée ont été concoctés au Collège belge. »
Jean XXIII, le pape qui a convoqué l’ « aggiornamento » de l’Eglise catholique, meurt le 3 juin 1963. Son successeur, Paul VI, nomme Mgr Suenens membre du collège des « modérateurs » chargé de diriger le Concile. L’archevêque belge est dès lors directement impliqué dans la grande stratégie – et les petites chamailleries ! – de Vatican II. « Suenens était bien vu de Paul VI, raconte Claude Soetens. Mais les relations se sont nettement tendues quand le cardinal a cherché à jouer un rôle prépondérant par rapport aux trois autres modérateurs. En outre, Suenens a reproché au pape de s’être réservé personnellement deux dossiers : le célibat des prêtres et la contraception. Ces deux questions sensibles étaient ainsi soustraites à la compétence des pères conciliaires. »
Autre figure marquante de la squadra belga : Mgr Charue, évêque de Namur. Cet exégète a été élu vice-président de la commission doctrinale, la plus importante du Concile. Il est l’un des artisans du texte fondamental qui reconnaît le recours à l’analyse critique et aux méthodes scientifiques pour l’interprétation des textes bibliques. Mgr De Smedt, l’évêque de Bruges, contribue au texte sur le dialogue avec les autres religions (l’ouverture œcuménique). Mais le Belge le plus actif à Rome est un théologien de Louvain, Mgr Gérard Philips, secrétaire adjoint de la commission doctrinale. Ce brillant latiniste participe à la rédaction et à l’adoption des textes centraux du Concile. Au premier rang de ceux-ci figure la constitution Lumen gentium, qui remplace une conception toute hiérarchique de l’Eglise catholique par la notion égalitaire de « peuple de Dieu ».
Tout l’article ici : Vatican II : la squadra belga dévoilée
Ceci n’est donc pas un scoop.
Plus original, en 2005 l’éditeur François-Xavier de Guibert avait publié un intéressant « journal du concile » tenu par le baron Prosper Poswick qui fut, à l’époque (1962-1965), ambassadeur de Belgique auprès du Saint-Siège. Il témoigne aussi, non sans quelques exagérations, du rôle prépondérant joué par des évêques et théologiens belges dans la tournure prise par l'événement conciliaire. Posant aujourd’hui un regard rétrospectif sur ces assises, on peut se demander s’il y avait là matière à se vanter : un arbre se juge à ses fruits et ceux de Vatican II sont plutôt amers. Ses inconditionnels nous disent qu’une meilleure récolte reste encore à venir, lorsque le concile « authentique » aura triomphé du concile « médiatique ». Par une relecture autorisée ? Comme Sœur Anne, on l’attend toujours…