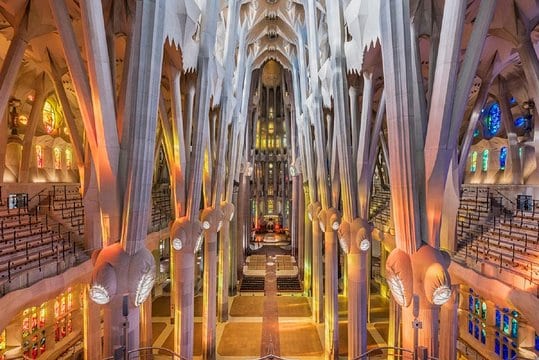Du site des Missions Etrangères de Paris :
Les violences antichrétiennes continuent d’augmenter en Inde malgré la crise, selon Persecution Relief
31/07/2020
Le 28 juillet, l’organisation chrétienne Persecution Relief a publié un nouveau rapport révélant des nouveaux chiffres préoccupants sur la situation de la liberté religieuse en Inde et sur la montée des violences antichrétiennes. Le groupe chrétien, qui vient en aide aux victimes de violences contre la minorité chrétienne et qui recense les attaques enregistrées contre les chrétiens en Inde, explique que « les crimes visant les chrétiens indiens ont augmenté de 40,87 % dans le pays, malgré le confinement instauré le 25 mars ». Entre janvier et juin, le groupe a enregistré 293 cas de violences. La minorité chrétienne indienne représente 2,3 % de la population sur 1,3 milliard d’habitants.

Des catholiques indiens prient dans une église de Delhi, le jour des Rameaux, le 14 avril 2019.
Selon un nouveau rapport de l’organisation Persecution Relief, un groupe chrétien œcuménique qui surveille et enregistre les persécutions contre les minorités chrétiennes en Inde, la situation est « très préoccupante » concernant la liberté religieuse dans le pays, majoritairement hindou. Selon le rapport, publié le 28 juillet, au cours des premiers mois de cette année, six chrétiens ont été assassinés à cause de leur foi en Inde, dont deux femmes qui ont été violées. Le groupe cite également deux femmes chrétiennes et une fille de 10 ans, qui ont également été victimes de viols pour avoir refusé de renier leur foi. « Les crimes visant les minorités chrétiennes en Inde ont augmenté de 40,87 % dans le pays, malgré le confinement instauré depuis le 25 mars », s’inquiète l’organisation dans son nouveau rapport. Entre janvier et juin, l’Inde a enregistré 293 cas de violences contre des chrétiens, dont 5 viols et 6 meurtres. « Les persécutions antichrétiennes sont devenues très courantes », affirme Shibu Thomas, qui a fondé Persecution Relief, qui vient en aide aux chrétiens en détresse, en particulier les proches des victimes de violences. Shibu Thomas ajoute que dans la plupart des cas, les auteurs des attaques sont des nationalistes hindous favorables à la suprématie hindoue en Inde. « Ils s’opposent aux chrétiens et au travail missionnaire. »
« Ce n’est que le haut de l’iceberg »
Depuis que le parti BJP (Bharatiya Janata Party) est arrivé au pouvoir à New Delhi et dans plusieurs États en 2014, il affirme que ces groupes « ont le soutien implicite des institutions au pouvoir dans plusieurs États ». Des crimes antichrétiens ont été rapportés dans au moins 22 des 28 États indiens. Outre les assassinats et les viols, ces attaques comprennent également des menaces et des agressions physiques, des incendies volontaires et des formes d’exclusion sociale. Certains empêchent également les chrétiens d’accéder aux sources communes d’eau potable. « La montée de l’intolérance religieuse contre la petite minorité chrétienne », qui ne représente que 2,3 % de la population indienne sur 1,3 milliard d’habitants, met en évidence le danger de l’idéologie nationaliste hindoue, souligne Shibu Thomas. « Cette croisade effrayante et contagieuse a désormais atteint un niveau inhumain. Les derniers chiffres enregistrés ne sont que le haut de l’iceberg. Nous ne sommes en mesure de rapporter qu’une fraction des violences réellement perpétrées contre les chrétiens dans plusieurs États. » L’État de l’Uttar Pradesh, le plus peuplé du pays, est celui qui a enregistré le plus d’attaques (21 % des crimes enregistrés).
Les autres États les plus concernés sont le Jharkhand, l’Odisha et le Chhattisgarh, où la plupart des chrétiens sont issus des communautés Dalit et indigènes. Les six meurtres enregistrés ces six derniers mois ont eu lieu dans ces États. Ces quatre dernières années, l’Inde a enregistré 1 774 cas de violences, soit une moyenne de 443 par an. Mais en seulement six mois, avec 293 attaques déjà enregistrées, le groupe Persecution Relief indique que la situation s’aggrave. Selon Shibu Thomas, les chiffres de son organisation ne sont pas exhaustifs, le groupe n’étant en mesure de signaler que les cas qui lui sont signalés. « Beaucoup de personnes ne déposent pas de plaintes, par crainte de représailles. Beaucoup de cas isolés dans des villages reculés ne sont pas rapportés non plus en raison du manque d’électricité et de réseau », explique-t-il. Le rapport indique que sur plus de sept ans, l’Inde est passée du 31e rang à la dixième place du classement de l’ONG évangélique américaine Open Doors, qui publie chaque année un index des 50 pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Selon l’index 2020, l’Inde, classée 10e, est juste derrière l’Iran. Selon le rapport 2020 de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale, l’Inde est classée au même rang que des pays comme la Chine ou la Corée du Nord en termes de liberté religieuse.
(Avec Ucanews, New Delhi)