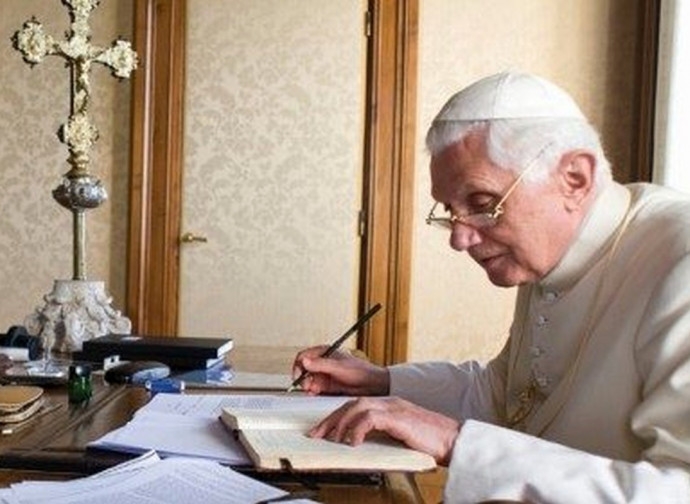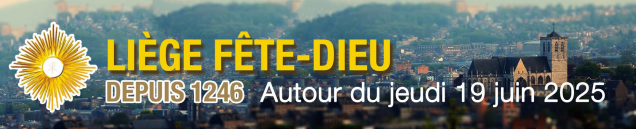Chers frères et sœurs,
Dans la première lecture, nous avons entendu ces paroles : « Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : “Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. […] Quand il établissait les cieux, j’étais là; […] Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes” » (Pr 8,22.27.30-31). Pour saint Augustin, la Trinité et la sagesse sont intimement liées. La sagesse divine est révélée dans la Très Sainte Trinité, et la sagesse nous conduit toujours à la vérité.
Et aujourd’hui, alors que nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité, nous vivons les journées du Jubilé du Sport. Le binôme Trinité-sport n’est pas vraiment courant, et pourtant cette association n’est pas déplacée. En effet, toute bonne activité humaine porte en elle un reflet de la beauté de Dieu, et le sport en fait certainement partie. D’ailleurs, Dieu n’est pas statique, il n’est pas fermé sur lui-même. Il est communion, relation vivante entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui s’ouvre à l’humanité et au monde. La théologie appelle cette réalité périchorèse, c’est-à-dire “danse” : une danse d’amour réciproque.
C’est de ce dynamisme divin que jaillit la vie. Nous avons été créés par un Dieu qui se réjouit et se complaît à donner l’existence à ses créatures, qui « “joue”, comme nous l’a rappelé la première lecture (cf. Pr 8, 30-31). Certains Pères de l’Église parlent même, hardiment, d’un Deus ludens, d’un Dieu qui se divertit (cf. S. Salonius de Genève, In Parabolas Salomonis expositio mystica ; S. Grégoire de Nazianze, Carmina, I, 2, 589). C’est pourquoi le sport peut nous aider à rencontrer Dieu Trinité : parce qu’il exige un mouvement de soi vers l’autre, certes extérieur, mais aussi et surtout intérieur. Sans cela, il se réduit à une stérile compétition d’égoïsmes.
Pensons à une expression couramment utilisée en italien pour encourager les athlètes pendant les compétitions : les spectateurs crient « Dai ! » (Allez !). Nous n'y prêtons peut-être pas attention, mais c’est un impératif magnifique : c’est l’impératif du verbe “dare” (donner). Et cela peut nous faire réfléchir : il ne s’agit pas seulement de donner une performance physique, même extraordinaire, mais de se donner soi-même, de “se mettre en jeu”. Il s’agit de se donner pour les autres – pour leur croissance, pour les supporters, pour les proches, pour les entraîneurs, pour les collaborateurs, pour le public, même pour les adversaires – et, si l’on est vraiment sportif, cela vaut au-delà du résultat. Saint Jean-Paul II – un sportif, comme nous le savons – en parlait ainsi : « Le sport est joie de vivre, jeu, fête, et comme tel, il doit être valorisé [...] par la redécouverte de sa gratuité, de sa capacité à créer des liens d’amitié, à favoriser le dialogue et l’ouverture des uns vers les autres, [...] au-delà des lois dures de la production et de la consommation et de toute autre considération purement utilitaire et hédoniste de la vie » (Homélie pour le Jubilé des sportifs, 12 avril 1984).
Dans cette optique, mentionnons en particulier trois aspects qui font aujourd’hui du sport un moyen précieux de formation humaine et chrétienne.
Premièrement, dans une société marquée par la solitude, où l’individualisme exacerbé a déplacé le centre de gravité du “nous” vers le “je”, finissant par ignorer l’autre, le sport – surtout lorsqu’il s’agit d’un sport d’équipe – enseigne la valeur de la collaboration, du cheminement commun, de ce partage qui, comme nous l’avons dit, est au cœur même de la vie de Dieu (cf. Jn 16, 14-15). Il peut ainsi devenir un instrument important de recomposition et de rencontre : entre les peuples, dans les communautés, dans les milieux scolaires et professionnels, dans les familles !
Deuxièmement, dans une société de plus en plus numérique, où les technologies, tout en rapprochant les personnes éloignées, éloignent souvent celles qui sont proches, le sport valorise le caractère concret du vivre ensemble, le sens du corps, de l’espace, de l’effort, du temps réel. Ainsi, contre la tentation de fuir dans des mondes virtuels, il aide à maintenir un contact sain avec la nature et avec la vie concrète, lieu seul où s’exerce l’amour (cf. 1 Jn 3, 18).
Troisièmement, dans une société compétitive où il semble que seuls les forts et les gagnants méritent de vivre, le sport enseigne aussi à perdre, en confrontant l’homme, dans l’art de la défaite, à l’une des vérités les plus profondes de sa condition : la fragilité, la limite, l’imperfection. Cela est important, car c’est à partir de l’expérience de cette fragilité que l’on s’ouvre à l’espérance. L’athlète qui ne se trompe jamais, qui ne perd jamais, n’existe pas. Les champions ne sont pas des machines infaillibles, mais des hommes et des femmes qui, même lorsqu’ils tombent, trouvent le courage de se relever. Rappelons-nous encore une fois, à ce propos, les paroles de saint Jean-Paul II, qui disait que Jésus est « le véritable athlète de Dieu », parce qu’il a vaincu le monde non par la force, mais par la fidélité de son amour (cf. Homélie lors de la messe pour le Jubilé des sportifs, 29 octobre 2000).
Ce n’est pas un hasard si, dans la vie de nombreux saints de notre temps, le sport a joué un rôle important, soit comme pratique personnelle, soit comme moyen d’évangélisation. Pensons au bienheureux Pier Giorgio Frassati, patron des sportifs, qui sera proclamé saint le 7 septembre prochain. Sa vie, simple et lumineuse, nous rappelle que, tout comme personne ne naît champion, personne ne naît saint. C’est l’entraînement quotidien à l’amour qui nous rapproche de la victoire définitive (cf. Rm 5, 3-5) et qui nous rend capables d’œuvrer à l’édification d’un monde nouveau. Saint Paul VI l’affirmait également, vingt ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en rappelant aux membres d’une association sportive catholique combien le sport avait contribué à ramener la paix et l’espérance dans une société bouleversée par les conséquences de la guerre (cf. Discours aux membres du C.S.I., 20 mars 1965). Il disait : « C’est à la formation d’une société nouvelle que tendent vos efforts : [...] dans la conscience que le sport, dans les éléments formateurs sains qu’il met en valeur, peut être un instrument très utile pour l’élévation spirituelle de la personne humaine, condition première et indispensable d’une société ordonnée, sereine et constructive » (ibid.).
Chers sportifs, l’Église vous confie une très belle mission : être, dans vos activités, un reflet de l’amour de Dieu Trinité pour votre bien et celui de vos frères. Laissez-vous impliquer dans cette mission avec enthousiasme : en tant qu’athlètes, formateurs, société, groupes, familles. Le pape François aimait souligner que Marie, dans l’Évangile, nous apparaît active, en mouvement, jusqu’à “courir” (cf. Lc 1, 39), prête, comme savent le faire les mères, à partir au moindre signe de Dieu pour venir en aide à ses enfants (cf. Discours aux volontaires des JMJ, 6 août 2023). Demandons lui d’accompagner nos efforts et nos élans, et de toujours les orienter vers le meilleur, jusqu’à la plus grande victoire : celle de l’éternité, le “champ infini” où le jeu n’aura plus de fin et où la joie sera complète (cf. 1 Co 9, 24-25 ; 2 Tm 4, 7-8).