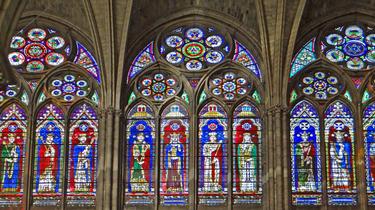L'avant-dernière émission "Affaires étrangères" de Christine Ockrent sur France Culture consacrée aux "affres du Vatican" (toujours "podcastable" sur https://www.franceculture.fr/
Monsieur Moneghetti,
Le présent courrier a pour objet l'émission Affaires étrangères de Christine Ockrent, sur France Culture du 13 avril dernier, intitulée "Les affres du Vatican".
L'orientation unilatérale de cette émission et de ses invités a choqué non seulement le catholique que je suis, ce qui ne serait pas bien grave (nous avons l'habitude!), mais aussi le journaliste professionnel que j'ai été pendant une longue carrière qui vient juste de s'achever. Pas un seul intervenant qui représente l'institution ecclésiale ou qui défende sa cause, est-ce comme cela qu'on "nous raconte le monde", un monde où "rien ne peut nous rester étranger" (cfr la présentation générale d'Affaires étrangères) ?
S'il s'agissait seulement d'opinions, je ne viendrais pas vous déranger. Mais il est des contre-vérités tellement flagrantes, qu'elles aient été proférées consciemment ou non, qu'on ne peut les laisser sans réponse. Je ne vais pas les relever toutes, ce serait trop long, alors je le suis déjà assez (désolé). Pour m'en tenir à trois points:
1) Il a été dit à vos auditeurs, dans une belle unanimité, que l'Eglise est, depuis le XIXè siècle, "obsédée par la sexualité" et qu'elle en a même fait un mode de contrôle de ses fidèles. Qu'il y ait en la matière un enseignement et un idéal exigeants, qui ne plaisent pas à tout le monde dans nos sociétés occidentales libertaires avancées, c'est indéniable. Que des excès de puritanisme aient pu se développer à la base, c'est aussi indéniable. Mais parler d'obsession, c'est être tout simplement ignorant, totalement "étranger" (justement) au monde catholique. Le Credo que répètent les croyants pratiquants à chaque célébration ne contient pas une ligne sur ces sujets. Dans le Catéchisme de l'Eglise catholique (édition 1992, supervisé par Jean-Paul II et le futur Benoît XVI), les questions touchant à l'amour humain, à la famille, à la fidélité dans le mariage, au respect de la vie humaine, aux vocations à la chasteté... représentent 51 pages sur 581 (pp. 341-353 et 450-487). Soit 8,8 % pour ceux qui aiment les statistiques. Le moins qu'on puisse dire de cette prétendue "obsession" est qu'elle n'est guère envahissante. Sur les quatorze encycliques publiées par Jean-Paul II, deux concernent l'enseignement moral et la valeur de la vie humaine. Les douze autres ont trait à l'enseignement social de l'Eglise, à la miséricorde, à l'Esprit Saint, à l'oecuménisme... Benoît XVI a publié pour sa part deux encycliques essentiellement sociales et une sur l'espérance. Et des deux encycliques de François, une est consacrée à la foi chrétienne et l'autre à l'écologie.
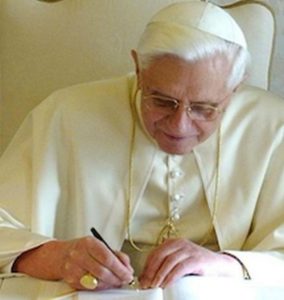
 De nombreux évêques et responsables religieux à travers l’Asie ont envoyé leurs condoléances au Sri Lanka suite aux attaques terroristes du dimanche 21 avril, qui entraîné au moins 359 victimes le jour de Pâques. Au Pakistan, où les chrétiens ont subi de nombreux attentats similaires dans le passé, le Centre d’aide juridique (CLAAS), une organisation qui propose un accompagnement juridique aux chrétiens face aux persécutions, a organisé une marche contre le terrorisme le 22 avril. « Nous sommes prêts à faire tout notre possible pour aider le gouvernement sri-lankais. Ces attentats menacent la paix mondiale. Les dirigeants de tous les pays doivent oublier leurs différences pour s’unir contre le terrorisme », a déclaré Joseph Francis, le directeur national de CLAAS. Le Forum pour les droits des minorités, une ONG catholique au Pakistan, a organisé une veillée aux chandelles en hommage aux victimes, devant le Club de la presse de Lahore. Le père Saleh Diego, directeur de la Commission nationale pour la Justice et la Paix (NCJP) au Pakistan, a confié que le Sri Lanka, un pays en apparence paisible, avait souffert du fanatisme des terroristes et de leur haine de la paix et du christianisme. Dans un communiqué commun, Mgr Joseph Arshad (président du NCJP), le père Emmanuel Yousaf (directeur national) et Cecil Shane Chaudhry (directrice générale) ont souligné que les attentats mettent en évidence la montée de l’extrémisme et de la radicalisation à travers le monde. « Toute la communauté chrétienne au Pakistan est profondément attristée par ces actes atroces. Nous prions pour les âmes des défunts, et nous demandons au Seigneur de soutenir les blessés et les familles endeuillées. Que les coupables de ces attentats soient poursuivis en justice », a déclaré Mgr Arshad. Le père Shahzad Arshad, cure de la paroisse Saint-Michel de Karachi, confie avoir fait part de la solidarité de l’Église du Pakistan à ses amis sri-lankais. Il assure que toute la communauté chrétienne pakistanaise est aux côtés des victimes.
De nombreux évêques et responsables religieux à travers l’Asie ont envoyé leurs condoléances au Sri Lanka suite aux attaques terroristes du dimanche 21 avril, qui entraîné au moins 359 victimes le jour de Pâques. Au Pakistan, où les chrétiens ont subi de nombreux attentats similaires dans le passé, le Centre d’aide juridique (CLAAS), une organisation qui propose un accompagnement juridique aux chrétiens face aux persécutions, a organisé une marche contre le terrorisme le 22 avril. « Nous sommes prêts à faire tout notre possible pour aider le gouvernement sri-lankais. Ces attentats menacent la paix mondiale. Les dirigeants de tous les pays doivent oublier leurs différences pour s’unir contre le terrorisme », a déclaré Joseph Francis, le directeur national de CLAAS. Le Forum pour les droits des minorités, une ONG catholique au Pakistan, a organisé une veillée aux chandelles en hommage aux victimes, devant le Club de la presse de Lahore. Le père Saleh Diego, directeur de la Commission nationale pour la Justice et la Paix (NCJP) au Pakistan, a confié que le Sri Lanka, un pays en apparence paisible, avait souffert du fanatisme des terroristes et de leur haine de la paix et du christianisme. Dans un communiqué commun, Mgr Joseph Arshad (président du NCJP), le père Emmanuel Yousaf (directeur national) et Cecil Shane Chaudhry (directrice générale) ont souligné que les attentats mettent en évidence la montée de l’extrémisme et de la radicalisation à travers le monde. « Toute la communauté chrétienne au Pakistan est profondément attristée par ces actes atroces. Nous prions pour les âmes des défunts, et nous demandons au Seigneur de soutenir les blessés et les familles endeuillées. Que les coupables de ces attentats soient poursuivis en justice », a déclaré Mgr Arshad. Le père Shahzad Arshad, cure de la paroisse Saint-Michel de Karachi, confie avoir fait part de la solidarité de l’Église du Pakistan à ses amis sri-lankais. Il assure que toute la communauté chrétienne pakistanaise est aux côtés des victimes.