Ne pas oublier d'activer le son
BELGICATHO - Page 564
-
Quand l'Europe se renie elle-même...
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Europe, International, Islam, islamisme, Persécutions antichrétiennes, Politique, Témoignages 0 commentaire -
Le grand retour de la Fête-Dieu à Liège du 12 au 19 juin 2022
"La Fête-Dieu, fête du Corps et du Sang du Christ, est liée à la ville de Liège depuis plus de 770 ans. C’est en effet en 1246 qu’elle fut célébrée pour la première fois à Liège, après que l’évêque Robert de Thourotte ait reconnu les visions de Julienne de Cornillon dans lesquelles elle voyait une lune échancrée, rayonnante mais incomplète, qui représentait l’hostie. Cette fête solennelle en l’honneur du Saint-Sacrement fut instituée dans l’Eglise universelle en 1264." (voir ici le communiqué du diocèse)
"Du 12 au 19 juin prochains, après deux ans de limitations à cause de l’épidémie du coronavirus, les célébrations à l’occasion de la Fête-Dieu auront bien lieu cette année; et ce, avec un programme complet et varié qui est disponible en ligne sur: www.liegefetedieu.be"
L'église du Saint-Sacrement au Boulevard d'Avroy 132 (face à la statue équestre de Charlemagne) est l'un des lieux où cette fête du "Corpus Christi" est mise particulièrement en lumière:
Liège
EGLISE DU SAINT-SACREMENT
Boulevard d’Avroy, 132 à Liège
Nota bene:
le concert d'ouverture du 12 juin aura lieu à 17h00 (au lieu de 16h00)
et le vernissage subséquent de l'exposition "Fête-Dieu, mémoire de Liège: souvenirs et traditions", à 18h00.
Autres renseignements : Tel. 04 344 10 89 ou Email : sursumcorda@skynet.be
-
Le Grand Séminaire francophone de Belgique (Namur) a la joie d’annoncer plusieurs ordinations
Le Grand Séminaire francophone de Belgique (Namur) a la joie d’annoncer plusieurs ordinations. Tous les ordinands mentionnés ci-après ont suivi leur formation sacerdotale à Namur:
-Fr. Faustin, moine trappiste de Scourmont (Chimay) sera ordonné prêtre le samedi 14 mai à 11h en son abbaye par Mgr G. Harpigny, évêque de Tournai
-M. Marc GIRAUD sera ordonné prêtre le dimanche 19 juin à 15h en la Cathédrale Ss-Michel-et-Gudule à Bruxelles, par le Cardinal J. De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles
-M. Boris HOUENGNISSOU sera ordonné prêtre le dimanche 26 juin à 15h en la Cathédrale St-Aubain à Namur, par Mgr P. Warin, évêque de Namur
-M. Allan AZOFEIFA, membre du Chemin Néo-Catéchuménat, sera ordonné prêtre le dimanche 26 juin à Arras par Mgr O. Leborgne, pour ce même diocèse.
-M. Guillaume GIROUL sera ordonné prêtre le dimanche 3 juillet à 15h en la Cathédrale St-Paul à Liège, par Mgr J.-P. Delville, évêque de Liège
-Fr. Luc et Fr. Jean-Baptiste, moines bénédictins de Maredsous/Gihindamuyaga seront ordonnés respectivement diacre et prêtre le samedi 16 juillet en leur abbaye au Rwanda.
Avec action de grâce, portons ces ordinands dans la prière. Invitation cordiale à tous.
-
Le Parlement Européen adopte une résolution dénonçant l'imminente décision de la Cour Suprême des Etats-Unis sur l'avortement
Un vote qui en dit long sur ce que sont devenues les "valeurs européennes"...
De gènéthique.org :
L’imminente décision de la Cour Suprême américaine sur l’avortement préoccupe le Parlement européen
9 juin 2022Suite aux controverses autour de l’avortement aux Etats-Unis (cf. Etats-Unis : vers la fin du « droit à l’avortement » ?) et en attendant la décision de la Cour Suprême sur l’arrêt Roe Vs Wade de 1973 (cf. Avortement : l’arrêt Roe v/ Wade controversé), le Parlement européen a convoqué un débat. La plénière du 8 juin 2022 a été l’occasion de discussions sur les « Menaces Contre le Droit à l’Avortement dans le Monde : l’éventuelle remise en cause du droit à l’avortement aux États-Unis par la Cour suprême »(cf. Avortement aux Etats-Unis : la COMECE dénonce l’« ingérence inacceptable » de l’Europe).
La nouvelle ministre française à l’égalité femmes-hommes, Isabelle Rome, a rappelé le projet de la Présidence Française de l’UE en matière de droit des femmes : développer l’accès à l’avortement et l’inscrire comme “droit” dans la Charte des droits fondamentaux, à l’instar de ce qu’avait annoncé Emmanuel Macon le 19 janvier 2022 (cf. PFUE : l’avortement, une “valeur” de l’Europe ?). La Commission européenne a renchéri en apportant son soutien aux droits des femmes à avoir accès aux “soins reproductifs et sexuels” partout dans le monde, conformément aux partenariats bilatéraux de l’UE.
L’adoption d’une résolution
Le député Predrag Fred Matic (S&D, cf. Le Parlement européen adopte le rapport Matic) et 30 autres parlementaires ont déposé un projet de résolution qui abonde dans le sens du Conseil et de la Commission. Cette résolution vise notamment à soutenir le gouvernement Biden aux Etats-Unis dans sa promotion de l’avortement. Elle invite aussi « l’UE et ses Etats membres à inscrire le droit à l’avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » (Point numéro 24 de la résolution). Elle « demande instamment à la Commission de faire pleinement usage de ses compétences en matière de politique de santé ainsi que d’aider les Etats membres à garantir l’accès universel à la santé et aux droits sexuels et génésiques dans le cadre du programme “L’UE pour la santé” pour la période 2021-2027 » (Point 31 de la résolution).
Les députés européens de Renew (centristes), S&D (Gauche) et The Left (extrême gauche) s’y sont montrés favorables. Le groupe PPE (droite) était divisé. Quant aux députés conservateurs (ECR et ID), ils ont remis en question l’ingérence des institutions européennes dans cette décision de la Cour suprême américaine. Ils ont rappelé que l’enjeu de l’avortement est une compétence exclusive de chaque Etat membre. Ainsi, l’UE a encore moins de légitimité pour s’immiscer dans les affaires des Etats-Unis.
Les intentions de vote se sont concrétisées ce jeudi 9 juin par l’adoption de la résolution, avec 364 voix pour, 154 voix contre et 37 abstentions.
Si une résolution n’a pas de force contraignante mais uniquement une influence politique, ces évènements récents démontrent que la ligne idéologique de certains responsables politiques de l’UE contribue à l’émergence institutionnelle d’un « droit fondamental à l’avortement ».
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Ethique, Europe, International, Politique 0 commentaire -
Le pape n'aime ni la dentelle ni les homélies de plus de huit minutes
De Loup Besmond de Senneville (à Rome), sur le site du journal la Croix :
La charge du pape contre « la dentelle » à la messe
Au cours d’une audience avec des prêtres et des évêques de Sicile, jeudi 9 juin, le pape François s’est inquiété de la mise en œuvre du concile Vatican II dans l’île italienne.
9/06/2022
« Je parle franchement. » Devant des prêtres et des évêques de Sicile, le pape François a effectivement fait preuve, jeudi 9 juin, d’une franchise certaine. « Chers amis, il y a toujours de la dentelle, des barrettes… Mais où sommes-nous ? Soixante ans après le concile ! », a affirmé le pape. François a ainsi assuré au cours de cette audience être « préoccupé » par la mise en application sur l’île italienne des réformes initiées par Vatican II.
« Je ne vais pas à la messe là-bas, mais j’ai vu des photos », a expliqué François, en commentant les ornements liturgiques utilisés par certains prêtres. « Oui, parfois, on peut porter un peu de la dentelle de la grand-mère, mais parfois uniquement. Et c’est pour rendre hommage à sa grand-mère, non ? Vous avez tout compris, n’est-ce pas ? », a lancé le pape. Avant de poursuivre : « C’est bien de rendre hommage à sa grand-mère, mais il est préférable de célébrer la mère, la sainte mère Église, et la façon dont notre mère l’Église veut être célébrée. »
Libérer la « piété populaire »
Le pape, qui s’est inquiété que « l’insularité » empêche une « véritable réforme liturgique », a aussi encouragé les prêtres à libérer la « piété populaire » de « tous les gestes superstitieux ».« La piété populaire est une grande richesse et nous devons la garder, l’accompagner pour qu’elle ne se perde pas, a souhaité François. Il faut aussi l’éduquer. »
Comme il le fait régulièrement, le pape a aussi encouragé les prêtres à éviter « les sermons qui parlent de tout et de rien » et qui durent plus de huit minutes. « Gardez à l’esprit qu’après huit minutes l’attention diminue et que les gens veulent du concret », a-t-il insisté.
« Je ne sais pas comment les prêtres siciliens prêchent, s’ils prêchent comme il est suggéré dans Evangelii gaudium, a lancé François en faisant allusion à son texte programmatique, ou s’ils prêchent de telle manière que les gens sortent pour fumer une cigarette et reviennent ensuite… » Ces propos du pape sont dans la droite ligne de ceux déjà tenus par le passé, François s’agaçant régulièrement de certaines formes de liturgie, rattachant en particulier la forme préconciliaire de la messe à un passé révolu, ou en passe de l’être.
-
Le plus vieil homme du monde a 113 ans et prie le chapelet deux fois par jour
De Francesca Pollio Fenton sur Catholic News Agency :
Le plus vieil homme du monde a 113 ans et prie le chapelet deux fois par jour
Vicente Pérez, 112 ans, agriculteur vénézuélien, fait un geste chez lui à San Jose de Bolivar, dans l'État de Tachira, au Venezuela, le 24 janvier 2022. Le Guinness World Records a officiellement reconnu Pérez comme l'homme vivant le plus âgé suite au décès d'un Espagnol qui était le précédent détenteur du titre.
8 juin 2022Il s'appelle Juan Vicente Pérez Mora, il est vénézuélien, passionné par sa foi, il prie le chapelet deux fois par jour et il figure dans le Guinness World Records comme l'homme le plus âgé du monde.
Mora est né le 27 mai 1909 et cette année il a eu 113 ans.
Dans un article publié le 17 mai sur le site web du Guinness World Records, Mora a déclaré que son secret pour vivre longtemps est de "travailler dur, se reposer pendant les vacances, se coucher tôt, boire un verre d'aguardiente (une liqueur forte à base de canne à sucre) tous les jours, aimer Dieu et le porter toujours dans son cœur".
Il affirme que sa famille et ses amis sont ses plus grands compagnons de vie et que la plus grande chose qu'il a apprise dans la vie est "l'amour de Dieu, l'amour de la famille, et qu'il faut se lever tôt pour travailler."
Mora était le neuvième des dix enfants nés de Eutiquio del Rosario Pérez Mora et Edelmira Mora. En 1914, ils ont déménagé à Los Pajuiles, un village de San José de Bolivar. À l'âge de 5 ans, Mora a commencé à travailler avec son père et ses frères et sœurs dans l'agriculture, plus précisément dans la récolte du café et de la canne à sucre.
À 10 ans, il a commencé à aller à l'école mais n'a pu y aller que pendant cinq mois car son professeur est tombé très malade. Cependant, Mora a pu apprendre à lire et à écrire grâce à un livre que son professeur lui avait donné avant que sa santé ne décline.
Mora a également été shérif à Caricuena de 1948 à 1958. Il a été marié à Ediofina del Rosario García pendant 60 ans. Elle est décédée en 1997. Le couple a eu six fils et cinq filles. La famille s'est agrandie et compte aujourd'hui 41 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants et 12 arrière-arrière-petits-enfants.
Au sein de sa famille, M. Mora est connu pour sa foi. Il s'efforce de construire une relation solide avec Dieu, ses proches, et il prie le chapelet deux fois par jour. "Mon oncle Vicente transmet beaucoup de paix, de tranquillité et rayonne de beaucoup de joie", a déclaré son neveu Freddy Abreu à l'agence sœur hispanophone de CNA, ACI Prensa. "C'est une personne qui a beaucoup à donner. Il apprécie les choses simples de la vie et est très reconnaissant envers Dieu."
La personne la plus âgée du monde, et la femme la plus âgée du monde, est la religieuse française Sœur André Randon, née le 11 février 1904. Elle est âgée de 118 ans. Elle est devenue la personne la plus âgée du monde cette année lorsque Kane Tanaka, née le 2 janvier 1903, est décédée le 19 avril 2022.
-
Quand le pape dénonce le mythe de l’éternelle jeunesse
Du pape François lors de l'audience du 8 juin (source) :
Notre époque et notre culture, qui révèlent une tendance inquiétante à considérer la naissance d’un enfant comme une simple question de production et de reproduction biologique de l’être humain, cultivent ensuite le mythe de l’éternelle jeunesse comme l’obsession – désespérée – d’une chair incorruptible. Pourquoi la vieillesse est-elle – à bien des égards – dépréciée ? Parce qu’elle porte la preuve irréfutable qui récuse ce mythe, qui voudrait nous faire retourner dans le ventre de la mère, pour être éternellement jeunes de corps.
La technique se laisse allécher par ce mythe à tous égards : en attendant de vaincre la mort, nous pouvons maintenir le corps en vie grâce aux médicaments et aux cosmétiques, qui ralentissent, cachent, annulent la vieillesse. Bien sûr, une chose est le bien-être, une autre est l’alimentation des mythes. Il est cependant indéniable que la confusion entre les deux nous cause une certaine confusion mentale. Confondre le bien-être avec l’alimentation du mythe de l’éternelle jeunesse. On en fait tant pour retrouver cette jeunesse : tant de maquillages, tant de chirurgies pour paraître jeunes. Je me souviens des paroles d’une sage actrice italienne, Magnani, lorsqu’on lui a dit qu’il lui fallait enlever les rides et qu’elle répondit : « Non, ne les touchez pas ! Il a fallu tant d’années pour les obtenir : ne les touchez pas ! ». C’est ainsi : les rides sont un symbole d’expérience, un symbole de la vie, un symbole de la maturité, un symbole du chemin parcouru. Ne les touchez pas pour devenir jeunes, mais jeunes de visage : ce qui compte, c’est toute la personnalité, ce qui compte, c’est le cœur, et le cœur reste avec cette jeunesse du bon vin, qui plus il vieillit, plus se bonifie.
La vie dans la chair mortelle est une très belle chose « inachevée » : comme certaines œuvres d’art qui, précisément dans leur incomplétude, ont un charme unique. Parce que la vie ici-bas est une « initiation », pas un accomplissement : nous venons au monde comme ça, en tant que personnes réelles, comme des personnes qui avancent en âge, mais restent toujours authentiques. Mais la vie dans la chair mortelle est un espace et un temps trop fugaces pour garder intacte et mener à son terme la partie la plus précieuse de notre existence dans le temps du monde.
-
"Il n'y a légitimement qu'un seul pape et il s'appelle François"
De Kath.Net/News :
"Il n'y a légitimement qu'un seul pape et il s'appelle François".
8 juin 2022
"La démission du pape Benoît a introduit dans le principe pétrinien de l'unité de la foi et de la communion de l'Église une tension qui n'a pas de parallèle dans l'histoire". Par Gerhard Card. Müller
Vatican (kath.net) : Kath.net met en ligne les paroles du cardinal Gerhard Müller, préfet émérite de la Congrégation pour la doctrine de la foi, à l'occasion de la présentation du livre "Benedetto XVI nove anni di papato-ombra" (Benoît XVI : neuf ans de papauté fantôme) de Massimo Franco (Milano 2022). Franco est un journaliste et auteur italien renommé, il écrit pour le Corriere della Sera et des médias internationaux tels que le Guardian britannique. Kath.net remercie S.E. le cardinal Müller de l'aimable autorisation de publier ses propos sur la présentation du livre.
Personne ne pourra dévaloriser le nouveau livre de Massimo Franco comme un petit opuscule, comme cela est arrivé à Dario Viganò, alors préfet du dicastère du Vatican pour la communication, quand il a fait croire à l'approbation de Benoît XVI pour un panégyrique du "Nouveau Paradigme" de son successeur, auquel les médias ont donné l'aura du "grand réformateur" (p. 91).
Nous avons plutôt affaire à un véritable livre de fond, qui ne fait pas la promotion d'une personne à des fins de propagande, mais qui se consacre au problème non résolu sur le plan théologique, sociologique et psychologique de la coexistence de deux papes dans l'Église catholique.
Le fait que l'auteur m'ait justement demandé de participer à la présentation de son livre, remarquablement documenté, avec une connaissance détaillée des événements dramatiques des neuf dernières années, m'honore certes, mais m'expose aussi à un certain risque d'être mal compris de deux côtés. Après tout, c'est de ma position entre les foyers ecclésiaux de "Santa Marta" et du "Monasterium Mater ecclesiae" qu'il est le plus question dans ce livre de 250 pages. En effet, je rentre parfaitement dans le schéma narratif, dans la mesure où j'ai été nommé préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi par le pape Ratzinger et brusquement révoqué par papa François après le premier mandat de cinq ans qui s'est achevé. Depuis lors, selon la logique des jeux de pouvoir politiques, je suis soit considéré comme le chef de l'opposition à l'un, soit comme le dernier refuge de l'orthodoxie dans le sens de l'autre, ou encore on tente de m'instrumentaliser.
Mais le lien effectif et affectif de chaque évêque avec le pape ne doit pas être confondu avec la servilité calculée des cours princières. La franchise apostolique avec laquelle Paul s'est jadis opposé au co-apôtre Pierre au sujet de la "vérité de l'Évangile" (Ga 2,14) n'a pas fait de Paul un négateur de la primauté pétrinienne ni empêché Pierre de corriger humblement son attitude peu claire. On sait que c'est ainsi que saint Augustin (ép. 82) a interprété, dans un échange avec saint Jérôme, le fameux passage de l'épître aux Galates. (Cf. Johann Adam Möhler, Hieronymus und Augustinus im Streit über Gal. 2, 14 : ders, Gesammelte Schriften und Aufsätze I, hg. v. Ign. Döllinger, Regensburg 1839, 1-18).
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Doctrine, Eglise, Foi, Histoire, Livres - Publications, Spiritualité 1 commentaire -
L'agression et le massacre de la Pentecôte au Nigeria sont le fait d'un groupe bien organisé et bien entraîné
Une dépêche de l'Agence Fides :
AFRIQUE/NIGERIA - "Agression commise par un groupe bien organisé. Le nombre de victimes est probablement plus élevé que le nombre officiel"
8 juin 2022
Abuja (Agence Fides) - " Ceux qui ont commis le massacre du 5 juin dans l'église Saint-François-Xavier d'Owo sont un groupe bien organisé et bien entraîné ", ont déclaré à l'Agence Fides des sources de l'Église au Nigeria qui, pour des raisons de sécurité, ont requis l'anonymat.
"Les assaillants sont arrivés à la fin de la messe de Pentecôte, se mêlant aux fidèles qui quittaient le lieu de culte. Ils se sont divisés en petits groupes qui ont commencé à faire détoner des engins explosifs et à tirer sur les fidèles à l'intérieur et à l'extérieur de l'église, ce qui dénote une maîtrise des armes et des tactiques de guérilla", expliquent les sources de Fides. "Le bilan officiel de 22 morts communiqué par les autorités doit être revu à la hausse", ajoutent-ils. "Probablement une cinquantaine de personnes ont été tuées sur place, auxquelles il faut ajouter celles qui ont succombé plus tard à leurs blessures". Le caractère dramatique des conditions et du nombre de blessés est indirectement attesté par les différents appels au don de sang lancés par les autorités sanitaires immédiatement après le massacre.
"Nous sommes vraiment inquiets parce que le massacre a été commis dans un État comme l'Ondo, dans le sud-ouest, qui a jusqu'à présent été épargné par la violence qui sévit dans d'autres régions du Nigeria", soulignent nos sources.
"Les communautés chrétiennes et les catholiques en particulier se sentent menacés. A présent, il ne se passe pas une semaine sans qu'un prêtre catholique ne soit kidnappé. Même la veille du massacre du 5 juin, un autre avait été enlevé, dans un État voisin ", rappellent les sources en faisant référence à l'enlèvement, le samedi 4 juin, du père Christopher Itopa Onotu, pasteur de l'église de Notre-Dame du Perpétuel Secours, à Obangede, dans la zone de gouvernement local d'Okehi, dans l'État de Kogi, limitrophe de celui d'Ondo (voir Fides 7/6/2022). "Ce qui plonge la population nigériane dans le désespoir, c'est que la plupart des meurtriers et des kidnappeurs n'ont pas été traduits en justice. Et cela génère une méfiance envers l'État et la tentation de se protéger soi-même", concluent nos sources.
La tension monte au Nigeria alors que la campagne pour les élections présidentielles de février 2023 est désormais lancée.
(L.M.) (Agence Fides 8/6/2022)
Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, International, Persécutions antichrétiennes, Politique 0 commentaire -
Six prêtres seront prochainemengt ordonnés en Belgique
De Geert De Kerpel sur KerkNet :
Quatre ordinations sacerdotales début juillet dans la cathédrale de Malines
8 juin 2022
Le 10 juillet, le cardinal Jozef De Kesel ordonnera Geert Narinx, Anthony Jude Okafor, Kevin Pluym et Jan Van Achter comme prêtres pour l'archidiocèse.
Geert Narinx (°1992) est né à Geistingen (Kinrooi). En 2012, il a commencé ses études sacerdotales au séminaire Jean XXIII de Louvain. Après le cycle théologique, il prend un congé sabbatique pour approfondir sa connaissance de la spiritualité de saint Philippe Neri et se consacre au projet de l'oratoire en construction à Scherpenheuvel. Il obtient un baccalauréat en théologie et suit une formation d'enseignant en cours du soir. En 2019, il a été accepté comme candidat-prêtre pour l'archidiocèse et nommé collaborateur du CCV pour le vicariat du Brabant flamand et de Malines et membre de l'équipe pour la région pastorale de Tirlemont. Il a été ordonné diacre le 29 mai 2021.
Anthony Jude Okafor (°1984) a grandi à Enugu, au Nigeria. Après son baccalauréat en philosophie, il est venu en Belgique en 2013 pour un master en anthropologie sociale et culturelle (KU Leuven). De 2015 à 2016, il a suivi des cours de langue en néerlandais et a poursuivi sa formation sacerdotale au séminaire Jean XXIII de Louvain. Il a fait son stage dans le secteur pastoral Effata à Opwijk où il est nommé depuis qu'il a été ordonné diacre le 12 juin 2021. Il poursuit un master de recherche en théologie à la KU Leuven.
Kevin Pluym (°1988) a grandi à Berlaar. Il a suivi une formation d'enseignant à Thomas More, campus de Vorselaar. Il a ensuite étudié à la KU Leuven, où il a obtenu une licence et une maîtrise en théologie. Après avoir effectué un stage pastoral de deux ans à Haacht, il a reçu sa première nomination pastorale à Kapelle-op-den-Bos en septembre 2021. Le 30 octobre 2021, il a été ordonné diacre.
Jan Van Achter (°1974) a grandi à Halle, a obtenu des diplômes en droit (VUB), en droit notarial (KU Leuven) et un master en droit des sociétés (KU Bruxelles), et a travaillé pendant plus de dix ans dans différentes études notariales. Il a suivi une formation de prêtre à Bovendonk (Pays-Bas) et a fait son stage dans les hôpitaux de Halle et Bonheiden et dans une paroisse à Anderlecht et Asse. Il a reçu sa première nomination pastorale à Vilvoorde en septembre 2021 après avoir été ordonné diacre le 19 juin 2021.
Du côté francophone, selon Geert De Kerpel sur cathobel, il y aura deux ordinations à la cathédrale de Bruxelles :
Ordination presbytérale de Marc Giraud et de Nguyen Van Dung. Dimanche 19 juin, cathédrale Bruxelles
Le dimanche 19 juin 2022, à 15h, à la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles, le Cardinal Jozef De Kesel ordonnera Marc Giraud prêtre pour l’Archidiocèse Malines-Bruxelles et Nguyen Van Dung prêtre pour la congrégation des Augustins de l’Assomption.
Marc Giraud a 41 ans. Il est français d’origine et vit en Belgique depuis l’âge de 10 ans. Il est le quatrième d’une famille de six enfants. Il a une formation d’ingénieur civil et a enseigné les mathématiques. Il est entré en 2015 au séminaire diocésain et a été envoyé au Grand Séminaire francophone à Namur, où il a suivi l’année propédeutique, le cycle de philosophie et où il termine cette année un baccalauréat en théologie, conjointement avec la faculté de théologie de l’UCLouvain. Durant sa formation, Marc a été inséré à la paroisse Saint-Etienne de Braine-l’Alleud, à l’Unité pastorale Père Damien de Koekelberg et, après un stage de deux ans à Nivelles, il est actuellement en stage à l’Unité pastorale l’Olivier de Jette, où il a été ordonné diacre le 10 octobre 2021.
Nguyen Van Dung est né en 1987 dans la région de Vinh, au centre du Vietnam, dans une famille catholique. Il est le troisième d’une fratrie de cinq. Après des études universitaires en sociologie, à Saigon, il est entré en relation avec la congrégation des Augustins de l’Assomption et, après deux ans de postulat, il a été envoyé en France. Au terme de deux années d’étude de la langue française, à Lyon, il a fait le noviciat de vie religieuse à Juvisy, près de Paris et a prononcé ses premiers vœux en septembre 2016. Il a alors été envoyé à Bruxelles, où il a entrepris les études de philosophie et de théologie, d’abord à l’Institut d’Etudes Théologiques des jésuites, puis à Louvain-la-Neuve, où il a obtenu la licence canonique et le Master en théologie à la fin de l’année académique 2020-2021. Le frère Van Dung a prononcé ses vœux perpétuels le 5 septembre 2020 et a ensuite été ordonné diacre le 26 septembre 2021. Au terme de son stage diaconal, exercé dans l’Unité pastorale Saint Père Damien et la Communauté Maranatha, son Supérieur général l’a appelé à l’ordination presbytérale.
-
Quand le Parlement Européen discute "des menaces au droit à l'avortement au niveau mondial" et en particulier aux Etats-Unis, la COMECE dénonce une ingérence inacceptable
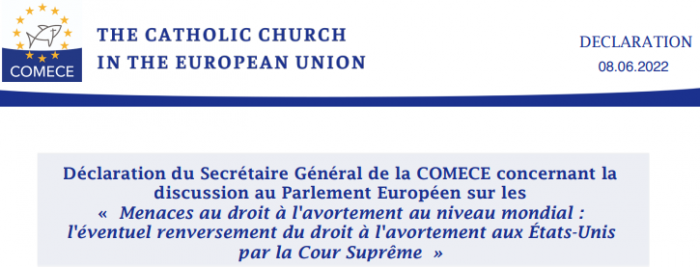
En vue de la discussion prévue aujourd'hui au Parlement Européen sous le titre « Menaces au droit à l'avortement au niveau mondial : l'éventuel renversement du droit à l'avortement aux États-Unis par la Cour suprême », le Secrétaire Général de la COMECE, le Père Manuel Barrios Prieto, a fait la déclaration suivante :
Nous constatons avec surprise que le Parlement européen va débattre de l'impact de la divulgation de l’ébauche d'un projet d'avis de la Cour Suprême des ÉtatsUnis concernant l'avortement. Il s'agit d'une ingérence inacceptable dans les décisions juridictionnelles démocratiques d'un État souverain, un pays n’étant de surcroit pas membre de l'UE. L'adoption d'une résolution par le Parlement Européen approuvant cette ingérence ne fera que discréditer cette institution.
A cet égard, nous souhaitons rappeler que, d'un point de vue juridique, il n'existe pas de droit à l'avortement reconnu en droit européen ou international. Par conséquent, aucun État ne peut être obligé de légaliser l'avortement, de le faciliter ou d'être l’instrument de sa pratique.
L'UE devrait respecter les compétences législatives de ses États membres et le principe d'attribution selon lequel « l'Union dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités
établissent » (Article 5.2 du Traité sur l'Union Européenne). Comme l'a exprimé le Comité permanent de la COMECE dans une déclaration en février 2022, la tentative d'introduire un prétendu droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne serait une loi « dépourvue de fondement éthique et destinée à être une cause de conflit perpétuel entre les citoyens de l'UE ».Nous notons également avec beaucoup d'inquiétude et de regret la négation du droit fondamental à l'objection de conscience, qui est une émanation de la liberté de conscience, tel que déclaré par l'article 10.1 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne et reconnu par le Comité des Droits de l'Homme de l'ONU (Cas Jeong et al v. République de Corée1, 27 avril 2011).
Nous sommes préoccupés par le fait que le droit des établissements de santé de refuser de fournir certains services, dont l'avortement, soit affaibli, voire nié. Comme l'indique l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe dans sa résolution
1763 (2010) sur le droit à l'objection de conscience dans le cadre de soins médicaux légaux, « nul hôpital, établissement ou personne ne peut faire l’objet de pressions, être tenu responsable ou subir des discriminations d’aucune sorte pour son refus de réaliser, d’accueillir ou d’assister un avortement, une fausse couche provoquée [..], ni pour son refus d’accomplir toute intervention visant à provoquer la mort d’un fœtus ou d’un embryon humain, quelles qu’en soient les raisons. »Comme l'a souligné le Comité Permanent de la COMECE : « Nous sommes conscients de la tragédie et de la complexité des situations dans lesquelles se trouvent les mères qui envisagent un avortement. Prendre soin des femmes qui se trouvent dans une situation difficile ou conflictuelle en raison de leur grossesse est un élément central du ministère diaconal de l'Église et doit également être un devoir exercé par nos sociétés. Les femmes en détresse ne doivent pas être laissées pour compte, et le droit à la vie de l'enfant à naître ne peut être ignoré. Tous deux doivent recevoir toute l'aide et l'assistance nécessaires. »
1 https://www.refworld.org/cases,HRC,4ff59b332.html
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Ethique, International, Politique, Société 1 commentaire -
Pèlerinage de Chrétienté à Chartres pour la Pentecôte : une belle vidéo de Boulevard Voltaire intitulée : Pour Dieu et pour la France, ils ont marché pendant 3 jours:
Pèlerinage de Chrétienté à Chartres pour la Pentecôte : une belle vidéo de Boulevard Voltaire intitulée : Pour Dieu et pour la France, ils ont marché pendant 3 jours. Pour Dieu, pour la France…et pour d’autres la Belgique que des Liégeois reconnaîtront sans peine, parmi tous ces témoignages à l’unisson glanés sur le site web « Riposte catholique » :


