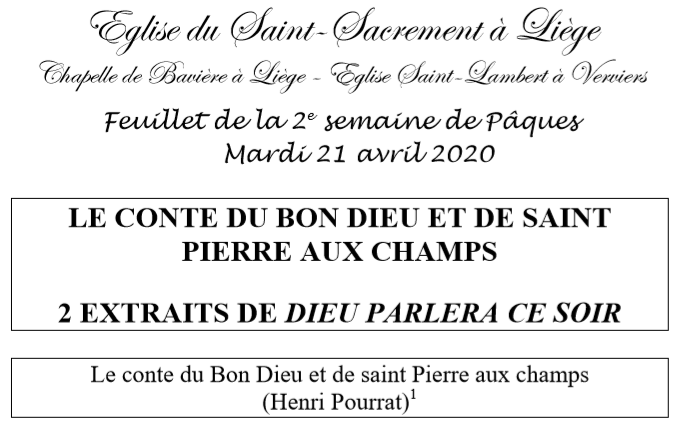De zenit.org :
France : le président Macron s’entretient au téléphone avec le pape
Quarante-cinq minutes en pleine crise du Covid-19
Le président de la République française Emmanuel Macron s’est entretenu 45 minutes au téléphone avec le pape François, en pleine crise du Covid-19, le 21 avril 2020.
L’échange portait sur « l’épreuve que traverse l’humanité et ce qu’elle exige de nous », a indiqué le chef d’Etat dans un tweet à l’issue de la conversation : « soutenir l’Afrique et aider les pays les plus pauvres ; apaiser les souffrances par une trêve universelle dans les conflits ; montrer une Europe unie et solidaire ».
Selon l’Élysée, le pape s’exprimait en espagnol et les deux hommes ont souligné leurs convergence de vue concernant la trêve universelle, l’annulation de la dette, la solidarité internationale et l’Europe. Emmanuel Macron a exposé les mesures prises par le pays et il a aussi renouvelé son invitation au pape à venir en voyage en France.
Le président s’est ensuite entretenu avec les représentants des cultes et des associations laïques. Dans un entretien à Vatican News, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France (CEF), qui représentait l’Église catholique, revient sur son intervention, évoquant les difficultés d’une Semaine Sainte en confinement : une réalité « qui avait suscité beaucoup de créativité » chez beaucoup mais qui avait été pour d’autres « une expérience quand même lourde, compliquée ». Il a également souligné « le désir de retrouver un peu de contacts, de relations ».
L’archevêque de Reims, poursuit la même source, « a attiré l’attention du président sur la grande pauvreté qui touchait tout particulièrement les sans-papiers qui travaillaient jusqu’à présent au noir et qui se retrouvent sans ressources ». Il a également parlé des associations caritatives « qui ont besoin de retrouver une possibilité d’agir parce que les besoins sont très grands ».
Autre thème abordé par Mgr de Moulins-Beaufort : l’allègement des contraintes concernant les aumôniers d’hôpitaux et de maisons de retraite. Cela permet, estime-t-il, « de manifester que l’être humain n’est pas qu’un corps dont il faut s’occuper, qu’un psychisme qu’il faut soigner, mais qu’il est aussi un être spirituel et que vivre la maladie, vivre la mort, ce dont des actes profondément humains ». Dans le cas contraire, « on fait reporter tout l’accompagnement des mourants sur les seuls soignants qui accompagnent du mieux qu’ils peuvent mais qui ne peuvent pas tout faire non plus et pour qui il y a une certaine injustice à leur faire porter seuls ce poids là ».

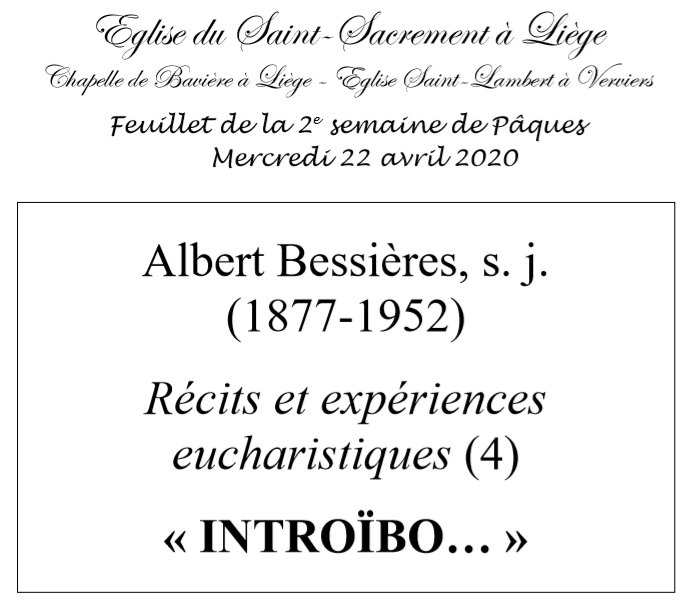


 Les messes publiques pourront-elles reprendre (en petit comité) ? Le président de la République échangera, ce mardi 21 avril, avec le pape François, puis avec les représentants des cultes et des associations laïques (et autres sectes maçonniques et adorateurs de Satan…).
Les messes publiques pourront-elles reprendre (en petit comité) ? Le président de la République échangera, ce mardi 21 avril, avec le pape François, puis avec les représentants des cultes et des associations laïques (et autres sectes maçonniques et adorateurs de Satan…).