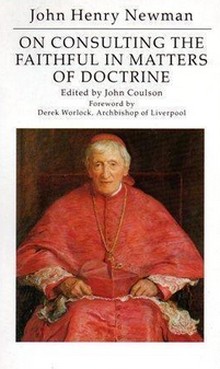De Denis Sureau sur son blog "Chrétiens dans la Cité" :
Macron veut réparer le lien entre l'Eglise et l'Etat
Le discours du président de la République aux 400 personnalités du monde catholique réunies aux Bernardins était très attendu. Emmanuel Macron, avec un art oratoire ne refusant pas un certain lyrisme, s'est livré à un exercice de charme de nature à énerver les militants du laïcisme.
De fait, les réactions n'ont pas manqué : Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un « délire métaphysique. Insupportable. On attend un président, on entend un sous-curé ». Les dirigeants socialistes d'hier et d'aujourd'hui – Benoît Hamon, Manuel Valls, Olivier Faure – ont emboîté le pas. Condamnant une « violation de nos principes républicains », le Grand Orient a déclaré : « Garant du caractère indivisible, laïque, démocratique et social de notre République, le président Macron vient par ses déclarations devant les évêques de porter une grave atteinte à la la laïcité. »
C'est surtout le premier élément du discours d'Emmanuel Macron qui a suscité cette ire : « Le lien entre l’Église et l'État s'est abîmé, il nous incombe de le réparer. » Défendant un « dialogue en vérité », il a ajouté : « si je devais résumer mon point de vue, je dirais qu’une Église prétendant se désintéresser des questions temporelles n’irait pas au bout de sa vocation ; et qu’un président de la République prétendant se désintéresser de l’Église et des catholiques manquerait à son devoir. »
Citant l'exemple du colonel Beltrame, le président a expliqué : « les liens les plus indestructibles entre la nation française et le catholicisme se sont forgés dans ces moments où est vérifiée la valeur réelle des hommes et des femmes...Oui, la France a été fortifiée par l’engagement des catholiques. ». L'appel à cet engagement politique des chrétiens dans la cité fut l'un des thèmes dominants de ce discours. Sans contradiction avec une laïcité qui « n’a certainement pas pour fonction de nier le spirituel au nom du temporel, ni de déraciner de nos sociétés la part sacrée qui nourrit tant de nos concitoyens. Je suis, comme chef de l’État, garant de la liberté de croire et de ne pas croire, mais je ne suis ni l’inventeur ni le promoteur d’une religion d’État substituant à la transcendance divine un credo républicain.»
Revenant sur le débat concernant les racines chrétiennes de l’Europe, il a déclaré : « cette dénomination a été écartée par les parlementaires européens. Mais après tout, l’évidence historique se passe parfois de symboles. Et surtout, ce ne sont pas les racines qui nous importent, car elles peuvent aussi bien être mortes. Ce qui importe, c’est la sève. Et je suis convaincu que la sève catholique doit contribuer encore et toujours à faire vivre notre nation. »
Répondant aux deux interrogations précédemment citées par Mgr Georges Pontier, président de la Conférence des évêques de France, – la bioéthique et les migrants –, Macron a tenté de faire comprendre que les décisions politiques, procédant d'un « humanisme réaliste », ne coïncideront pas avec les attentes de l’Église. Il affirme écouter sa voix avec « intérêt, avec respect et même nous pouvons faire nôtres nombre de ses points. Mais cette voix de l’Église, nous savons au fond vous et moi qu’elle ne peut être injonctive. Parce qu’elle est faite de l’humilité de ceux qui pétrissent le temporel. Elle ne peut dès lors être que questionnante. »Et de conclure : « il nous faudra vivre cahin-caha avec votre côté intempestif et la nécessité que j’aurais d’être dans le temps du pays. Et c’est ce déséquilibre constant qui nous fera ensemble cheminer. »
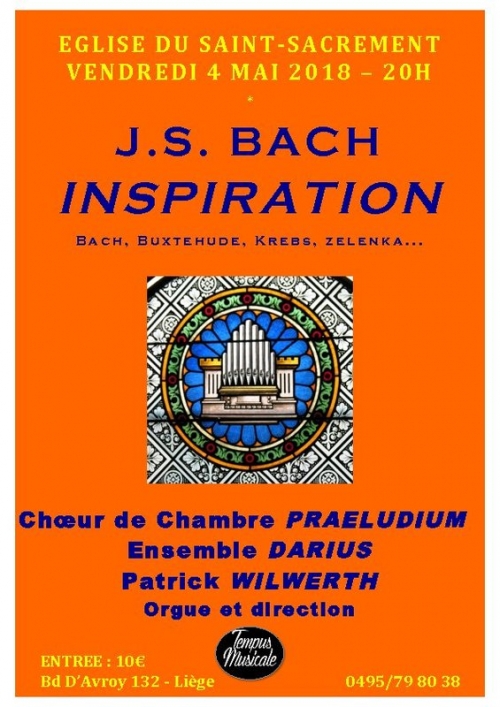



 « L’Église, combien de divisions ? On connaît la célèbre phrase de Staline, bien révélatrice de son matérialisme et de sa volonté hégémonique qui entendait écarter définitivement l’Église de la face du monde. L’Église, combien de divisions ? Mais, beaucoup, aurait-on tendance à répondre aujourd’hui. Et, même, beaucoup trop ! Non plus, cette fois, en référence aux unités blindées ou, plus largement, aux armées auxquelles pensait le maître du Kremlin, mais à celles qui divisent les catholiques entre eux.
« L’Église, combien de divisions ? On connaît la célèbre phrase de Staline, bien révélatrice de son matérialisme et de sa volonté hégémonique qui entendait écarter définitivement l’Église de la face du monde. L’Église, combien de divisions ? Mais, beaucoup, aurait-on tendance à répondre aujourd’hui. Et, même, beaucoup trop ! Non plus, cette fois, en référence aux unités blindées ou, plus largement, aux armées auxquelles pensait le maître du Kremlin, mais à celles qui divisent les catholiques entre eux.