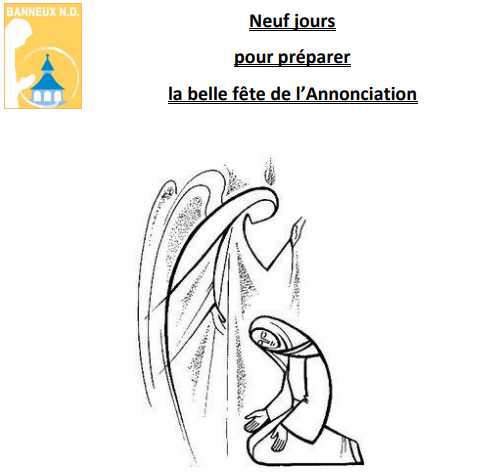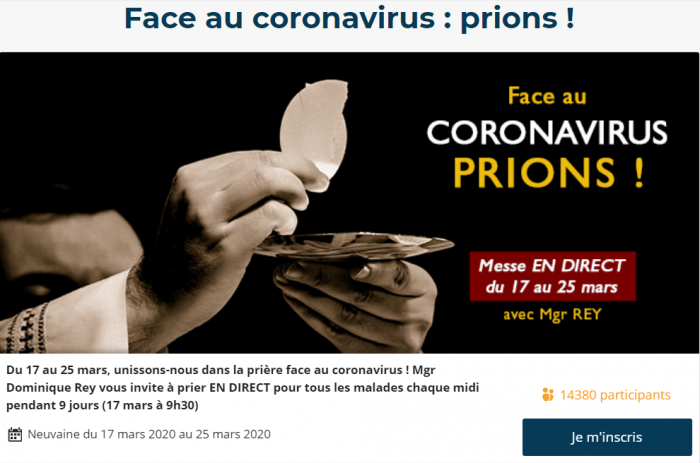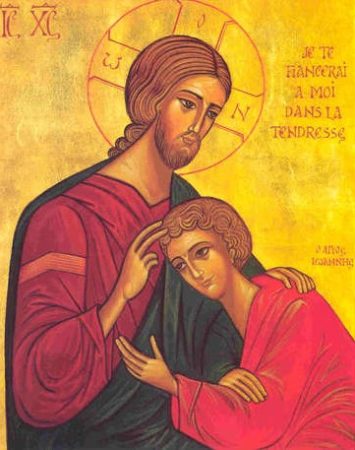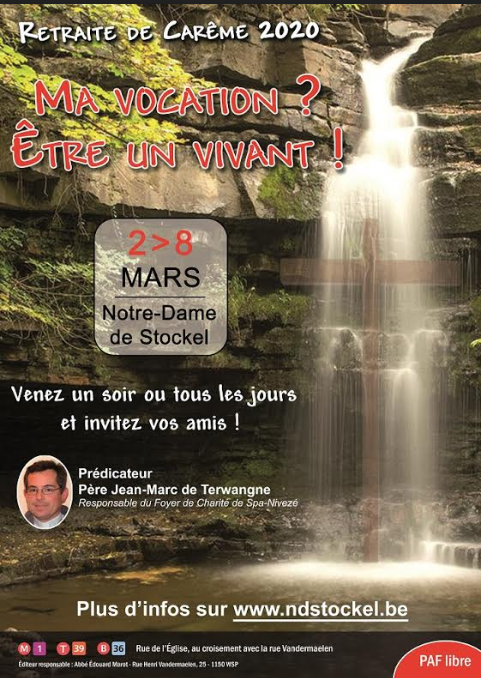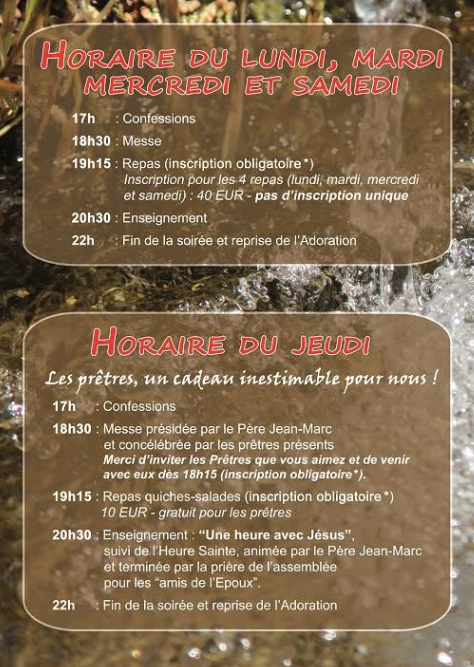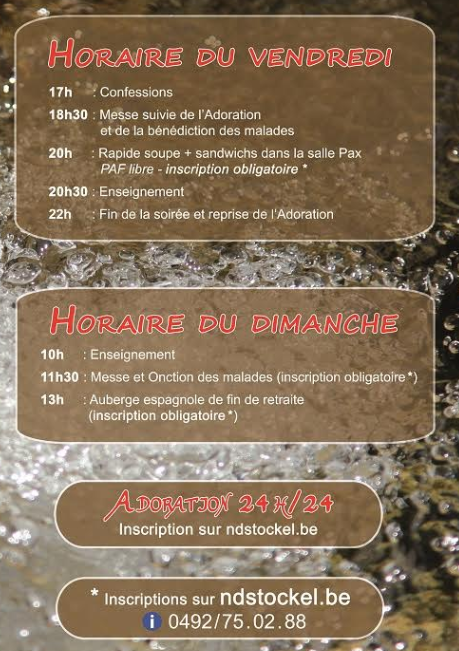Sous le signe du Rosaire, le pape François confie le carême 2020 des catholiques à la Vierge Marie: « J’invoque l’intercession de la Très-Sainte Vierge Marie pour ce Carême à venir, afin que nous accueillions l’appel à nous laisser réconcilier avec Dieu, pour fixer le regard du cœur sur le Mystère pascal et nous convertir à un dialogue ouvert et sincère avec Dieu. C’est ainsi que nous pourrons devenir ce que le Christ dit de ses disciples : sel de la terre et lumière du monde (cf. Mt 5, 13-14). »
Le message, en date du 7 octobre 2019 est publié ce 24 février 2020, en 8 langues: français, arabe, allemand, polonais, portugais, italien, espagnol et anglais.
AB
Message de carême 2020 du pape François
« Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20)
Chers frères et sœurs!
Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous préparer à célébrer avec un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle et communautaire. Il nous faut constamment revenir à ce Mystère, avec notre esprit et notre cœur. En effet, ce Mystère ne cesse de grandir en nous, dans la mesure où nous nous laissons entraîner par son dynamisme spirituel et y adhérons par une réponse libre et généreuse.
1. Le Mystère pascal, fondement de la conversion
La joie du chrétien découle de l’écoute et de l’accueil de la Bonne Nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus : le kérygme. Il résume le Mystère d’un amour « si réel, si vrai, si concret qu’il nous offre une relation faite de dialogue sincère et fécond » (Exhort. ap. Christus vivit, n. 117). Celui qui croit en cette annonce rejette le mensonge selon lequel notre vie aurait son origine en nous-même, alors qu’en réalité elle jaillit de l’amour de Dieu le Père, de sa volonté de donner la vie en abondance (cf. Jn 10, 10). En revanche, si nous écoutons la voix envoûtante du “père du mensonge” (cf. Jn 8, 45), nous risquons de sombrer dans l’abîme du non-sens, de vivre l’enfer dès ici-bas sur terre, comme en témoignent malheureusement de nombreux événements dramatiques de l’expérience humaine personnelle et collective.
En ce Carême de l’année 2020, je voudrais donc étendre à tous les chrétiens ce que j’ai déjà écrit aux jeunes dans l’Exhortation Apostolique Christus vivit: « Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes péchés, crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau » (n. 123). La Pâque de Jésus n’est pas un événement du passé : par la puissance de l’Esprit Saint, elle est toujours actuelle et nous permet de regarder et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes souffrantes.
2. Urgence de la conversion
Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, grâce auquel la miséricorde de Dieu nous a été donnée. L’expérience de la miséricorde, en effet, n’est possible que dans un ‘‘face à face’’ avec le Seigneur crucifié et ressuscité « qui m’a aimé et s’est livré pour moi » (Ga 2, 20). Un dialogue cœur à cœur, d’ami à ami. C’est pourquoi la prière est si importante en ce temps de Carême. Avant d’être un devoir, elle exprime le besoin de correspondre à l’amour de Dieu qui nous précède et nous soutient toujours. En effet, le chrétien prie tout en ayant conscience d’être aimé malgré son indignité. La prière peut prendre différentes formes, mais ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c’est qu’elle creuse en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin de le convertir toujours plus à lui et à sa volonté.
En ce temps favorable, laissons-nous donc conduire comme Israël dans le désert (cf. Os 2, 16), afin que nous puissions enfin entendre la voix de notre Époux, pour la faire résonner en nous avec plus de profondeur et de disponibilité. Plus nous nous laisserons impliquer par sa Parole, plus nous pourrons expérimenter sa miséricorde gratuite envers nous. Ne laissons donc pas passer ce temps de grâce en vain, dans l’illusion présomptueuse d’être nous-mêmes les maîtres du temps et des modes de notre conversion à lui.
3. La volonté passionnée de Dieu de dialoguer avec ses enfants
Le fait que le Seigneur nous offre, une fois de plus, un temps favorable pour notre conversion, ne doit jamais être tenu pour acquis. Cette nouvelle opportunité devrait éveiller en nous un sentiment de gratitude et nous secouer de notre torpeur. Malgré la présence, parfois dramatique, du mal dans nos vies ainsi que dans la vie de l’Église et du monde, cet espace offert pour un changement de cap exprime la volonté tenace de Dieu de ne pas interrompre le dialogue du salut avec nous. En Jésus crucifié, qu’il «a fait péché pour nous» (2Co 5, 21), cette volonté est arrivée au point de faire retomber tous nos péchés sur son Fils au point de « retourner Dieu contre lui-même », comme le dit le Pape Benoît XVI (cf. Enc. Deus caritas est, n. 12). En effet, Dieu aime aussi ses ennemis (cf. Mt 5, 43-48).
Le dialogue que Dieu par le Mystère pascal de son Fils veut établir avec chaque homme n’est pas comme celui attribué aux habitants d’Athènes, qui «n’avaient d’autre passe-temps que de dire ou écouter les dernières nouveautés» (Ac 17, 21). Ce genre de bavardage, dicté par une curiosité vide et superficielle, caractérise la mondanité de tous les temps et, de nos jours, il peut aussi se faufiler dans un usage trompeur des moyens de communication.
4. Une richesse à partager et non pas à accumuler seulement pour soi
Mettre le Mystère pascal au centre de la vie signifie éprouver de la compassion pour les plaies du Christ crucifié perceptibles chez les nombreuses victimes innocentes des guerres, dans les atteintes à la vie, depuis le sein maternel jusqu’au troisième âge, sous les innombrables formes de violence, de catastrophes environnementales, de distribution inégale des biens de la terre, de traite des êtres humains dans tous aspects et d’appât du gain effréné qui est une forme d’idolâtrie.
Aujourd’hui encore, il est important de faire appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté pour qu’ils partagent leurs biens avec ceux qui en ont le plus besoin en faisant l’aumône, comme une forme de participation personnelle à la construction d’un monde plus équitable. Le partage dans la charité rend l’homme plus humain, alors que l’accumulation risque de l’abrutir, en l’enfermant dans son propre égoïsme. Nous pouvons et nous devons aller encore plus loin, compte tenu des dimensions structurelles de l’économie. C’est pourquoi, en ce Carême 2020, du 26 au 28 mars, j’ai convoqué à Assise de jeunes économistes, entrepreneurs et porteurs de changement, dans le but de contribuer à l’esquisse d’une économie plus juste et plus inclusive que l’actuelle. Comme le Magistère de l’Église l’a répété à plusieurs reprises, la politique est une forme éminente de charité (cf. Pie XI, Discours aux Membres de la Fédération Universitaire Catholique Italienne, 18 décembre 1927). Ainsi en sera-t-il de la gestion de l’économie, basée sur ce même esprit évangélique qui est l’esprit des Béatitudes.
J’invoque l’intercession de la Très-Sainte Vierge Marie pour ce Carême à venir, afin que nous accueillions l’appel à nous laisser réconcilier avec Dieu, pour fixer le regard du cœur sur le Mystère pascal et nous convertir à un dialogue ouvert et sincère avec Dieu. C’est ainsi que nous pourrons devenir ce que le Christ dit de ses disciples : sel de la terre et lumière du monde (cf. Mt 5, 13-14).
FRANÇOIS
Donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, 7 octobre 2019,
Fête de Notre-Dame du Rosaire