Hier (3 juin), l'évangile du jour et le commentaire choisi par l'Evangile au Quotidien semblaient particulièrement répondre aux inquiétudes des temps que nous vivons et indiquer l'attitude qu'il convient d'adopter pour ne pas céder au découragement et à la tentation de tout abandonner :
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 16,29-33.
En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images.
Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et tu n’as pas besoin qu’on t’interroge : voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. »
Jésus leur répondit : « Maintenant vous croyez !
Voici que l’heure vient – déjà elle est venue – où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul ; mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi.
Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde. »
(Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible - © AELF, Paris)
Saint Jean de la Croix (1542-1591), carme, docteur de l'Église
Avis et maximes (173-177 in trad. Œuvres spirituelles, Seuil 1945, p. 1203)
« Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance : je suis vainqueur du monde »
Ayez soin de conserver votre cœur dans la paix ; qu'aucun événement de ce monde ne le trouble ; songez que tout finit ici-bas.
Dans tous les événements, si fâcheux qu'ils soient, nous devons plutôt nous réjouir que nous attrister, pour ne point perdre un bien plus précieux, la paix et le calme de l'âme.
Quand même tout ici-bas s'écroulerait et que tous les événements nous seraient opposés, il serait inutile de se troubler, car le trouble nous apporterait plus de dommage que de profit.
Supporter tout avec la même égalité d'humeur et dans la paix, c'est non seulement aider l'âme à acquérir de grands biens, mais encore la disposer à mieux juger des adversités où elle se trouve et à y apporter le remède convenable.
Le ciel est stable et n'est pas sujet aux changements. De même, les âmes qui sont d'une nature céleste sont stables ; elles ne sont pas sujettes à des tendances désordonnées, ni quoi que ce soit de ce genre ; elles ressemblent d'une certaine manière à Dieu qui est immuable.
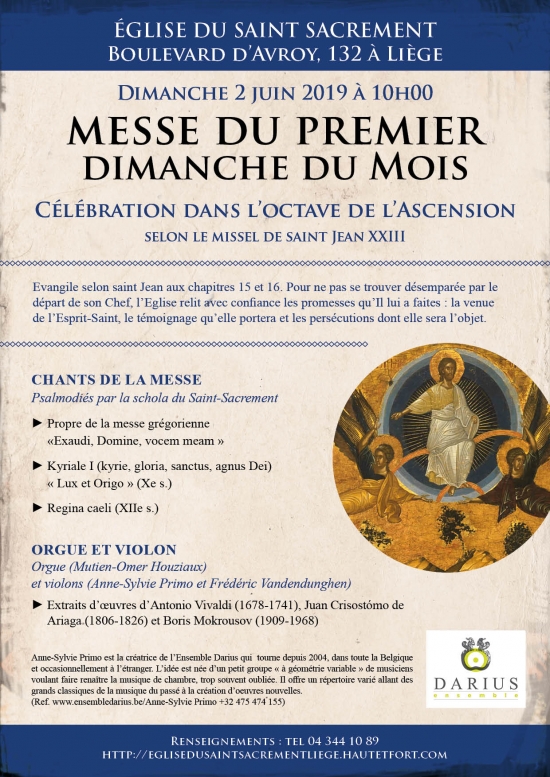
 Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour aider à la
Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour aider à la 
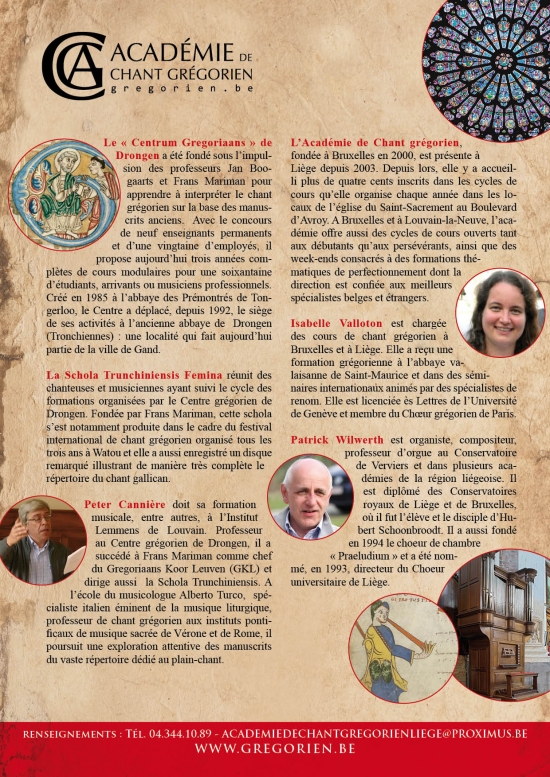
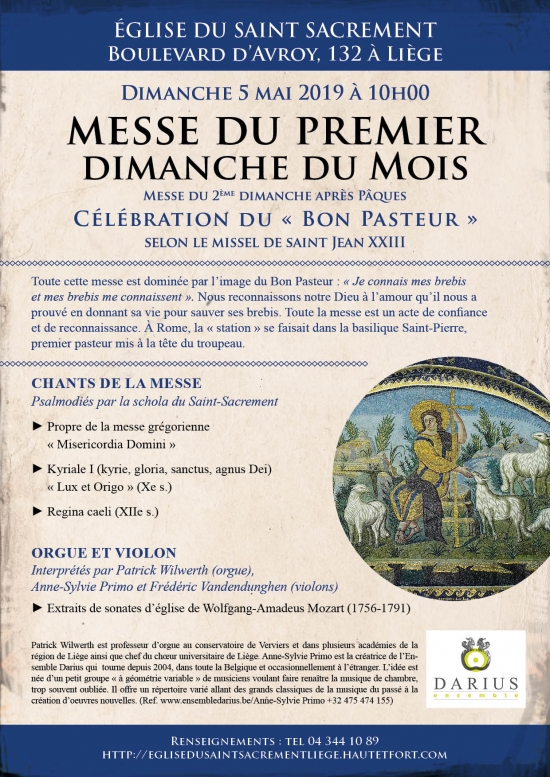
 Un entretien de Mgr Rey, évêque de Fréjus et Toulon, avec l’abbé Barthe, le 30 avril 2019, lu sur le site web du bimensuel « L’Homme Nouveau » :
Un entretien de Mgr Rey, évêque de Fréjus et Toulon, avec l’abbé Barthe, le 30 avril 2019, lu sur le site web du bimensuel « L’Homme Nouveau » : La « trêve pascale » étant maintenant terminée, il importe que l’Eglise se souvienne que sur la terre elle a le devoir d’être militante. Au cas où elle l’aurait oublié, au travers du désengagement de certains, voire de leurs manques, et pire encore de leurs trahisons, le terrible avertissement, que constitue à mes yeux l’incendie de Notre Dame de Paris, est venu nous le rappeler. Le feu qu’il agresse des cerveaux chrétiens ou leurs sanctuaires de pierres, est le genre d’ennemi qui incite aux questions et aux combats. A ce propos d’ailleurs, je me demande si nous avons tous vu brûler la même chose quand j’entends parler de reconstruction et de restauration. Je fais partie de ces catholiques qui n’admettront ni le modèle Reichstag de Berlin (mais les allemands avaient de bonnes raisons de ne pas reconstruire à l’identique), ni l’intrusion d’une flèche de style contemporain qui serait à notre cathédrale ce que le « vagin de la reine » fut aux jardins de Versailles.
La « trêve pascale » étant maintenant terminée, il importe que l’Eglise se souvienne que sur la terre elle a le devoir d’être militante. Au cas où elle l’aurait oublié, au travers du désengagement de certains, voire de leurs manques, et pire encore de leurs trahisons, le terrible avertissement, que constitue à mes yeux l’incendie de Notre Dame de Paris, est venu nous le rappeler. Le feu qu’il agresse des cerveaux chrétiens ou leurs sanctuaires de pierres, est le genre d’ennemi qui incite aux questions et aux combats. A ce propos d’ailleurs, je me demande si nous avons tous vu brûler la même chose quand j’entends parler de reconstruction et de restauration. Je fais partie de ces catholiques qui n’admettront ni le modèle Reichstag de Berlin (mais les allemands avaient de bonnes raisons de ne pas reconstruire à l’identique), ni l’intrusion d’une flèche de style contemporain qui serait à notre cathédrale ce que le « vagin de la reine » fut aux jardins de Versailles.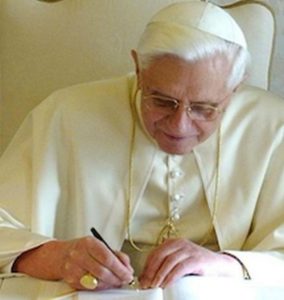
 Le Jeudi Saint, l'abbé Eric Iborra a prononcé en l'église
Le Jeudi Saint, l'abbé Eric Iborra a prononcé en l'église  L’événement de Pâques dépasse notre entendement. De la même manière qu’au printemps, la sève remonte, faisant surgir des bourgeons sur des branches qui semblaient mortes, avec une puissance inouïe, ainsi la force de la Résurrection fait-elle passer un homme – fût-il Dieu – de la mort à la vie. Et c’est sur cette force surnaturelle qu’est basée la foi, et rien d’autres. « Mort, où est ta victoire ? », affirment les chrétiens au matin de Pâques, en un cri étonné qui est leur titre de gloire.
L’événement de Pâques dépasse notre entendement. De la même manière qu’au printemps, la sève remonte, faisant surgir des bourgeons sur des branches qui semblaient mortes, avec une puissance inouïe, ainsi la force de la Résurrection fait-elle passer un homme – fût-il Dieu – de la mort à la vie. Et c’est sur cette force surnaturelle qu’est basée la foi, et rien d’autres. « Mort, où est ta victoire ? », affirment les chrétiens au matin de Pâques, en un cri étonné qui est leur titre de gloire.