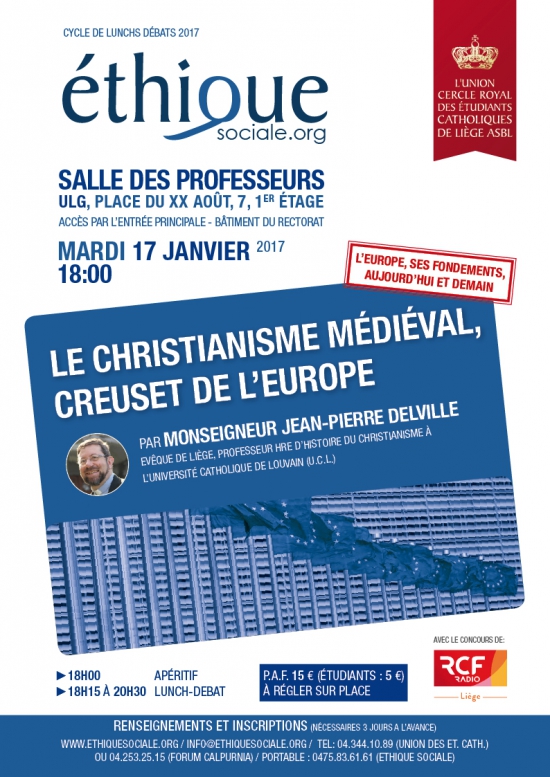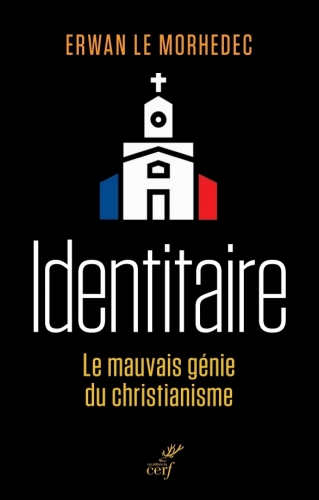Lu sur Euthanasie Stop :
Pouvons-nous encore poser des questions ?
85 personnalités proches des malades psychiatriques
Soignants
La Belgique joue un rôle de pionnier en matière d'euthanasie, mais cela ne veut pas dire pour autant que tout fonctionne parfaitement, estime un collectif d'éthiciens et de médecins.
La Commission fédérale de Contrôle et d'Évaluation de l'Euthanasie (CFCEE) a récemment publié son rapport bisannuel. Nous nous permettons d'en faire quelque peu la critique
Quiconque critique certains aspects relatifs à la pratique de l'euthanasie ces dernières années, se voit généralement taxé d'être, fondamentalement, opposé à l'euthanasie. De notre côté, nous n'avons aucune objection de principe contre l'euthanasie, mais nous estimons qu'en Belgique, il est devenu « tabou » de nommer les problèmes liés à cette pratique. Cette évolution nous préoccupe. Nous n'exposerons ici que trois problèmes, l'objectif étant de provoquer un débat constructif avec tous ceux et toutes celles qui y sont ouverts.
Les chiffres
Les rapports de la CFCEE ne font que refléter la pratique officiellement déclarée en matière d'euthanasie. Selon la Commission, 1,8 % de tous les décès survenus en Belgique sur la période 2014-2015 sont dus à l'euthanasie.
Or, selon le groupe de recherche 'Zorg Rond het Levenseinde' (ZRL), un partenariat entre la VUB et l'UGent, l'euthanasie représentait déjà, en 2013, 4,6 % de tous les décès survenus uniquement en Flandre. Le taux moins élevé en Belgique francophone a certes pour effet d'abaisser le pourcentage national vers le bas. Ces études ne sont que des estimations (l'intervalle de crédibilité appliqué dans cette étude, à savoir 95%, indique au moins 3 pour cent), mais on peut tout de même encore arriver à la conclusion qu'une euthanasie sur trois n'est pas déclarée ! Selon l'étude du groupe ZRL, cela s'explique principalement par le fait que les médecins eux-mêmes ne qualifient pas les cas en question comme étant des euthanasies. Il s'agit souvent d'une sédation, demandée par le patient avec, dans le chef du médecin, l'intention réelle d'écourter sa vie.
De tels cas tombent donc bien sous le coup de la loi dépénalisant l'euthanasie.
Toutes les études du groupe ZRL sont publiées dans des revues médicales de référence. Il est dès lors regrettable de lire systématiquement que la Commission n'a pas la possibilité d'évaluer la proportion du nombre d'euthanasies déclarées par rapport au nombre d'euthanasies réellement pratiquées. Ce n'est bien sûr pas de la faute de la Commission si autant de médecins ne déclarent pas certaines euthanasies, mais ce qui est incompréhensible, c'est que la Commission ne dénonce pas cela. Elle mentionne dans sa brochure d'information que lorsque de fortes doses de morphine et de sédatifs sont administrées à la demande du patient, afin d'écourter sa vie, on est face à une euthanasie qui se doit d'être déclarée, mais en réalité, ces déclarations n'ont presque jamais lieu.
De plus en plus de médecins font aussi savoir ouvertement qu'ils refusent de déclarer des euthanasies. Si les médecins ne respectent pas l'obligation de remplir une déclaration officielle, un contrôle sérieux de la pratique de l'euthanasie est impossible. Encore une fois, c'est à la Commission de le dénoncer. Il est aussi déplorable que la législation belge ne prévoie aucune sanction en cas de non-déclaration par un médecin.
Le médecin est-il indépendant ?
Un autre problème concerne la qualité des documents d'enregistrement.
Une déclaration sur quatre est manifestement mal complétée. Et pourtant, la Commission déclare que 'la qualité des documents d'enregistrement a encore été nettement améliorée depuis le rapport précédent'. On peut dès lors se demander ce qu'était alors dans le passé, le niveau de 'qualité'. Se pose aussi la question de savoir si le document d'enregistrement est assez clair, pour qu'un nombre important de médecins soient disposés à le compléter sérieusement.
Le document d'enregistrement des euthanasies aux Pays-Bas est bien meilleur à plusieurs points de vue. Le médecin n'est pas anonyme, par exemple, et les avis des médecins conseils doivent être joints. Alors qu'en Belgique, il suffit que le médecin qui pratique l'euthanasie rédige lui-même un résumé des avis donnés par les médecins conseils, qui resteront a priori anonymes.
A cause de cet anonymat cher à la Belgique, bien des choses restent cachées. Toutefois, en 2016, il y a eu au moins un cas d'euthanasie dans lequel le médecin qui a pratiqué l'euthanasie et le médecin consulté pour avis, étaient frères (un d'entre eux est d'ailleurs membre de la Commission). C'est ce qu'a révélé un jugement du tribunal de première instance de Louvain (DS 30 juin et DS 8 juillet). Néanmoins la Commission a approuvé ce cas d'euthanasie clairement illégal (le deuxième médecin doit être indépendant du premier. 0r, il ne peut en être question à partir du moment où il existe un lien familial entre les deux médecins). Aux Pays-Bas, cette situation ne serait pas passée inaperçue.
La Commission comme tribunal
Le rôle que la Commission s'adjuge est lui aussi problématique. La Commission rapporte que 'dans quelques rares cas, l'une ou l'autre exigence procédurale n'a pas été dûment respectée, mais la Commission a tout de même approuvé la déclaration après s'être systématiquement assurée que " les conditions de fond essentielles de la loi avaient été correctement respectées".
En lisant cela, on ne peut se défaire de l'idée que la Commission s'attribue parfois les prérogatives d'un 'tribunal': elle approuve ainsi des cas d'euthanasies dans lesquels une ou plusieurs exigence(s) procédurale(s) n'ont pas été satisfaites, pour autant que – selon elle – les conditions 'essentielles' aient été respectées. Or, la loi a donné mission à la Commission d'examiner si les 'conditions' telles que spécifiées par la loi relative à l'euthanasie étaient remplies. Le législateur ne fait aucune distinction entre les 'conditions de fond essentielles' et les autres conditions. Selon la loi, la Commission (moyennant une majorité des deux tiers) transmet l'affaire au procureur si les conditions légales ne sont pas respectées. La Commission doit bien entendu pouvoir demander des précisions aux médecins, pour lever les imprécisions ou ambigüités pouvant mener à des interprétations erronées. Mais elle ne peut en aucun cas décréter que le non-respect de certaines conditions ne pose aucun problème.
La Commission a, en outre, déjà interprété la loi à diverses reprises et se comporte donc comme un 'législateur'. Deux exemples.
(1) Peu après l'adoption de la loi, la Commission a déclaré que la loi autorisait le suicide médicalement assisté, alors qu'elle porte exclusivement sur l'euthanasie, définie comme 'l'acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci'.
(2) Tout récemment, il a été ajouté au document d'enregistrement que la demande d'euthanasie restait valable pendant tout le temps nécessaire à la pratique de l'euthanasie, même si après sa demande, le patient perdait connaissance. Cela signifie, dans un tel cas, que, au moment de l'euthanasie, le médecin ne peut plus s'assurer que le patient souhaite encore l'euthanasie.
Cet élément ajouté au formulaire d'enregistrement est contraire à la règle (qui, dans la pratique, est toujours considérée comme primordiale) et selon laquelle le patient, jusqu'au dernier moment, puisse encore refuser et selon laquelle le médecin puisse obtenir cette confirmation du patient. Nous ne prétendons pas qu'il n'existe aucun argument en faveur de ces deux exemples. Ce que nous contestons, par contre, c'est que la Commission s'autorise à élargir le cadre de la loi. Nous sommes reconnaissants à l'égard des auteurs du dernier rapport en date car ils ont travaillé d'arrache-pied. Néanmoins, le législateur a gravé dans un texte de loi pénale des conditions strictes et nous estimons que ce rapport doit donner lieu à un débat sur le travail conséquent qui reste à faire pour que cette loi soit respectée et, si nécessaire, adaptée.
Signé par Kasper Raus (UZ Gent; Bioethics Institute Ghent UGent; VUBUGent Groupe de recherche Zorg Rond het Levenseinde), Sigrid Sterckx (Bioethics Institute Ghent UGent; VUBUGent Groupe de recherche Zorg Rond het Levenseinde), Marc Desmet (Service des soins palliatifs Jessa Ziekenhuis Hasselt), Ignaas Devisch (Médecine généraliste et soins de santé de première ligne UGent), Farah Focquaert (Bioethics Institute Ghent UGent), An Haekens (Médecin-chef Alexianen Zorggroep Tienen), Gert Huysmans (président de la 'Fédération des soins palliatifs en Flandre - Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen), Jo Lisaerde (Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde KULeuven), Senne Mullie (Président honoraire de la Fédération des soins palliatifs en Flandre), Herman Nys (Prof. émérite Droit médical KU Leuven), Guido Pennings (Directeur Bioethics Institute Ghent UGent), Veerle Provoost (Bioethics Institute Ghent UGent), ...
Traduction libre de l'opinion parue dans De Standaard 15/11/2016
 Télécharger l'article complet »
Télécharger l'article complet »