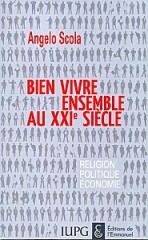Lu sur « Riposte Catholique » :
Rédacteur en chef de L’Homme Nouveau et auteur talentueux, Philippe Maxence a livré une analyse très fine du pontificat qui s’achève et tracé quelques perspectives de celui qui va bientôt commencer au quotidien Direct Matin. Après le combat contre le relativisme de Benoît XVI, le prochain pape aura à se colleter au laïcisme militant. À lire et à ruminer…
Les dernières interventions de Benoît XVI, en particulier la cérémonie de l’Angélus célébrée mercredi, permettent-elles de mieux comprendre les raisons de sa renonciation ?
Il me semble qu’il faut distinguer deux aspects dans les propos de Benoît XVI depuis l’annonce publique de sa renonciation. Le premier a consisté à indiquer qu’il agissait, non seulement en conformité avec sa conscience, mais aussi en pleine conscience. Il a clairement montré qu’il posait un acte libre et mûrement réfléchi. Aspect capital pour la validité de son choix. Deuxièmement, il a exprimé la raison immédiate de son départ – le déclin de ses forces et le jugement qu’il fait de son incapacité à assumer le ministère pétrinien – en l’élargissant peu à peu aux raisons même de cette incapacité : à savoir les dangers très forts qui pèsent actuellement sur l’Église et face auxquels il estime qu’il faut un pape plus vigoureux.
Benoît XVI a déclaré mercredi que « Dieu ne laissera pas couler son Église ». En creux, ne sous-entend-il pas que l’Église connaît un naufrage aujourd’hui ?
Il le dit même explicitement en faisant référence à la tempête sur le lac de Galilée. Là aussi, le risque de “naufrage” est double, voire triple. Il y a d’abord les attaques extérieures. Nous sommes en train de passer d’une époque de relativisme absolu à celle d’un laïcisme agressif et militant. Comme pour Pie XI sous Mussolini on risque de réentendre sous les balcons de Saint-Pierre les cris de « À bas le Pape », sans même parler du sort subi par Pie IX.
Mais plus grave est certainement la crise qui continue à l’intérieur de l’Église. Certes, Jean-Paul II et Benoît XVI ont amorcé le redressement. Mais celui-ci est loin d’être achevé. Il y a une crise de la foi au sein même de ceux qui se déclarent catholiques, qui ignorent souvent qu’ils sont en fait dans un état d’hérésie latent. D’où d’ailleurs l’Année de la foi, le retour aux fondamentaux et à la doctrine, voulue par Benoît XVI. Certains évêques, prêtres et laïcs, dits progressistes, sont également dans un état de schisme non dit qui pourrait aller jusqu’à la rupture explicite. Le relativisme ici ne vient pas de l’extérieur mais il est revendiqué de l’intérieur.
Enfin, si au début de son pontificat, Benoît XVI avait demandé la prière des catholiques pour qu’on le préserve des loups, force est de constater que certains d’entre eux campent toujours au cœur même de Rome, empêchant le gouvernement effectif de l’Église. On l’a encore vu avec les épisodes à répétition touchant le règlement de la situation de la Fraternité Saint-Pie X qui aurait dû s’effectuer sous ce pontificat. D’une certaine manière, Benoît XVI n’a pas osé ou n’a pas pu se confronter à ces deux derniers aspects de la crise.
Sous quelle forme peut-il encore exercer son influence ?
Au risque de choquer, j’espère qu’il l’exercera principalement sous la forme de la prière et du sacrifice, comme il l’a d’ailleurs laissé entendre lors de la dernière audience de ce mercredi. Sa référence à saint Benoît est explicite. Ne rien préférer à l’œuvre de Dieu, c’est-à-dire à la prière, dit le patriarche des moines d’Occident. Il est capital que le prochain pape soit totalement libre, pratiquement et moralement, d’exercer sa tâche.
La renonciation de Benoît XVI a été massivement interprétée comme un signe de “modernité” et d’“humilité”. N’est-ce pas une lecture réductrice d’une décision qui obéit à des ressorts plus profonds ?
Un signe d’humilité certainement car c’est l’une des caractéristiques profondes de cet homme, rendant caduques depuis longtemps les images-slogans de “Panzer-cardinal”. Modernité, tout dépend ce que l’on entend par là. Il existe un catalogue des erreurs modernes condamnées par l’Église, laquelle se méfie très largement de la modernité philosophique. L’œuvre de restauration des liens entre foi et raison, tenté par Benoît XVI, est la face positive de cette méfiance. Mais il y a effectivement quelque chose de plus profond, incompréhensible à nos yeux, parce que justement antimoderne. Le pape a pu poser cet acte parce qu’il est le souverain pontife, souverain absolu et qu’il ne rend de comptes qu’à Dieu. Il ne démissionne pas ; il renonce ; il abdique. Et, enfin, il croit que l’Église continuera comme l’Histoire le montre depuis 2000 ans et comme la foi le lui dit. Les scintillements des caméras et le bruit de la rue auront disparu depuis longtemps que l’Église annoncera toujours le Christ.
Réf.: POSTED BY RÉDACTION SUMMORUM PONTIFICUM IN EGLISE UNIVERSELLE, EN UNE AVEC 3 COMMENTAIRES
 Robert Sarah est-il, à vos yeux, un candidat solide au fauteuil de saint Pierre?
Robert Sarah est-il, à vos yeux, un candidat solide au fauteuil de saint Pierre? (…) A vingt heures, le 28 février, au moment où la Garde suisse cessait son service à Castelgandolfo, au Vatican, le cardinal Camerlingue – qui tire son nom de sa responsabilité de la « Chambre apostolique » « Camera apostolica » lors de la vacance du Siège apostolique -, Tarcisio Bertone (photo), a reçu la « férule », sorte de sceptre revêtu de velours grenat, signe de son autorité, « sono le otto », « il est huit heures » a-t-il dit en recevant cet insigne
(…) A vingt heures, le 28 février, au moment où la Garde suisse cessait son service à Castelgandolfo, au Vatican, le cardinal Camerlingue – qui tire son nom de sa responsabilité de la « Chambre apostolique » « Camera apostolica » lors de la vacance du Siège apostolique -, Tarcisio Bertone (photo), a reçu la « férule », sorte de sceptre revêtu de velours grenat, signe de son autorité, « sono le otto », « il est huit heures » a-t-il dit en recevant cet insigne