Le drame du XXIème siècle est l’indifférence, affirme le cardinal Mauro Piacenza : « l’indifférence devant le frère qui souffre, qui n’a pas ce qu’il faut pour vivre, ne peut accéder aux soins et à la formation de base, devant le frère dont la dignité est piétinée par certains pouvoirs aveugles, devant le frère qui ne peut vivre sa foi et son appartenance qu’au prix de sa vie physique ».
Le cardinal a pris la parole, en tant que président de L’Aide à l’Église en détresse Italie (ACS Italia), au Colisée, le 24 février 2018 pour la journée de protestation mondiale contre la persécution des chrétiens.
Le Colisée de Rome et deux églises en Irak et en Syrie ont été illuminés en rouge pour dénoncer la souffrance des chrétiens persécutés.
Voici notre traduction du discours du cardinal Piacenza qui a exhorté : « Abattons les murs de la mort, à commencer par les murs de notre indifférence : je ne peux pas être serein si mon frère souffre ! »
AK
Intervention du card. Mauro Piacenza
Nous sommes devant le Colisée, qui constitue un « symbole universel », connu de tous et qui, pour tous, s’identifie à Rome. Mais on n’est pas toujours conscient que cela fut un lieu de mort et de meurtres, que ce soit en raison de la barbarie des luttes entre les gladiateur, « usque ad mortem » ou en raison du martyre de milliers de chrétiens, qui s’opposaient à la violence du pouvoir dominant qui prétendait à un culte divin.
Ces pierres et ces murs peuvent alors avoir une double signification.
Ce sont des « murs de vie » si nous les considérons comme l’expression d’une civilisation et d’un empire qui a su servir de médiateur, pour toute la culture occidentale, entre la civilisation grecque d’Athènes et la « foi de Jérusalem, permettant à l’Europe d’être ce qu’elle a été et ce qu’elle est encore par certains aspects.
Ce sont des « murs de mort », si nous faisons mémoire du nombre impressionnant d’hommes et de martyrs qui, en leur sein, ont offert leur vie (ou à qui on l’a arrachée) par les mains d’un pouvoir incapable de regarder le bien intégral de la personne.
C’est pourquoi, ce soir, le Colisée est illuminé de la couleur du sang : pour donner une voix à tous les « murs de mort » qu’il y a encore aujourd’hui dans le monde, comme nous le rappelle le pape François.
Le drame du XXème siècle, affirmait saint Maximilien Marie Kolbe, est l’indifférence. Je pense que l’indifférence est aussi le drame de notre XXIème siècle. L’indifférence devant le frère qui souffre, qui n’a pas ce qu’il faut pour vivre, ne peut accéder aux soins et à la formation de base, devant le frère dont la dignité est piétinée par certains pouvoirs aveugles, devant le frère qui ne peut vivre sa foi et son appartenance qu’au prix de sa vie physique.
Cette indifférence plonge ses racines dans les conceptions individualistes de l’homme, où la question « Pour quelle fin ? » ne trouve plus de place. En effet, quand l’homme cultive exclusivement son intérêt, au point d’exclure toute autre fin, il a fatalement tendance à se nuire à lui-même.
L’indifférence diffuse de la culture contemporaine est causée par la « perte de la fin », par le fait d’être repliés à chercher uniquement les « causes » des phénomènes, multipliant les habiletés techniques, mais oubliant la « fin ».
Nous sommes ici ce soir, devant ces « murs » vivants par la culture et mortifères par l’expérience, pour aider à vaincre l’indifférence. « L’Aide à l’Église en détresse », depuis 70 ans, lutte dans le monde entier pour soutenir les frères dans le besoin et défendre leur légitime liberté à professer leur foi. Abattons les murs de la mort, à commencer par les murs de notre indifférence : je ne peux pas être serein si mon frère souffre ! Je ne peux pas entendre le cri d’Abel, de « tous les Abel » du monde, un cri qui monte vers le Dieu de la terre.
On n’abat les murs de la mort et de l’indifférence qu’en sachant reconstruire ! Et l’on ne reconstruit qu’en recommençant à répondre aux questions fondamentales de notre existence, et la première de toutes : « pour quelle fin ? » ; seule la redécouverte de la fin commune qui unit tous les hommes qui unit tous les hommes : l’être et le fait de devenir des personnes, pourra permettre, dans le temps, de retrouver une authentique sensibilité pour l’autre, parce que mon intérêt est aussi le sien et que sa souffrance est aussi la mienne.
Que Marie, Reine des martyrs et Fontaine de vie nous soutienne dans notre volonté d’abattre les murs de mort et d’indifférence pour construire une culture de vie et de paix !
© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat
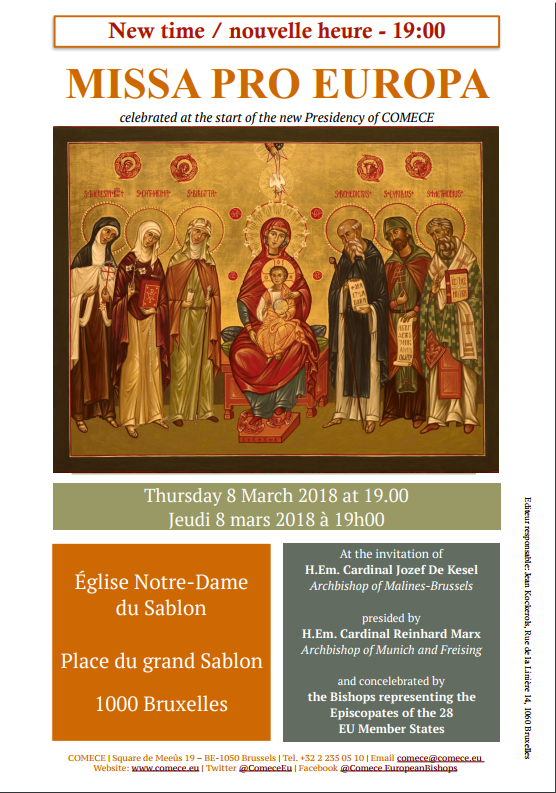


 Après le 31 décembre, le 21 janvier, le Comité laïc de coordination (CLC), un collectif catholique, avait appelé la population à marcher une fois de plus, pacifiquement, ce dimanche 25 février. Une marche où les manifestants étaient invités à se munir de leur bible, de leur croix ou de rameaux. Compte rendu d’Hubert Leclercq sur le site de « La Libre Afrique » :
Après le 31 décembre, le 21 janvier, le Comité laïc de coordination (CLC), un collectif catholique, avait appelé la population à marcher une fois de plus, pacifiquement, ce dimanche 25 février. Une marche où les manifestants étaient invités à se munir de leur bible, de leur croix ou de rameaux. Compte rendu d’Hubert Leclercq sur le site de « La Libre Afrique » : Une fois de plus, policiers, soldats, membres de la garde républicaine n’ont pas hésité à utiliser des gaz lacrymogènes et à tirer à balles réelles sur les manifestants.
Une fois de plus, policiers, soldats, membres de la garde républicaine n’ont pas hésité à utiliser des gaz lacrymogènes et à tirer à balles réelles sur les manifestants. dimanche soir).
dimanche soir).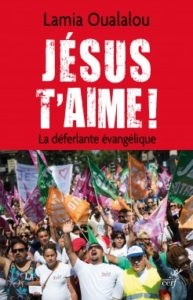 Enquête sur la montée des églises évangéliques au Brésil, premier pays catholique du monde.
Enquête sur la montée des églises évangéliques au Brésil, premier pays catholique du monde.