L’Etat islamique (EI) revendique sa première attaque en République démocratique du Congo (RDC) et s’attribue la responsabilité d’un assaut contre une caserne de l’armée congolaise. De Christophe Rigaud sur le site Afrikarabia :
 « Revendication de circonstances ou implantation durable de l’Etat islamique au Congo ? Deux messages de l’agence Amaq, l’organe de propagande du groupe terroriste, affirment que des « combattants de l’État islamique » ont participé à l’attaque d’une caserne de Bovata, près de Beni, dans le nord de la province du Nord-Kivu. Une première en République démocratique du Congo (RDC), qui deviendrait, selon l’Etat islamique une nouvelle zone de son « califat » en Afrique centrale. Une attaque a bien été identifiée par l’ONU dans la nuit du 16 au 17 avril dans la même zone, et les assaillants ont été identifiés comme des miliciens ADF (Allied Democratic Forces), une rébellion ougandaise. Et depuis plusieurs années, experts et chercheurs s’interrogent sur de possibles liens entre la milice musulmane ougandaise, largement « congolisée » depuis, et l’organisation Etat islamique – voir notre article.
« Revendication de circonstances ou implantation durable de l’Etat islamique au Congo ? Deux messages de l’agence Amaq, l’organe de propagande du groupe terroriste, affirment que des « combattants de l’État islamique » ont participé à l’attaque d’une caserne de Bovata, près de Beni, dans le nord de la province du Nord-Kivu. Une première en République démocratique du Congo (RDC), qui deviendrait, selon l’Etat islamique une nouvelle zone de son « califat » en Afrique centrale. Une attaque a bien été identifiée par l’ONU dans la nuit du 16 au 17 avril dans la même zone, et les assaillants ont été identifiés comme des miliciens ADF (Allied Democratic Forces), une rébellion ougandaise. Et depuis plusieurs années, experts et chercheurs s’interrogent sur de possibles liens entre la milice musulmane ougandaise, largement « congolisée » depuis, et l’organisation Etat islamique – voir notre article.
Des connexions avec l’islamisme radical
La connivence entre les rebelles ougandais des ADF et des groupes terroristes étrangers n’est pas une information nouvelle. Ce groupe, présent en RDC depuis les années 1995, a été dirigé par un chrétien converti à l’islam, Jamil Mukulu, qui a été arrêté en 2017. En lutte contre le président ougandais Museveni, les ADF se sont enracinés dans l’Est du Congo, faute de pouvoir déstabiliser le régime de Kampala. En 2012 déjà, un rapport d’International Crisis Group (ICG) se demandait si les ADF ne représentaient pas « une menace islamique en Afrique centrale ».
Suite aux attentats d’Al-Shebab à Kampala en 2010, l’ONU et les services de sécurité ougandais et congolais faisaient état « de la présence de Somalis au sein des ADF ». Plus récemment, en 2018, le Groupe d’études sur le Congo (GEC) avait eu accès à de nombreuses vidéos des ADF et établissait des connexions avec l’Etat islamique. En juillet 2018, Waleed Ahmed Zein est arrêté à Nairobi. On découvre que ce kenyan, qui est considéré comme le trésorier de Daesh en Afrique, sert d’intermédiaire financier entre l’EI et plusieurs groupes armés, dont les ADF au Congo.
Daesh et ADF, deux groupes en perte de vitesse
Les liens directs entre Daesh et les ADF ne sont pourtant toujours pas établis formellement. Il s’agit pour l’instant de deux groupes distincts dont le niveau de collaboration reste encore très flou. Cette revendication intervient au moment où les deux mouvements terroristes sont en perte de vitesse. Les ADF sévissent dans la région de Beni depuis 2014. C’est dû moins ce qu’affirme l’armée congolaise (FARDC), qui lui attribue régulièrement les différentes attaques dans cette zone du Nord-Kivu. Des attaques cruelles, à l’arme blanche, qui se concentrent surtout sur des cibles civiles. On estime à plus de 2.000 le nombre de victimes en 5 ans, autour de la ville de Beni.
Cette revendication de l’Etat islamique intervient alors que Daesh a perdu tout contrôle territorial en Syrie et en Irak, et se cherche de nouvelles terres de conquête. L’Afrique constitue clairement un objectif affiché depuis plusieurs années par le patron de l’EI lui-même, Abou Bakr al-Baghdadi. Et la zone du Nord-Kivu est un terrain tout trouvé. Une cinquantaine de groupes armés pullulent encore dans la région depuis plus de 25 ans et les ADF constitue le groupe le plus structuré et le plus violent de l’Est du Congo… un allié idéal pour l’Etat islamique, en quête de relais en Afrique centrale. Du côté des ADF, cette alliance est une aubaine pour « remotiver les troupes », alors que le groupe peine à s’imposer sur le terrain, face à la traque de l’armée congolaise et des casques bleus de l’ONU.
Tshisekedi en première ligne
On reste cependant étonné que cette revendication intervienne sur une attaque d’aussi faible ampleur (2 ou 3 morts selon les sources). Mais la présence du tout nouveau président Félix Tshisekedi dans le Nord-Kivu pour un déplacement sur les questions de sécurité, explique peut-être cette précipitation. Le chef de l’Etat, qui doit partager le pouvoir avec l’ancien président Joseph Kabila qui reste majoritaire à l’Assemblée nationale et au Sénat, cherche à reprendre la main sur l’armée congolaise, accusée d’être passive au Nord-Kivu.
Pire, certains officiers FARDC sont accusés de connivence avec les ADF. Plusieurs enquêtes des experts des Nations unies et du Groupe d’Etude sur le Congo (GEC) ont pointé la responsabilité de l’armée congolaise, et principalement celle du général Muhindo Akili Mundos, comme complice et co-auteur de certains massacres de masse dans la région de Beni – voir notre article. Cette revendication tombe donc à point nommé pour le président Tshisekedi, qui peut désormais exiger « un grand ménage » dans l’armée. Le chef de l’Etat peut également profiter de cette revendication pour demander un appui renforcé des casques bleus de la Monusco dans la région, et pourquoi pas… une aide extérieure.
L’éradication des ADF et une stabilisation de la région de Beni, à feu et à sang depuis 2014, serait une importante victoire pour le président Tshisekedi, toujours en quête de légitimité après son élection contestée. La revendication de circonstance et très virtuelle de Daesh, constitue pour l’instant une opportunité pour le président Tshisekedi de réussir son premier coup politique : reprendre la main sur l’armée dans l’Est du pays. Mais attention, si la collaboration entre l’Etat islamique et les ADF venait à prendre de l’ampleur, la région pourrait rapidement redevenir une zone incontrôlable et menacer Kinshasa comme ont pu le faire de nombreux groupes armés par le passé.
Ref. Revendication de circonstances ou implantation durable de l’Etat islamique au Congo ?
L’implantation de l’Islam au Congo est plus que marginale. Les vieux souvenirs esclavagistes du XIXe siècle font partie de la mémoire historique des populations implantées dans ce qui deviendra le Congo tel que nous le connaissons aujourd’hui. Déjà, sous la colonisation belge, les « arabisés » -ambulants ou implantés- dans l'Est de la colonie suscitaient une méfiance « belgo-congolaise » latente...
JPSC

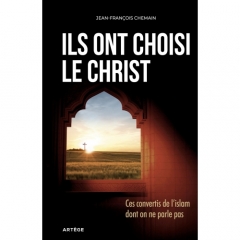 Je
Je