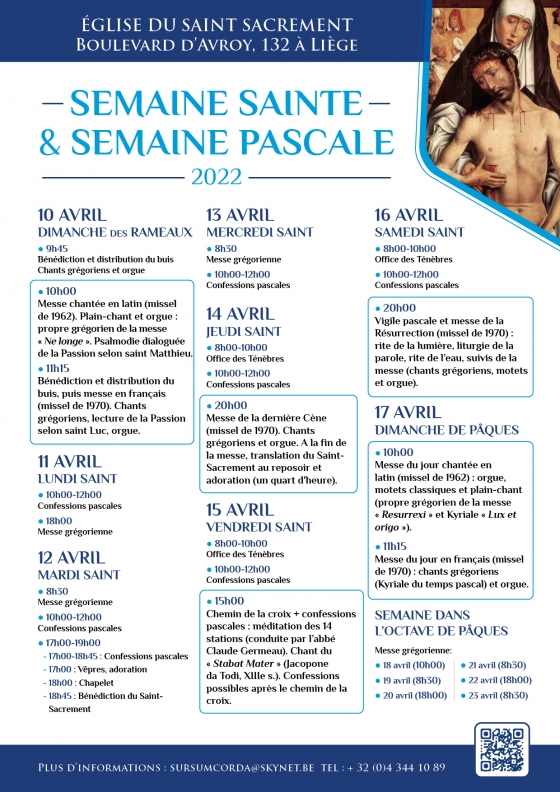Lu sur le site web « Paix liturgique » :
 « La nouvelle est donc tombée : Mgr Laurent Ulrich, 71 ans en septembre, archevêque de Lille, après avoir été archevêque de Chambéry, devient archevêque de Paris, Mgr Aveline, archevêque de Marseille, ayant semble-t-il refusé la charge. Il sera « installé » à Saint-Sulpice le 24 mai.
« La nouvelle est donc tombée : Mgr Laurent Ulrich, 71 ans en septembre, archevêque de Lille, après avoir été archevêque de Chambéry, devient archevêque de Paris, Mgr Aveline, archevêque de Marseille, ayant semble-t-il refusé la charge. Il sera « installé » à Saint-Sulpice le 24 mai.
Cet homme de Bourgogne est plutôt distant et réservé comme un homme du Nord qu’il est devenu. Sensible cependant et sachant manifester de l’empathie, ce prélat intelligent, se sait depuis toujours destiné à de hautes fonctions. S’il a été un temps vice-président de la Conférence des Evêques de France, il est clair qu’il s’en voit le président. Il est bien possible aussi que, si le présent pontificat se prolonge suffisamment, il puisse recevoir la barrette rouge d’un pape qui l’apprécie.
Car cet homme d’allure classique, mais qui n’a rien d’un traditionnel, est parfaitement dans la ligne du pontificat bergoglien. A Lille, où il était sur le siège qui fut occupé par Mgr Vilnet et Mgr Defois, il est entouré d’un clergé du Nord plus progressiste que lui, au sein duquel il a d’ailleurs eu à gérer trois grosses affaires de mœurs. Mais il entend qu’on sache quelle est sa ligne : accueil des migrants, proximité des pauvres, sur laquelle il est concurrencé par Marine Le Pen. On cite le fait qu’il a exigé d’un jeune diacre qui portait la soutane qu’il veuille bien l’abandonner.
Bon administrateur, il gère avec prudence, évitant « les histoires », détestant le bruit et la fureur, sachant faire avancer des collaborateurs en guise de « fusibles ».
La fin de l’ère Lustiger
Sa nomination à Paris marque la fin d’une époque. Dans nos Lettres 848 et 850 de février 2022, nous exposions les plaies et bosses qui affectent aujourd’hui le diocèse de Paris après la carbonisation du pontificat Aupetit. Il était clair, disions-nous, que ce diocèse traumatisé allait changer de mains : après avoir été gouverné et profondément formaté depuis le début des années 80 du siècle dernier par la personnalité du cardinal Lustiger et de ses successeurs le cardinal Vingt-Trois et Mgr Aupetit, il devenait très probable que le Pape allait profiter de l’occasion pour clore cette ère Lustiger, « cléricale » et arrogante selon ses critères de jugement. C’est bien ce qui arrive : le siège parisien échappe à Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président de la Conférence des Évêques, désigné de longue date par les fées lustigériennes pour continuer une lignée épiscopale parisienne presque aussi durable que celle des Gondi aux XVIe et XVIIe siècles.
Mgr Ulrich aura donc à gérer l’héritage difficile que laisse Mgr Michel Aupetit. Il lui faudra restaurer la confiance avec ses subordonnés et son clergé : l’ancien archevêque, homme d’un caractère difficile et cassant avec ses subordonnés, avait vu deux de ses vicaires généraux¸ Alexis Leproux et Benoist de Sinety, claquer la porte et démissionner à quatre mois d’intervalle. Du jamais vu. Benoist de Sinety était d’ailleurs parti dans le diocèse de Lille, où Mgr Ulrich lui avait confié la grosse paroisse lilloise de Saint-Eubert.
Michel Aupetit avait frappé de tous côtés ; A gauche, Michel Aupetit avait liquidé violemment la communauté progressiste de Saint-Merry. A droite, il avait géré sans aucun dialogue le renvoi du directeur du lycée Saint-Jean-de-Passy. Et puis aussi, il avait tranché dans la liturgie traditionnelle.
Les injustices et violences vis-à-vis de la messe traditionnelle à réparer
Bizarrement, l’archevêque Aupetit, alors qu’il avait bénéficié au début de son mandat de l’opinion favorable du monde traditionnel qui appréciait ses prises de position morales courageuses, se l’était mis à dos en interprétant lourdement le motu proprio Traditionis custodes.
De manière violente, il avait supprimé deux messes dominicales traditionnelles officielles dans deux paroisses populaires, à Saint-Georges de La Villette et à Notre-Dame du Travail, deux paroisses ou la liturgie traditionnelle était célébrée par le curé lui-même ou par un vicaire de la paroisse . De même avait-il supprimé toute une série de messes de semaine officielles, notamment celle très suivie de Saint-François-Xavier, où un public de jeunes nombreux se retrouvait tous les mercredis, et encore celle du lundi à Sainte-Clotilde.
Il avait en outre réservé le droit de célébrer les messes qu’il conservait (Saint-Roch, Saint-Eugène, Sainte-Odile, ND du Lys, Sainte-Jeanne de Chantal) uniquement à des prêtres bi-ritualistes diocésains expressément désignés par lui.
Dans cette affaire, Mgr Philippe Marsset, le « bras gauche » de Mgr Aupetit, a joué un rôle très néfaste. Philippe Marsset est en effet connu pour son hostilité à cette liturgie depuis l’époque de Summorum Pontificum, où curé de la grosse paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge, dans le XIVème arrondissement, il avait tenté de réduire à un ghetto le groupe important qui demandait la célébration d’une messe. Et depuis le départ de Mgr Aupetit, il maintient la ligne du refus de tout accommodement à Sainte-Clotilde, à ND du Travail, à Saint-François-Xavier.
Ces injustices incompréhensibles ont d’ailleurs déclenché des manifestations de protestation qui durent toujours :
- Le mercredi à 17h, un chapelet récité dans l’église Saint Georges de La Villette
- Le mercredi à 19h15, un chapelet itinérant partant de Saint François Xavier et se rendant à N.D. du Lys
- Le dimanche à 18h, un chapelet devant N.D. du Travail
- Et les lundis, mardis et jeudis de 13h à 14h, une présence des veilleurs devant les bureaux de l’archevêché, rue du Cloître-Notre-Dame
Ces manifestations s’ajoutant à celle « célébrée » tous les samedis de midi à 12h 45, devant la nonciature apostolique, avenue du Président-Wilson.
En attente de la pacification liturgique
A Lille, Mgr Ulrich, après une période de distance froide, a dégelé ses rapports avec l’ICRSP desservant l’église Saint-Etienne à Lille et la chapelle ND de Fatima à La Chapelle d’Armentières.
Lors de la survenance de Traditionis custodes, Mgr Ulrich (et surtout son conseil) a (ont) voulu réduire le nombre des messes traditionnelles célébrées dans ces lieux. Des négociations s’en suivirent, dans lesquelles le P. de Sinety, sur la paroisse duquel se trouve Saint-Etienne, a joué un rôle important de facilitateur. Et pour finir, Mgr Ulrich fit une déclaration pour dire que rien n’était changé…
Il n’est d’ailleurs pas impossible que Benoist de Sinety revienne à Paris pour seconder le nouvel archevêque dans sa difficile mission de réconciliation. Notamment de réconciliation et de paix avec les fidèles de la liturgie traditionnelle, fort nombreux à Paris et qui, en quelque sorte l’attendent de pied ferme, non seulement dans les lieux où les messes ont été supprimées, mais aussi sur la question des sacrements autres que la messe, à savoir essentiellement la question brûlante de la célébration de la confirmation dans le rite traditionnel.
L’attente de cette part vivante et agissante du troupeau parisien sera-t-elle remplie ? Elle est prête en tout cas à faire entendre sa voix. »
Ref. Monseigneur Laurent Ulrich, nouvel archevêque de Paris : pour la paix ou la guerre liturgique ? le dossier brûlant attend le nouvel archevêque…
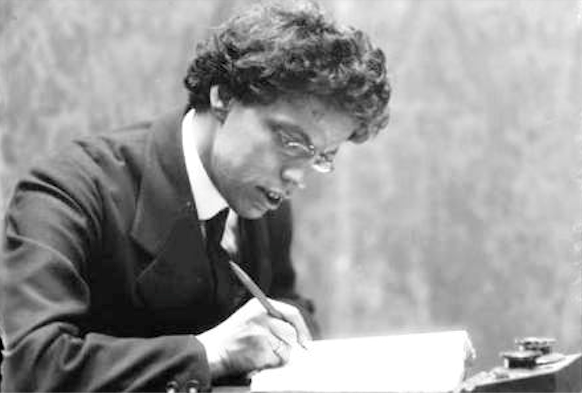
 « La nouvelle est donc tombée : Mgr Laurent Ulrich, 71 ans en septembre, archevêque de Lille, après avoir été archevêque de Chambéry, devient archevêque de Paris, Mgr Aveline, archevêque de Marseille, ayant semble-t-il refusé la charge. Il sera « installé » à Saint-Sulpice le 24 mai.
« La nouvelle est donc tombée : Mgr Laurent Ulrich, 71 ans en septembre, archevêque de Lille, après avoir été archevêque de Chambéry, devient archevêque de Paris, Mgr Aveline, archevêque de Marseille, ayant semble-t-il refusé la charge. Il sera « installé » à Saint-Sulpice le 24 mai.