Le conclave le plus long de l'histoire moderne se déroula en 1740 pour l'élection de Benoît XIV. Il dura du 18 février au 17 août, soit 181 jours. Les électeurs étaient au nombre de 51 à l'ouverture mais 4 cardinaux moururent durant le conclave.
En 1758 le conclave pour l'élection de Clément XIII dura du 15 mai au 6 juillet (53 jours). Il comptait 45 cardinaux électeurs à son ouverture mais lors de la votation finale seuls 44 étaient présents.
L'élection de Clément XIV au conclave de 1769, dura 94 jours, du 15 février au 19 mai et compta 46 électeurs.
Le Pape Pie VI fut élu en un conclave qui se déroula du 5 octobre 1774 au 15 février 1775 (133 jours). Les cardinaux électeurs étaient 44 à l'ouverture, mais deux d'entre eux moururent au cours du conclave.
L'élection de Pie VII eut lieu à Venise, Rome étant occupée par les troupes françaises. Le conclave dura du 1 décembre 1799 au 14 mars 1800 (105 jours). Ce fut le dernier conclave en dehors de Rome, auquel participèrent 34 électeurs.
En 1823, le Pape Léon XII fut élu au bout de 27 jours (2 septembre-28 septembre) par 49 cardinaux électeurs.
En 1829, le conclave pour l'élection de Pie VIII dura 36 jours, du 24 février au 31 mars. Il comptait 50 électeurs.
Grégoire XVI fut le dernier cardinal non évêque élu Pape. Le conclave pour son élection dura 51 jours, du 14 décembre 1830 au 2 février 1831, avec 45 cardinaux.
Les conclaves “courts” commencèrent en 1846 avec l'élection de Pie IX (50 cardinaux) à l'issue d'un conclave qui dura 3 jours, du 14 au 16 juin.
En 1878, Léon XIII fut élu après un conclave de 3 jours, du 18 au 20 février, auquel participèrent 61 électeurs. Le Cardinal John McCloskey, archevêque de New York, premier cardinal non européen devant participer au conclave arriva trop tard.
En 1903 fut élu Pie X. Durant le conclave fut exercé pour la dernière fois le Ius Exclusivæ (droit d'exclusion dont disposaient certains monarques catholiques d'Europe pour opposer leur veto à un candidat à la papauté). A cette occasion, ce fut l'empereur François Joseph I d'Autriche qui exerça son veto contre le cardinal italien Mariano Rampolla. Le conclave dura 5 jours du 31 juillet au 4 août. 64 cardinaux électeurs participèrent et il y eut 7 scrutins. Après son élection Pie X abolit le droit de veto.
En 1914 le conclave qui élit Benoît XV dura 4 jours, du 31 août au 4 septembre. Les électeurs étaient 57 et il y eut 10 scrutins. Deux cardinaux nord-américains et un canadien, arrivés trop tard, ne purent entrer dans la Chapelle Sixtine. Cependant, pour la première fois un cardinal d'Amérique latine participa à l'élection.
En 1922, durant le conclave qui élit Pie XI, 2 Américains et 1 Canadien restèrent dehors à nouveau. Une règle fut alors instituée établissant qu'à compter du Siège vacant les cardinaux auraient un délai de 15 jours pour arriver à Rome. Les électeurs étaient au nombre de 53. Le conclave dura 5 jours, du 2 au 6 février et il y eut 7 scrutins.
Le conclave qui élit Pie XII en 1939 connut pour la première fois la participation d'un patriarche de rite oriental. Ce conclave qui fut le plus court, dura deux jours, du 1 au 2 mars. Il compta 62 électeurs et 3 scrutins.
Jean XXIII fut élu en 1958. Pour la première fois, participèrent au conclave des cardinaux chinois, indiens et africains. Il y eut 51 électeurs. Il dura 4 jours, du 25 au 28 octobre, avec 11 scrutins.
En 1963, le conclave dura 3 jours, du 19 au 21 juin, et 80 électeurs y élirent Paul VI après 6 scrutins.
En 1978, le conclave qui élit Jean-Paul I fut le premier auquel ne participèrent pas les cardinaux de plus de 80 ans. Le conclave dura deux jours, du 25 au 26 août, avec 4 scrutins et 111 électeurs.
Lors du second conclave de 1978, du 14 au 16 octobre, (3 jours) 111 électeurs élirent Jean-Paul II au bout de huit scrutins.
En 2005 Benoît XVI fut élu Pape au quatrième scrutin d'un conclave qui dura 2 jours, du 18 au 19 avril et qui compta le plus grand nombre de cardinaux électeurs de l'histoire: 115.
Le conclave qui s'ouvre demain, 12 mars, sera le premier depuis 1829 à avoir lieu en Carême.
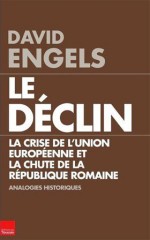 C'est Joseph Savès, sur Herodote.net qui nous donne l'envie de lire un ouvrage dont le compte-rendu met incontestablement en appétit :
C'est Joseph Savès, sur Herodote.net qui nous donne l'envie de lire un ouvrage dont le compte-rendu met incontestablement en appétit :
 On fête aujourd'hui, et c'est de circonstance, la chaire de saint Pierre.
On fête aujourd'hui, et c'est de circonstance, la chaire de saint Pierre.