On nous a reproché vivement d'avoir relayé sur ce blog un article mettant en cause l'attitude de Vatican II à l'égard du communisme que ce concile se serait abstenu de condamner. Nous sommes même accusés de manquer de sens de l'Eglise ("sensus Ecclesiae") et de donner des arguments à ceux qui songent à s'éloigner de l'Eglise.
Il serait donc requis, de la part des catholiques, d'adhérer sans aucune liberté critique à tous les textes de Vatican II ainsi qu'à toutes les prises de position des papes depuis un demi-siècle sous peine d'être considérés comme des gens néfastes alimentant la zizanie et les divisions au sein de l'Eglise. Bref, d'être de bons petits soldats et de nous taire même lorsque notre conscience nous dicte le contraire. Ceux qui nous en intiment l'ordre sont en même temps les premiers à considérer que les libertés de conscience et d'expression sont de grands acquis qu'il faut défendre. Allez comprendre.
Pourtant, à propos de Gaudium et Spes, dont on nous dit qu'il contient (implicitement, mais de manière évidente) une critique sans appel du communisme, Benoît XVI lui-même formule certaines réserves ainsi que le souligne l'historien Philippe Chenaux, peu suspect d'intégrisme :
Benoît XVI était notamment très critique sur Gaudium et Spes. Avec d'autres, il jugeait le texte trop optimiste, trop ouvert, théologiquement faible et ne prenant pas en compte la dimension eschatologique du christianisme : l'espérance du christianisme ne se confond pas avec le progrès technique ou la défense des droits de l'homme, car il porte un message de salut, de vie supranaturelle. Longtemps, discuter de Vatican II a été tabou. Il y avait une position positive du concile, à part chez les intégristes. Ce tabou est levé. Aujourd'hui, des appréciations plus critiques du concile et de ses effets se font jour, notamment dans les milieux conservateurs.
Toujours à propos de Gaudium et Spes, le même historien, professeur d'histoire de l'Eglise moderne et contemporaine à l'Université du Latran (Rome) et directeur d'un centre de recherche sur le concile Vatican II, s'exprime ainsi :
L'un des textes les plus importants et les plus novateurs, Gaudium et Spes, définit les rapports de l'Eglise au monde et lui adresse un message. Il va devenir l'un des axes majeurs du débat conciliaire, alors qu'il n'avait même pas fait l'objet de travaux préparatoires ! C'est le concile qui va créer cette nécessité. Ce texte, d'inspiration française, part des attentes du monde, des "signes des temps". Il faut le resituer dans le contexte des années 1960, marqué par une sorte d'euphorie avec l'émergence de la société de consommation, la conquête de l'espace, les évolutions culturelles... On y retrouve cet optimisme, que certains peuvent aujourd'hui trouver un peu naïf et daté.
La lecture de cette interview donnée par Philippe Chenaux à Stéphanie Le Bars (dans Le Monde du 11 octobre dernier) est d'ailleurs très éclairante, même s'il se positionne de façon très favorable à l'égard dudit concile, sur la complexité face à laquelle se trouve celui qui veut retracer l'histoire de Vatican II, et davantage encore celui qui se risque dans son interprétation.
Quant à nous, il nous semble (est-ce péché que de le dire ?) que, lors du dernier concile, l'Eglise a voulu se mettre au diapason du monde moderne et qu'elle a ainsi donné le signal d'une "revisitation" de sa doctrine et de son mode d'être; de la sorte se sont ouvertes toutes grandes les vannes qui ont donné libre cours à une mentalité réformatrice, provoquant une crise majeure dont on aura bien du mal à se remettre.

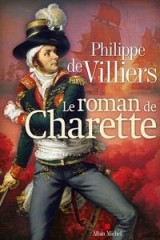 Dans La Libre, sous le titre "En révolte contre la Révolution", Paul Vaute recense un livre de Philippe de Villiers consacré à Charette :
Dans La Libre, sous le titre "En révolte contre la Révolution", Paul Vaute recense un livre de Philippe de Villiers consacré à Charette :