Lu sur lexpress.fr (Christian Makarian) :
La double mort des Chrétiens d'Orient
La morne indifférence qui recouvre le sort des chrétiens d'Orient ne relève pas de la sphère de l'étranger lointain, ni des "dommages collatéraux" inhérents à la vague de destruction qui ravage actuellement le Moyen-Orient, certaines zones de l'Afrique et en partie l'Asie. Elle est le puissant révélateur du malaise nihiliste qui ronge l'Europe.
En dehors de groupes de croyants très motivés, qui effectuent dans l'ingratitude générale un travail de sensibilisation remarquable, la disparition des minorités les plus anciennes du Moyen-Orient ne soulève pas d'émoi particulier au sein d'une opinion publique française par ailleurs prompte à se mobiliser pour d'autres causes bien moins alarmantes. Cherchez bien, vous ne trouverez pas d'artistes de premier plan pour défendre cette cause, point d'acteurs de cinéma prêts à engager leur renommée, ni de stars du rock'n'roll, qu'on a pourtant vu faire campagne pour la protection des Indiens d'Amazonie menacés par la déforestation. En Orient, en fait de déracinement, ce sont des vies humaines que l'on arrache par milliers et un rameau originel que l'on détache à coups de hache de l'arbre généalogique des civilisations.
Pourquoi restons-nous si impavides?
Cette tiédeur devient en elle-même le sujet d'une interrogation plus profonde: hors de toute conviction religieuse, laquelle doit rester le domaine secret de chacun, sommes-nous encore capables de nous indigner contre des massacres, des viols de masse, des persécutions organisées, des rackets érigés en système économique, des enlèvements contre rançon, des vexations, lorsqu'il s'agit de populations qui partagent, non le même environnement culturel mais les mêmes valeurs que les nôtres? Ce qui induit une autre question, bien plus gênante: croyons-nous encore en ces valeurs humanistes pour lesquelles des communautés coupées du monde mettent leur vie en péril, et les trouvons-nous dignes d'être maintenues sur la terre où elles ont vu le jour? La réponse est d'autant plus embarrassante que les minorités chrétiennes d'Orient (mais aussi d'Afrique ou d'Asie) sont attaquées par des bandes d'assassins invariablement enrôlés sous la bannière djihadiste, qui ne voient dans ces survivants que des alliés de la culture occidentale. Par leur sauvagerie, les terroristes visent deux buts principaux. En immolant des innocents ou en les forçant à l'exil, ils veulent atteindre l'Europe comme l'Amérique et démontrer que ces deux continents n'ont plus la capacité de se projeter. Ils cherchent à détruire la riche diversité du monde arabe, laquelle fut à l'origine de l'arabisme (adversaire de l'obscurantisme religieux) et du rêve d'une modernité orientale, pour y imposer une exclusivité islamique - qui n'a jamais existé. Une régression en tout point. Dans Les Désorientés (Grasset), Amin Maalouf écrit qu'un chrétien d'Orient meurt deux fois: la première en tant qu'être humain, la deuxième en tant que membre d'une communauté en voie de disparition.
Il ne s'agit pas d'affirmer que nous devrions être par nature solidaires avec les chrétiens d'Irak, de Syrie, du Nigeria, du Kenya ou du Pakistan au motif que leur religion est toujours celle dont les édifices ornent nos villes et nos villages, mais précisément de se demander pourquoi nous restons si impavides. Dans un livre prenant, qui mêle le vécu et l'analyse, Sébastien de Courtois avance une explication qui nous éclaire: "Cette indifférence est liée à un rejet de notre propre reflet dans le miroir, comme si le fait d'avoir été nous-mêmes chrétiens devait nous interdire de nous intéresser à cette réalité. Avec une vision étroite de la laïcité - ce qu'elle n'était pas à ses débuts [...] -, nous avons jeté le bébé avec l'eau du bain, réservant les questions du "fait religieux à la seule sociologie, puis à la sphère politique, ce qui est pire, le laïcisme devenant à son tour une idéologie de remplacement."
Sur les fleuves de Babylone, nous pleurions. Le crépuscule des chrétiens d'Orient, par Sébastien de Courtois. Stock, 187 p., 18,50€
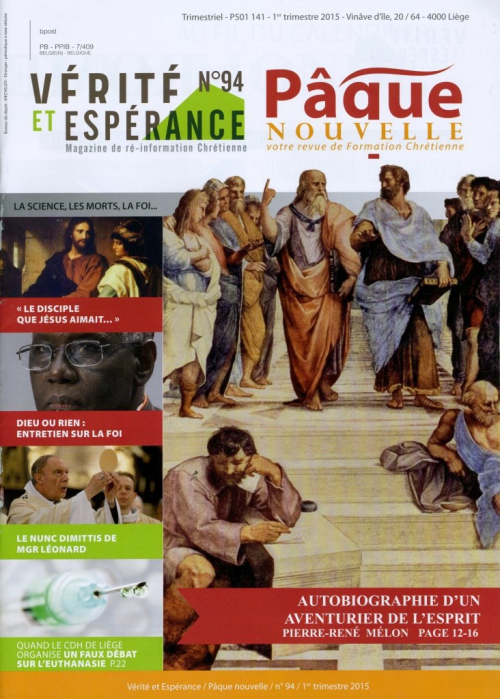


 Qu’arrive-t-il à l’Église ? Qu’arrive-t-il à la foi ? C’est une question que je me pose depuis longtemps. Je vois les jeunes chrétiens si minorisés, mis sous pression de toute part. Le courage de leur foi m’édifie. Depuis que j’ai quitté le séminaire une poignée d’entre eux a rejoint ces serviteurs de l’Évangile que sont les prêtres. Une très petite poignée… Transmettre la foi en famille est devenu un défi, rarement gagné. Il reste bien une certaine place pour la spiritualité, mais on dit que les religions instituées sont en panne. Et elles sont aussi combattues, avec succès : beaucoup rêvent que le cours de religion disparaisse de l’école et ils avancent inexorablement leurs pions. Toujours plus fort chante aux oreilles le message : sans religions le monde serait meilleur.
Qu’arrive-t-il à l’Église ? Qu’arrive-t-il à la foi ? C’est une question que je me pose depuis longtemps. Je vois les jeunes chrétiens si minorisés, mis sous pression de toute part. Le courage de leur foi m’édifie. Depuis que j’ai quitté le séminaire une poignée d’entre eux a rejoint ces serviteurs de l’Évangile que sont les prêtres. Une très petite poignée… Transmettre la foi en famille est devenu un défi, rarement gagné. Il reste bien une certaine place pour la spiritualité, mais on dit que les religions instituées sont en panne. Et elles sont aussi combattues, avec succès : beaucoup rêvent que le cours de religion disparaisse de l’école et ils avancent inexorablement leurs pions. Toujours plus fort chante aux oreilles le message : sans religions le monde serait meilleur. Irak : Un monastère du IVe siècle détruit par Daesh
Irak : Un monastère du IVe siècle détruit par Daesh