Sur zenit.org (Anne Kurian) :
Remettre à l'honneur le mariage et la famille
Catéchèse du 22 avril 2015 (traduction intégrale)
Contre « la récente épidémie de méfiance, de scepticisme, jusqu’à l’hostilité, qui se répand dans notre culture à l’égard d’une alliance entre l’homme et la femme », le pape François exhorte à « remettre à l’honneur le mariage et la famille ».
« La dévalorisation sociale de l’alliance stable et générative de l’homme et de la femme est une perte pour tout le monde », a-t-il déploré lors de la catéchèse qu’il a prononcée ce mercredi matin, 22 avril 2015, place Saint-Pierre. Si nous ne trouvons pas un sursaut de sympathie pour cette alliance, capable de mettre les nouvelles générations à l’abri de la méfiance et de l’indifférence, les enfants viendront au monde de plus en plus déracinés », a-t-il mis en garde.
Il a souligné la beauté de l’aventure du couple : « L’homme trouve la femme, ils se rencontrent et l’homme doit quitter quelque chose pour la trouver pleinement… Cela signifie commencer une nouvelle route. L’homme est tout entier pour la femme et la femme est tout entière pour l’homme. »
A.K.
Catéchèse du pape François
Chers frères et sœurs,
Dans la précédente catéchèse sur la famille, je me suis arrêté sur le premier récit de la création de l’être humain, dans le premier chapitre de la Genèse, où il est écrit : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme » (1,27).
Lire la suite
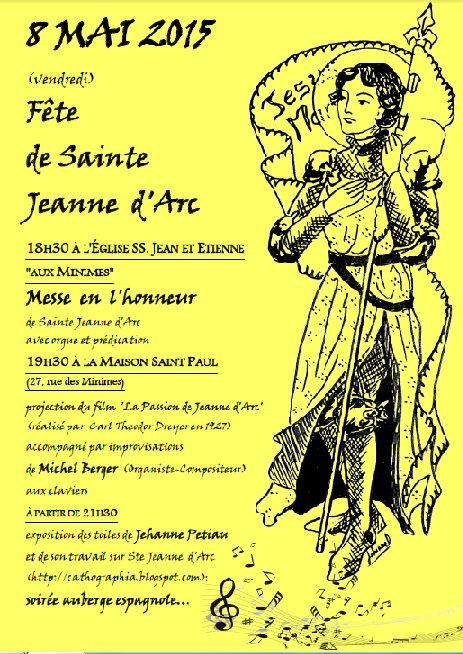
 De
De 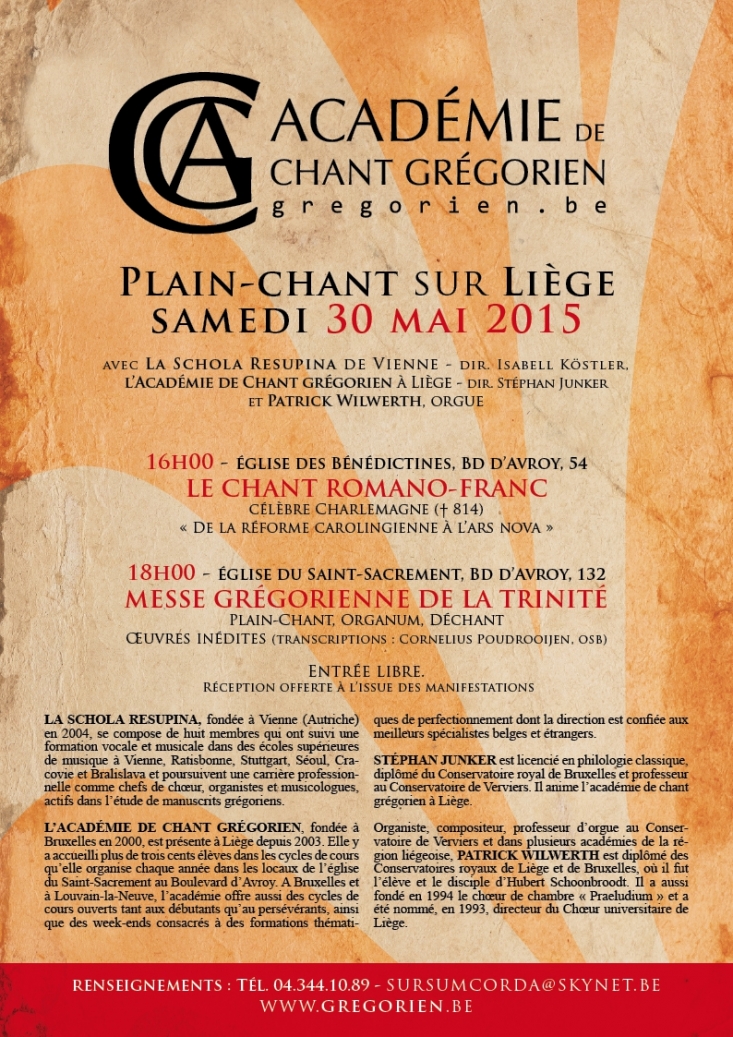
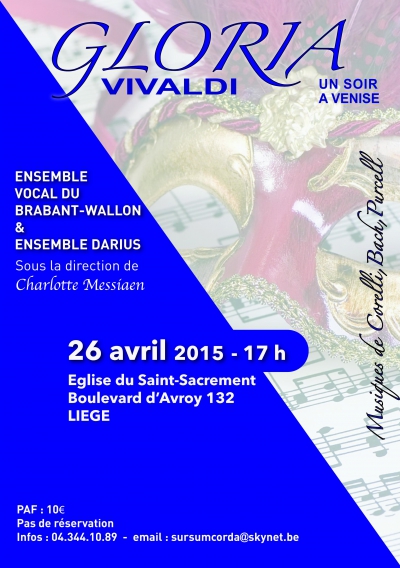


 Les immigrés clandestins en provenance de Libye sont de plus en plus nombreux. Une réalité qui ne manque pas de faire écho au roman de Jean Raspail, "Le camp des saints" (1973), dans lequel l'auteur décrit les conséquences d'une immigration massive (et soudaine) sur la civilisation occidentale. Sur le site « Atlantico », Frédéric Encel (professeur de relations internationales à l’ESG Management School et maître de conférences à Sciences-Po Paris) interroge Maxime Tandonnet (historien, et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, auteur de "
Les immigrés clandestins en provenance de Libye sont de plus en plus nombreux. Une réalité qui ne manque pas de faire écho au roman de Jean Raspail, "Le camp des saints" (1973), dans lequel l'auteur décrit les conséquences d'une immigration massive (et soudaine) sur la civilisation occidentale. Sur le site « Atlantico », Frédéric Encel (professeur de relations internationales à l’ESG Management School et maître de conférences à Sciences-Po Paris) interroge Maxime Tandonnet (historien, et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, auteur de "