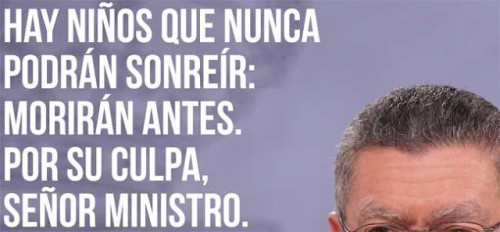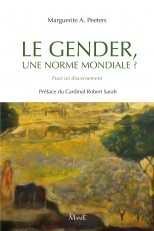Est-ce que cela recommence, comme au bon vieux temps des années conciliaires ? Dans son homélie du vendredi-saint, le prédicateur officiel de la cour pontificale, le bien nommé Père Cantalamessa, s’empresse de ressortir un dique d'archive bien connu :
« Nous devons faire en sorte que l’Eglise ne ressemble jamais à ce château compliqué et encombré décrit par Kafka, et que le message puisse sortir d’elle libre et joyeux comme lorsqu’il a commencé sa course. Nous savons quels sont les empêchements qui peuvent retenir le messager: les murs diviseurs, à commencer par ceux qui séparent les différentes églises chrétiennes entre elles, l’excès de bureaucratie, les restes d’apparats, lois et controverses passées, devenus désormais de simples détritus. [ en italien, "i residui di cerimoniali", les restes des cérémoniaux].Il faut le courage d’abattre tout cela, et de ramener l’édifice à la simplicité et à la linéarité des origines. C’est la mission que reçut un jour un homme qui priait devant le crucifix de Saint Damien : « Va, François, et répare ma maison ».
Et si on commençait alors par abolir l’esprit courtisan ?
Carlota, la collaboratrice de notre consoeur du site « Benoît et moi », partage ici la perplexité de ceux qui s’efforcent de comprendre le nouveau pape et de l’accueillir sereinement (extraits) :
« Je suis actuellement témoin de l’expression de beaucoup d’opinions contraires par rapport au nouveau pape François. Mais je crois que même en Argentine, il ne laissait personne indifférent. J’ai lu un article d’un curé de bidonville de Buenos Ayres parlant de son ex-évêque et qui disait : ou les gens le détestent ou ils l’adorent.
Il est évident que chez les catholiques « non adultes » pour employer le langage de l’adversaire, il y a un énorme désarroi par rapport à l’élection du cardinal Jorge Bergoglio. J’ai même vu le rédacteur d’un blog hispanophone qui est tenu par un honnête homme dans le meilleur sens du terme, qui a pris l’attitude (que je respecte) très espagnole (catholique) de l’auto-flagellation morale : Si Benoît XVI (l’auteur de l’article l’aime beaucoup) est parti c’est que nous n’avons pas pendant son pontificat assez prié pour lui, c’est de notre faute, notre très grande faute…
Il est évident que le Pape François n’a pas le même langage simple et lumineux que Benoît XVI, ni le même caractère et tempérament, et c’est tout à fait normal, ce sont deux hommes différents. Quelle surprise ! Par ailleurs la sur-représentation qui est faite de François pas les médias n’aide pas, pour ceux qui ont une sensibilité plus traditionnelle, à rester très sereins. Mais pourquoi attacher tant d’importance à ce que serait François avant de le voir agir, alors même que nous avons tant critiqué la présentation qui était faite de son prédécesseur par les médias ? Les journaux seraient-ils devenus objectifs et équilibrés au changement de pontificat ? Un miracle à faire enregistrer au Vatican !
Je comprends néanmoins l’inquiétude de certains car leur reviennent à la mémoire toutes les injustices qu’ils ont subies à la grande époque des furieux (certains encore bien vivants) de l’esprit dit conciliaire (un esprit qui faisait bien mal écho à l’étymologie commune d’entente et conciliation) qui voulaient faire commencer l’Église aux années 1960, critiquant au mieux, effaçant au pire tout le reste (une attitude qui correspond bien aux habitudes des régimes totalitaires que certains avaient pour modèle en la personne idéalisée d’un certain Ernesto dit le Che pour sa façon très argentine de s’exprimer!). C’est comme si l’on avait voulu créer un homme nouveau de rien. Alors de penser que ce Pape François pourrait les priver, les catholiques de sensibilité plutôt d’avant le Concile, de tout ce que Benoît a tenté d’apporter, peut entraîner une angoisse qui exclut un minimum de rationalité pour n’être plus que sensations. Il ne faut pas, je crois céder, à cela. Il faut se rappeler combien notre bien aimé Pape désormais émérite nous a dit et redit, martelé même, mais avec une pointe de diamant et pas un marteau piqueur, la double nature de l’homme sans laquelle il n’est pas homme, la raison et la foi, le cœur et l’esprit….
La suite ici : Le pape François et une chanson de Gardel
A priori, nous pensons que ces craintes sont excessives et qu’une clarification pédagogique du fond dissipera, tôt ou tard, les premiers malentendus qui pointent. Le plus vite sera le mieux.
____
(*) Carlos Gardel, chanteur, compositeur de tango naturalisé argentin (1890 ?-1935)