Ca nous vient tout droit du blog Big Browser du Monde et c'est déjà très largement répercuté sur le web :
CQFD – Les religieux sont moins intelligents que les athées, affirme une étude
Les personnes religieuses seraient en moyenne moins "intelligentes" que les non-croyants, selon une synthèse d'études sur le sujet réalisée par des chercheurs de l'université de Rochester, dans l'Etat de New York, rapporte The Independant.
L'équipe dirigée par le Pr Miron Zuckerman a entrepris de se plonger dans les conclusions de soixante-trois études menées depuis 1921 aux Etats-Unis. Il ressort de ce travail de synthèse que cinquante-trois d'entre elles arrivent au même résultat : une "relation négative" entre religiosité et intelligence. The Independant relaye cependant certaines critiques adressées à cette étude, comme le fait que la définition retenue de l'intelligence soit purement analytique et positiviste et en néglige certains aspects comme la créativité et l'intelligence émotionnelle.
CAPACITÉ À RAISONNER
L'étude ne dit pas explicitement que la foi rend idiot, mais elle laisse entendre que les personnes les plus brillantes sont plus enclines à se détourner de la religion, et ce des premières années jusqu'aux âges les plus avancés. (On objectera à cette conclusion que nombre de grands scientifiques, fascinés par la beauté et la complexité du monde, finissent par "croire" en quelque chose, sans pour autant embrasser un dogme religieux). Ni le sexe ni l'éducation n'ont modifié la relation entre religiosité et intelligence, selon les chercheurs.
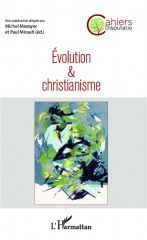 EVOLUTION ET CHRISTIANISME
EVOLUTION ET CHRISTIANISME