Un article de Mgr Charles Chaput, archevêque de Philadelphie, est consacré à la liberté religieuse telle qu'elle a existé aux Etats-Unis depuis les origines et qui constitue à ses yeux un patrimoine dont on peut s'inspirer mais aussi un patrimoine menacé, y compris aux Etats-Unis. L'article est intitulé : "Sujets du Gouverneur de l’Univers".
Il est consultable ici : Charles-J. Chaput, Sujets du Gouverneur de l’Univers , «Oasis» [en ligne], 16 | Décembre 2012, en ligne le 10 janvier 2013.
(...) "Dans son message pour la Journée mondiale de la Paix en 2011, le Pape Benoît XVI a exprimé sa vive inquiétude face à la propagation de la persécution et de la discrimination à l’échelle planétaire, face aux terribles actes de violence et à l’intolérance religieuse [1]. Nous nous trouvons face à une crise mondiale de la liberté religieuse. En qualité d’Évêque catholique, je suis tout naturellement préoccupé par la discrimination et la violence que les minorités chrétiennes sont obligées de supporter. Benoît XVI l’a relevé dans ses observations. Mais les chrétiens ne sont pas les seules victimes. Les chiffres duPew Forum on Religion and Public Lifefont réfléchir. Plus de 70% de la population mondiale vit dans des pays – dont beaucoup sont hélas majoritairement musulmans, mais aussi en Chine et en Corée du Nord – où la liberté religieuse est gravement restreinte [2].
La dignité de la personne humaine, l’inviolabilité de la conscience, la séparation entre l’autorité politique et l’autorité sacrée, la distinction entre le droit séculier et le droit religieux, l’idée d’une société civile préexistant à l’État et distincte de lui : des principes qui, selon les Américains, vont de soi, ne sont pas partagés ailleurs. Comme l’a dit un jour Leszek Kolakowski, ce qui semblait évident aux Pères fondateurs américains « pourrait paraître manifestement faux ou insensé et superstitieux à la plupart des grands hommes qui continuent de façonner l’imaginaire politique [du monde] » [3]. Nous devons nous demander pourquoi il en est ainsi.
Nous devons également nous demander pourquoi nous, Américains, semblons être si satisfaits de nos libertés. En réalité, rien ne garantit que l’expérience américaine relative à la liberté religieuse, telle que nous la connaissons traditionnellement, soit capable de survivre aux États-Unis, avant même de servir de modèle à d’autres pays. La Constitution des États-Unis est un grand résultat en ce qui concerne les dispositions sur la liberté. Cependant, elle restera un simple bout de papier si les citoyens ne l’entretiennent pas par leurs convictions et par leur témoignage vécu.
Et pourtant, au sein des institutions, dans les médias, dans les milieux universitaires, les milieux d’affaires et, plus généralement, dans la culture américaine, il semble que beaucoup de nos dirigeants n’envisagent plus la foi religieuse comme un facteur social sain et positif. C’est une triste tendance que l’on observe à travers l’attitude ambivalente de la Maison Blanche sous Obama face aux nombreuses violations de la liberté religieuse dans le monde, à travers l’incompétence et le désintérêt avec lesquels nos médias rapportent les questions relatives à la liberté religieuse et, très souvent, à travers l’indifférence de beaucoup de citoyens américains ordinaires."
 …Vatican II, of course. Voici comment la docte Commission Théologique Internationale (CTI), instituée par le Saint-Siège en 1969, développe le message conciliaire confronté au paradigme traditionnel : « extra ecclesiam, nulla salus » : hors de l’Eglise point de salut. L’expression est de saint Cyprien de Carthage (IIIe siècle), interprétant en ce sens la double sentence de Jésus à Nicodème, dans l’Evangile selon saint Jean, chapitre 3 : « Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui » (verset 17) ; « mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » (verset 18) :
…Vatican II, of course. Voici comment la docte Commission Théologique Internationale (CTI), instituée par le Saint-Siège en 1969, développe le message conciliaire confronté au paradigme traditionnel : « extra ecclesiam, nulla salus » : hors de l’Eglise point de salut. L’expression est de saint Cyprien de Carthage (IIIe siècle), interprétant en ce sens la double sentence de Jésus à Nicodème, dans l’Evangile selon saint Jean, chapitre 3 : « Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui » (verset 17) ; « mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » (verset 18) :
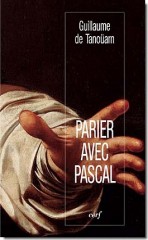 "Parier avec Pascal" est le livre que l'abbé de Tanoüarn vient de publier, dans le but, affirme-t-il, de "f
"Parier avec Pascal" est le livre que l'abbé de Tanoüarn vient de publier, dans le but, affirme-t-il, de "f