Mgr Jurkovic a averti que la base anthropologique de la famille, « sa constitution fondée sur l’engagement mutuel “libre et complet” d’un homme et d’une femme, sa dynamique intergénérationnelle et sa finalité de générer, nourrir et chérir la vie » sont menacées « voire carrément refusée » par des idéologies nouvelles.
Mgr Ivan Jurkovič, observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève (Suisse), est intervenu lors d’un séminaire d’une journée sur « le rôle de la famille dans la protection et la promotion des droits de l’homme des personnes âgées ».
Il a pris la parole sur le thème : « Vers une plus grande protection de la famille et des droits de l’homme des personnes âgées », à Genève, le 11 juin 2018 (panel 4).
Le représentant du Saint-Siège a fait valoir que la famille est « une communauté de personnes », « la cellule fondamentale de la société, où le principe de la solidarité est vécu au quotidien. Par conséquent, afin de défendre les droits humains des individus, la propre identité de la famille doit, de la même manière, être protégée ».
Voici notre traduction de la déclaration de Mgr Jurkovič, faite en anglais.
HG
Déclaration de Mgr Ivan Jurkovič
Monsieur le Président,
Comme l’indique la Déclaration politique de Madrid, nous devons « renforcer la solidarité entre les générations […] en encourageant des relations mutuellement réceptives entre » les personnes âgées et les plus jeunes (1). C’est le rôle unique et irremplaçable de la famille, où se vit « l’amour de tous ses membres – des tout-petits aux aînés » (2).
Ce que les personnes âgées peuvent donner et recevoir de l’environnement familial est au cœur de la vie d’une société florissante où les droits de l’homme sont précieux. De plus, en tant qu’unité naturelle et fondamentale de la société, la famille a droit à la protection de la société et de l’État (3).
Trop souvent, cependant, nous voyons que la base même anthropologique de la famille, sa constitution fondée sur l’engagement mutuel « libre et complet » (4) d’un homme et d’une femme, sa dynamique intergénérationnelle et sa finalité de générer, nourrir et chérir la vie, sont constamment menacées, voire même carrément refusées.
Sans aucune évidence dans la nature ou dans l’histoire, malgré les différences de vie familiale en raison de chaque contexte social, les idéologies nouvelles promeuvent une idée de la famille fondée sur l’hypothèse que la famille ne repose pas sur la raison humaine et l’amour, « comme une forme de simple satisfaction émotionnelle qui peut être construite de n’importe quelle manière ou modifiée à volonté » (5)
Pourtant, une société basée uniquement sur les besoins se transformera inévitablement en une société égoïste, qui n’est certainement pas l’environnement où la vie est accueillie et protégée, surtout quand elle est faible et a besoin d’aide, comme à un âge avancé.
Monsieur le Président,
Le Saint-Siège considère la famille comme une communauté de personnes, comme la cellule fondamentale de la société, où le principe de la solidarité est vécu au quotidien. Par conséquent, afin de défendre les droits humains des individus, la propre identité de la famille doit, de la même manière, être protégée.
La famille, après tout, est, à bien des égards, la première école sur la manière d’être humain et le centre et le cœur d’une « civilisation de l’amour » (6).
Merci, Monsieur le Président.
***
NOTES
- Deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement, Madrid, Espagne, 8-12 avril 2002, Déclaration politique, article 16.
- Pape François, Lettre encyclique, Amoris Laetitia, n. 88
- Cf. Déclaration universelle des droits de l’homme, Art. 16,3.
- Déclaration universelle des droits de l’homme, Art. 16,2.
- Pape François, Lettre encyclique, Evangelii Gaudium, n. 66.
- Pape Paul VI, Message pour la Journée mondiale de la Paix, 1er janvier 1977.

 Ref.
Ref.  Le président de la République Française sera reçu en audience à Rome par le pape François mardi prochain 26 juin. Il prendra aussi possession de son titre de chanoine honoraire de la Basilique Saint-Jean de Latran, selon une tradition qui remonte au roi Henri IV. Mais quels peuvent être l’intérêt et l’enjeu réels de cette visite ? Un jeune homme aussi pressé qu’Emmanuel Macron ne se déplace pas pour accorder du temps à un simple rite protocolaire.
Le président de la République Française sera reçu en audience à Rome par le pape François mardi prochain 26 juin. Il prendra aussi possession de son titre de chanoine honoraire de la Basilique Saint-Jean de Latran, selon une tradition qui remonte au roi Henri IV. Mais quels peuvent être l’intérêt et l’enjeu réels de cette visite ? Un jeune homme aussi pressé qu’Emmanuel Macron ne se déplace pas pour accorder du temps à un simple rite protocolaire.
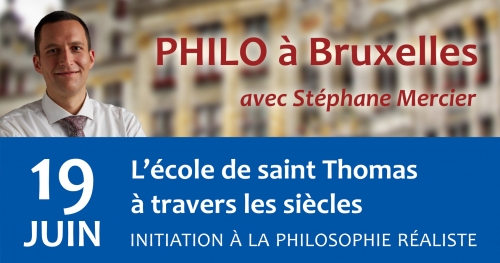
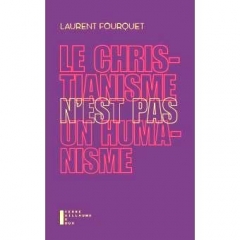 « Il y a deux semaines, les trois quarts des professeurs – soutenus par de nombreux parents – du collège Sainte-Marie à Meaux se sont mis en grève durant une heure et ont fait signer une pétition de défiance parce que figurait parmi les candidats à la direction de cette école catholique, pour l’année prochaine, une personne parfaitement compétente mais membre de l’Opus Dei, ce qui à leurs yeux contrevenait aux « valeurs humanistes » de l’établissement (cf. Le Parisien, 4 juin 2018). Il faudrait leur faire lire Laurent Fourquet…
« Il y a deux semaines, les trois quarts des professeurs – soutenus par de nombreux parents – du collège Sainte-Marie à Meaux se sont mis en grève durant une heure et ont fait signer une pétition de défiance parce que figurait parmi les candidats à la direction de cette école catholique, pour l’année prochaine, une personne parfaitement compétente mais membre de l’Opus Dei, ce qui à leurs yeux contrevenait aux « valeurs humanistes » de l’établissement (cf. Le Parisien, 4 juin 2018). Il faudrait leur faire lire Laurent Fourquet…