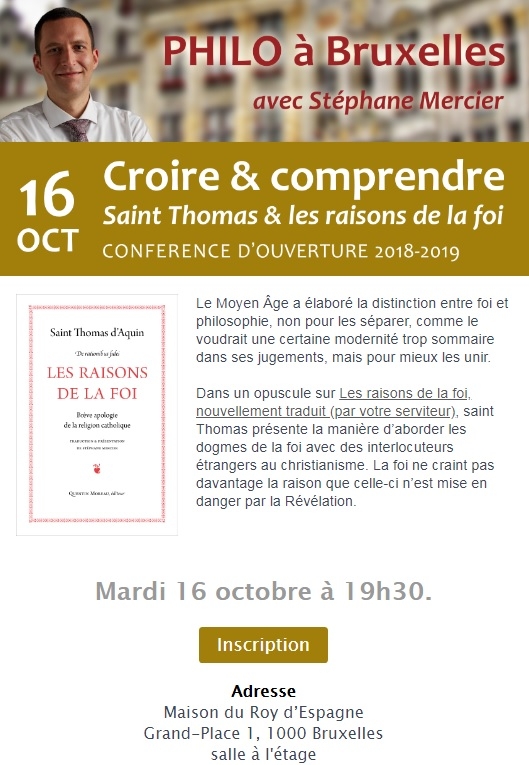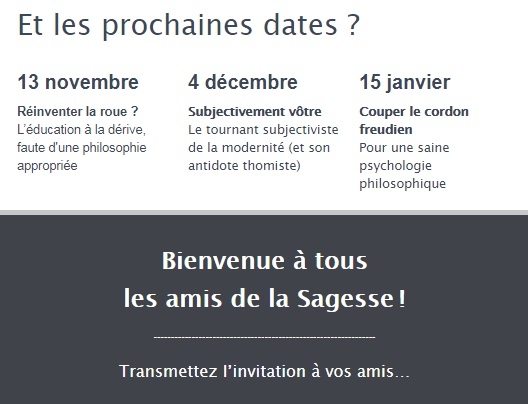De Clémentine Jallais sur le site Réinformation TV :
« Vive le latin – histoires et beauté d’une langue inutile » : Nicola Gardini
Des humanités, on ne sait encore quel sort leur sera fait pour le bac mouture 2021 – Jean-Michel Blanquer vient de leur promettre un « traitement de faveur », mais qu’aucun texte, encore, n’atteste. « Mais alors, à quoi me serviront ces cours ?! » me demande ma fille, désabusée, matheuse qui plus est, voyant s’enfuir les prometteuses options de latin et de grec… Pour cela, il faut lire l’ouvrage de Nicola Gardini, « Vive le latin – histoires et beauté d’une langue inutile ». Un livre qui fait fureur par-delà les Alpes, au pays de Cicéron et que les éditions de Fallois sont allés chercher et traduire, à juste titre.
Alors, bien sûr, c’est un Italien qui parle, qui raconte des amours et des enchantements tout personnels… Mais la portée en est universelle. Car « sous le jardin de la langue quotidienne, il y [a] le tapis des racines anciennes »… et nous mourrons de ne plus le sentir sous la langue et dans la tête ! Et puis Gardini est tout sauf un vieux professeur perdu dans son époque. Il est de son temps – et c’est pour ça qu’il est arrivé au latin.
« Un essai sur la beauté du latin » Nicola Gardini
Ils sont là, juste derrière. Ils sont toute notre culture – l’essence de l’intelligence humaine parvenue à une apogée certaine. L’ouvrage de Nicola Gardini est à la fois un éloge et une défense du latin et de toute la littérature composée dans cette langue qui s’étale sur des siècles et sous la plume d’une quantité d’auteurs.
Parce qu’aujourd’hui l’offensive est systématique dans tous les programme scolaires et ailleurs. Et que ce doit être une préoccupation pour tous, pas seulement pour les latinistes. Car nous sommes tous nés de cette culture et de cette histoire. Notre pensée et même nos sentiments occidentaux sont pétris de latinité. « La civilisation de la parole humaine et la foi dans les possibilités du langage n’ont pas de monument plus imposant que le latin ».
Il n’en reste que des bribes ? Suffisamment pour y passer une vie ! Un peu de « conscience historique », que diable ! Sa connaissance « ou au moins, écrit Gardini, le sentiment de ce qui lui est propre » est plus que jamais nécessaire.
« Des voix encore parfaitement nettes » : pourquoi le latin est tout sauf une langue morte
Il y a bon nombre d’arguments sur la vertu linguistique du latin, des résonances étymologiques à la détermination méthodique des structures syntaxiques… Mais s’ils sont vrais, ils ne suffisent guère à Gardini, qui veut parler beauté et beauté vivante, parce qu’éminemment parlante.
« C’est une vieille habitude d’accoler au latin (et au grec ancien) la métaphore disgracieuse et vague de langue morte ; bien au contraire, le latin est vivant parce qu’il nous parle, parce qu’il y a des textes d’une étonnante force expressive écrits dans cette langue, d’une influence considérable au cours de nombreux siècles, qui continuent à nous dire des choses importantes sur le sens de la vie et de la société (…) »
Rien d’abstrait, de fait, dans cet ouvrage où l’auteur se promène, avec légèreté et profondeur tout à la fois parmi ces grands auteurs qui ont galvanisé ses passions, jeunes ou plus tardives. On passe de Catulle à Lucrèce, de Térence à Cicéron, sans bien sûr oublier le « charme », le « réconfort », la « lumière » de Virgile, les « leçons de bonheur » de Sénèque ou la ferveur convaincante de Saint Augustin… et Horace et son fameux « ut pictura poesis » !
Il butine avec amour à travers les siècles, soulignant la perfection poétique d’un mot ou l’ironie cinglante d’un adynaton (une figure de style que j’avais bien oubliée). L’émerveillement du lycéen qu’il fut, devant ce pouvoir « de l’expression en tant que telle » demeure celui de l’écrivain qu’il est devenu. Tous nos auteurs européens n’y ont-ils pas puisé ? Dante aurait-il écrit sa Divine Comédie sans la précieuse ascendance des Métamorphoses ovidiennes… ?
Vive le latin – histoires et beauté d’une langue inutile : « reprenons tout à partir du latin » !
S’érige plus que jamais cette prétention moderne de tout rapporter à soi. « Les Anciens nous parlent d’eux. Et nous, en apprenant qui ils sont, nous apprenons, en substance, à parler de nous-mêmes ; nous devenons, pour ainsi dire, un tout petit peu des Anciens, nous aussi, plutôt que de prétendre qu’ils deviennent eux, des modernes. »
Plus que jamais s’érige aussi cette prétention moderne d’auréoler toute connaissance du sordide épithète de pragmatique, « la transposition immédiate du savoir sous la forme de quelque service pratique »… Quid de la mémoire, de l’imagination, de la créativité ?! Quid de la « libertas », mot phare de Cicéron ? Quid, surtout, des grandes questions de l’existence : « Où vais-je ?… », « Qui suis-je ? » « Quiconque étudie le latin doit l’étudier pour une raison fondamentale (…) Parce que c’est en en latin qu’ont été écrit les secrets de notre identité la plus profonde et que, ces secrets, l’on veut les déchiffrer. »
Seulement le goût décline cruellement, écrit Gardini… et l’on cherche à convaincre les esprits que le bien-être matériel est l’unique source de bonheur – et d’éducation.
« Le mort ou le moribond, c’est celui qui n’écoute pas, non celui qui parle »
La vie est pourtant plus vivante à mesure qu’elle se nourrit du passé. Tout ce monde antique, resté accessible par l’écriture, ne doit pas être enterré, sous peine que nous le soyons nous-mêmes. Des nains sur des épaules de géants, disait Victor Hugo ! « L’histoire de nos vies n’est qu’une fraction de l’Histoire » dit encore Gardini, qui cite avec bonheur Pagnol en guise d’envoi, ce grand amoureux de Virgile.
L’offensive est là, comme une évidence choquante. Est cité en exergue d’un des chapitres le grand archéologue et historien de l’art italien, Salvatore Settis : « La marginalisation radicale des études classiques dans la culture générale et les systèmes scolaires est un processus de profonde mutation culturelle que nous ne pouvons en aucune façon ignorer…. »
Une mutation qui ne se fait pas incidemment. Moins l’homme peut réfléchir par lui-même et avoir conscience de son identité, mieux c’est.
Clémentine Jallais
Vive le latin – histoires et beauté d’une langue inutile, Nicola Gardini ; éditions de Fallois ; 278 p
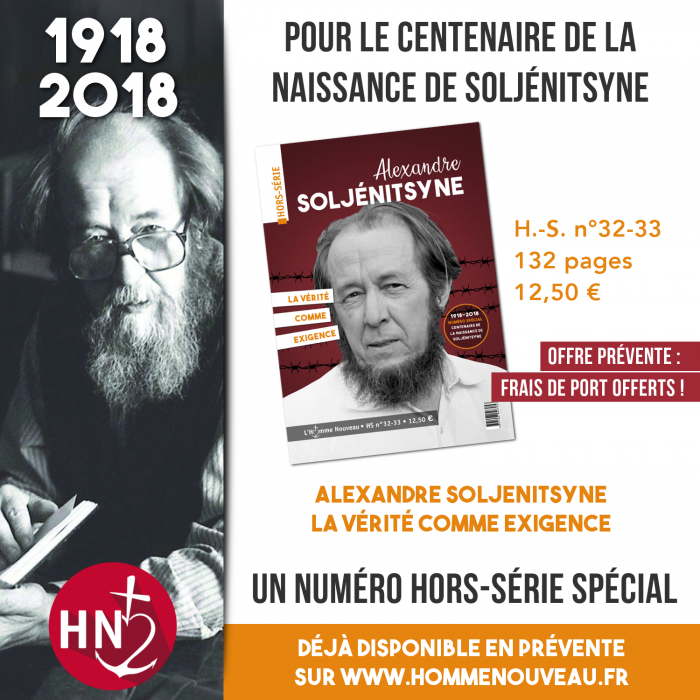

 Sur le site web de "L'Homme Nouveau": après leur
Sur le site web de "L'Homme Nouveau": après leur 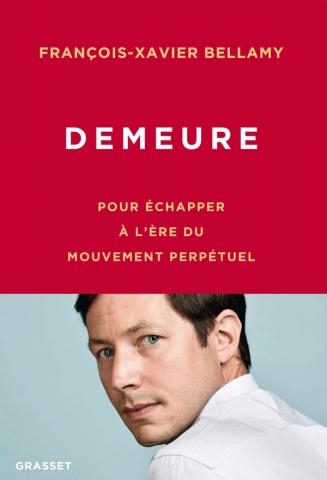 "LA PERTE DU MONDE ET DE LA RÉALITÉ DE NOS VIES"
"LA PERTE DU MONDE ET DE LA RÉALITÉ DE NOS VIES"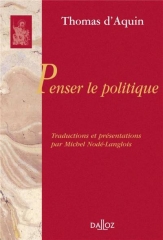 Penser le politique
Penser le politique