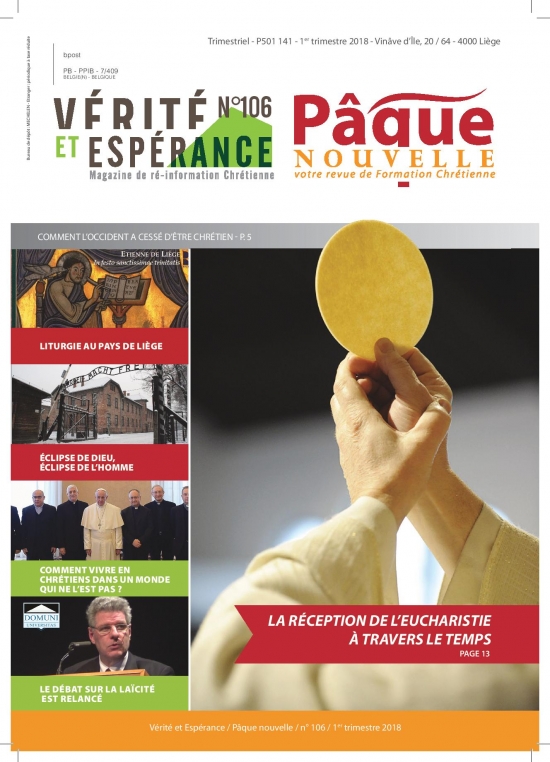A maintes reprises déjà, sur des thèmes sensibles de la discipline, de la morale ou de la foi même de l’Eglise, le pape actuel s’est entretenu avec le fondateur du quotidien La Reppublica, Eugenio Scalfari. Celui-ci en a chaque fois publié dans son journal à grand tirage des comptes rendus hétérodoxes qui ont été inlassablement contestés par des responsables de la communication du Saint-Siège.
Vendredi dernier nous avons fait écho ici : Existence de l'enfer : quand l'interviewer favori du pape déforme ses propos à la dernière récidive du genre concernant la réalité de l’enfer.
Le bon sens pose alors la question de savoir pourquoi le pape régnant s’obstine à confier sa pensée à un interlocuteur qui n’aurait apparemment rien de mieux à faire qu’à la déformer en s’adressant à un vaste public. Les plus indulgents attribueront cette manière de faire à la naïveté du pape et les plus sceptiques à une forme de duplicité, de double langage : la parole de Scalfari contre celle des services d’information du Vatican .
Au sujet des propos du pape sur l'enfer rapportés par Scalfari, un religieux de nos amis lecteurs se demande s’il ne serait pas opportun « que le pape, lors d'une prochaine catéchèse du mercredi, nous fasse connaître son enseignement sur ce mystère. Il aurait sans doute, en tant que familier des exercices de saint Ignace, des choses intéressantes à dire. Et surtout, une parole prononcée en public, ferait disparaître toutes les perplexités suscitées par un journaliste qui rapporte à sa manière ce que le pape lui a dit en privé »
A propos de l'enfer, dans l’encyclique « Spe Salvi » (30 novembre 2007), son prédécesseur Benoît XVI écrivait ceci : « Il peut y avoir des personnes qui ont détruit totalement en elles le désir de la vérité et la disponibilité à l'amour. Des personnes en qui tout est devenu mensonge; des personnes qui ont vécu pour la haine et qui en elles-mêmes ont piétiné l'amour. C'est une perspective terrible, mais certains personnages de notre histoire laissent entrevoir de façon effroyable des profils de ce genre. Dans de semblables individus, il n'y aurait plus rien de remédiable et la destruction du bien serait irrévocable: c'est cela qu'on indique par le mot « enfer ».
Sans entrer dans des questions un peu vaines de savoir si l’enfer est un lieu ou un état, le pontife régnant pourrait toujours remettre au diapason du grand public les développements que le pape Ratzinger consacrait à cette grave question du mystère de la grâce et de la justice divines. Voici un extrait significatif de cette pensée audacieuse qui ne conteste cependant pas la possibilité de la damnation éternelle ni l'éternité de l'âme :
« 43. […] La grâce n'exclut pas la justice. Elle ne change pas le tort en droit. Ce n'est pas une éponge qui efface tout, de sorte que tout ce qui s'est fait sur la terre finisse par avoir toujours la même valeur. Par exemple, dans son roman « Les frères Karamazov », Dostoïevski a protesté avec raison contre une telle typologie du ciel et de la grâce. À la fin, au banquet éternel, les méchants ne siégeront pas indistinctement à table à côté des victimes, comme si rien ne s'était passé. Je voudrais sur ce point citer un texte de Platon qui exprime un pressentiment du juste jugement qui, en grande partie, demeure vrai et salutaire, pour le chrétien aussi. Même avec des images mythologiques, qui cependant rendent la vérité avec une claire évidence, il dit qu'à la fin les âmes seront nues devant le juge. Alors ce qu'elles étaient dans l'histoire ne comptera plus, mais seulement ce qu'elles sont en vérité. « Souvent, mettant la main sur le Grand Roi ou sur quelque autre prince ou dynaste, il constate qu'il n'y a pas une seule partie de saine dans son âme, qu'elle est toute lacérée et ulcérée par les parjures et les injustices [...], que tout est déformé par les mensonges et la vanité, et que rien n'y est droit parce qu'elle a vécu hors de la vérité, que la licence enfin, la mollesse, l'orgueil, l'intempérance de sa conduite l'ont rempli de désordre et de laideur: à cette vue, Rhadamante l'envoie aussitôt déchue de ses droits, dans la prison, pour y subir les peines appropriées [...]; quelquefois, il voit une autre âme, qu'il reconnaît comme ayant vécu saintement dans le commerce de la vérité. [...] Il en admire la beauté et l'envoie aux îles des Bienheureux ». Dans la parabole du riche bon vivant et du pauvre Lazare (cf. Lc 16, 19-31), Jésus nous a présenté en avertissement l'image d'une telle âme ravagée par l'arrogance et par l'opulence, qui a créé elle-même un fossé infranchissable entre elle et le pauvre; le fossé de l'enfermement dans les plaisirs matériels; le fossé de l'oubli de l'autre, de l'incapacité d’aimer, qui se transforme maintenant en une soif ardente et désormais irrémédiable. Nous devons relever ici que Jésus dans cette parabole ne parle pas du destin définitif après le Jugement universel, mais il reprend une conception qui se trouve, entre autre, dans le judaïsme ancien, à savoir la conception d'une condition intermédiaire entre mort et résurrection, un état dans lequel la sentence dernière manque encore.
44.Cette idée vétéro-juive de la condition intermédiaire inclut l'idée que les âmes ne se trouvent pas simplement dans une sorte de détention provisoire, mais subissent déjà une punition, comme le montre la parabole du riche bon vivant, ou au contraire jouissent déjà de formes provisoires de béatitude. Et enfin il y a aussi l'idée que, dans cet état, sont possibles des purifications et des guérisons qui rendent l'âme mûre pour la communion avec Dieu. L'Église primitive a repris ces conceptions, à partir desquelles ensuite, dans l'Église occidentale, s'est développée petit à petit la doctrine du purgatoire. Nous n'avons pas besoin de faire ici un examen des chemins historiques compliqués de ce développement; demandons-nous seulement de quoi il s'agit réellement. Avec la mort, le choix de vie fait par l'homme devient définitif – sa vie est devant le Juge. Son choix, qui au cours de toute sa vie a pris forme, peut avoir diverses caractéristiques. Il peut y avoir des personnes qui ont détruit totalement en elles le désir de la vérité et la disponibilité à l'amour. Des personnes en qui tout est devenu mensonge; des personnes qui ont vécu pour la haine et qui en elles-mêmes ont piétiné l'amour. C'est une perspective terrible, mais certains personnages de notre histoire laissent entrevoir de façon effroyable des profils de ce genre. Dans de semblables individus, il n'y aurait plus rien de remédiable et la destruction du bien serait irrévocable: c'est cela qu'on indique par le mot « enfer ». D'autre part, il peut y avoir des personnes très pures, qui se sont laissées entièrement pénétrer par Dieu et qui, par conséquent, sont totalement ouvertes au prochain – personnes dont la communion avec Dieu oriente dès maintenant l'être tout entier et dont le fait d'aller vers Dieu conduit seulement à l'accomplissement de ce qu'elles sont désormais.
45. Selon nos expériences, cependant, ni un cas ni l'autre ne sont la normalité dans l'existence humaine. Chez la plupart des hommes – comme nous pouvons le penser – demeure présente au plus profond de leur être une ultime ouverture intérieure pour la vérité, pour l'amour, pour Dieu. Mais, dans les choix concrets de vie, elle est recouverte depuis toujours de nouveaux compromis avec le mal – beaucoup de saleté recouvre la pureté, dont cependant la soif demeure et qui, malgré cela, émerge toujours de nouveau de toute la bassesse et demeure présente dans l'âme. Qu'advient-il de tels individus lorsqu'ils comparaissent devant le juge? Toutes les choses sales qu'ils ont accumulées dans leur vie deviendront-elles d'un coup insignifiantes ? Ou qu'arrivera-t-il d'autre? Dans la Première lettre aux Corinthiens, saint Paul nous donne une idée de l'impact différent du jugement de Dieu sur l'homme selon son état. Il le fait avec des images qui veulent en quelque sorte exprimer l'invisible, sans que nous puissions transformer ces images en concepts – simplement parce que nous ne pouvons pas jeter un regard dans le monde d’au delà de la mort et parce que nous n'en avons aucune expérience. Paul dit avant tout de l'expérience chrétienne qu'elle est construite sur un fondement commun: Jésus Christ. Ce fondement résiste. Si nous sommes demeurés fermes sur ce fondement et que nous avons construit sur lui notre vie, nous savons que ce fondement ne peut plus être enlevé, pas même dans la mort. Puis Paul continue: « On peut poursuivre la construction avec de l'or, de l'argent ou de la belle pierre, avec du bois, de l'herbe ou du chaume, mais l'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière au jour du jugement. Car cette révélation se fera par le feu, et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si l'ouvrage construit par quelqu'un résiste, celui-là recevra un salaire; s'il est détruit par le feu, il perdra son salaire. Et lui-même sera sauvé, mais comme s'il était passé à travers un feu » (3, 12-15). Dans ce texte, en tout cas, il devient évident que le sauvetage des hommes peut avoir des formes diverses; que certaines choses édifiées peuvent brûler totalement; que pour se sauver il faut traverser soi-même le « feu » afin de devenir définitivement capable de Dieu et de pouvoir prendre place à la table du banquet nuptial éternel.
46. Certains théologiens récents sont de l'avis que le feu qui brûle et en même temps sauve est le Christ lui-même, le Juge et Sauveur. La rencontre avec Lui est l'acte décisif du Jugement. Devant son regard s'évanouit toute fausseté. C'est la rencontre avec Lui qui, en nous brûlant, nous transforme et nous libère pour nous faire devenir vraiment nous-mêmes. Les choses édifiées durant la vie peuvent alors se révéler paille sèche, vantardise vide et s'écrouler. Mais dans la souffrance de cette rencontre, où l'impur et le malsain de notre être nous apparaissent évidents, se trouve le salut. Le regard du Christ, le battement de son cœur nous guérissent grâce à une transformation assurément douloureuse, comme « par le feu ». Cependant, c'est une heureuse souffrance, dans laquelle le saint pouvoir de son amour nous pénètre comme une flamme, nous permettant à la fin d'être totalement nous-mêmes et par là totalement de Dieu. Ainsi se rend évidente aussi la compénétration de la justice et de la grâce: notre façon de vivre n'est pas insignifiante, mais notre saleté ne nous tache pas éternellement, si du moins nous sommes demeurés tendus vers le Christ, vers la vérité et vers l'amour. En fin de compte, cette saleté a déjà été brûlée dans la Passion du Christ. Au moment du Jugement, nous expérimentons et nous accueillons cette domination de son amour sur tout le mal dans le monde et en nous. La souffrance de l'amour devient notre salut et notre joie. Il est clair que la « durée » de cette brûlure qui transforme, nous ne pouvons la calculer avec les mesures chronométriques de ce monde. Le « moment » transformant de cette rencontre échappe au chronométrage terrestre – c'est le temps du cœur, le temps du « passage » à la communion avec Dieu dans le Corps du Christ. Le Jugement de Dieu est espérance, aussi bien parce qu'il est justice que parce qu'il est grâce. S'il était seulement grâce qui rend insignifiant tout ce qui est terrestre, Dieu resterait pour nous un débiteur de la réponse à la question concernant la justice – question décisive pour nous face à l'histoire et face à Dieu lui-même. S'il était pure justice, il ne pourrait être à la fin pour nous tous qu’un motif de peur. L'incarnation de Dieu dans le Christ a tellement lié l'une à l'autre – justice et grâce – que la justice est établie avec fermeté: nous attendons tous notre salut « dans la crainte de Dieu et en tremblant » (Ph 2, 12). Malgré cela, la grâce nous permet à tous d'espérer et d'aller pleins de confiance à la rencontre du Juge que nous connaissons comme notre « avocat » (parakletos) (cf. 1 Jn 2, 1)[…].
JPSC

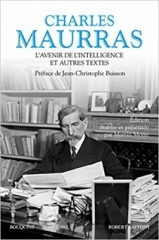 « Né le 20 avril 1868, mort en novembre 1952, le maître de l’Action française avait été inscrit au registre des commémorations nationales. Il était évident que la République française, combattue par Maurras toute sa vie, n’allait pas encenser l’auteur de L’Enquête sur la monarchie ou de Mes idées politiques. Il était peu probable également que le ministre Blanquer ait voulu inscrire au programme des écoles les poèmes maurrassiens ou sa remise en cause du romantisme et de ses conséquences. Encore moins imaginable que sa théorie des « quatre États confédérés » et son « antisémitisme d’État » deviennent, par l’onction d’une célébration, la ligne de conduite de la présidence macronienne.
« Né le 20 avril 1868, mort en novembre 1952, le maître de l’Action française avait été inscrit au registre des commémorations nationales. Il était évident que la République française, combattue par Maurras toute sa vie, n’allait pas encenser l’auteur de L’Enquête sur la monarchie ou de Mes idées politiques. Il était peu probable également que le ministre Blanquer ait voulu inscrire au programme des écoles les poèmes maurrassiens ou sa remise en cause du romantisme et de ses conséquences. Encore moins imaginable que sa théorie des « quatre États confédérés » et son « antisémitisme d’État » deviennent, par l’onction d’une célébration, la ligne de conduite de la présidence macronienne.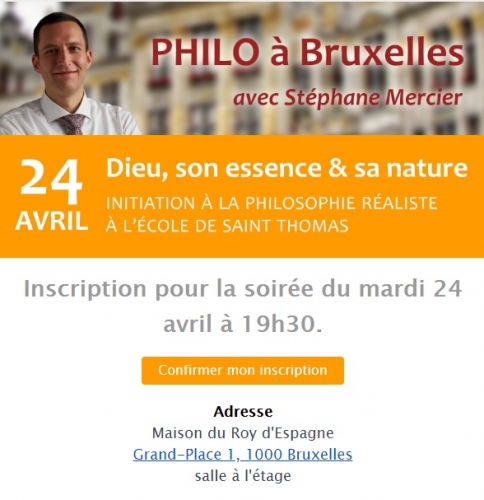

 A l'occasion de la Conférence des évêques de France, lundi 9 avril au soir, Emmanuel Macron a prononcé un discours au ton hasardeux et aux thématiques multiples, dans lequel on retrouve davantage de questions que de réponses. Sur le site web « Atlantico », le point de vue de Bertrand Vergely, philosophe et théologien :
A l'occasion de la Conférence des évêques de France, lundi 9 avril au soir, Emmanuel Macron a prononcé un discours au ton hasardeux et aux thématiques multiples, dans lequel on retrouve davantage de questions que de réponses. Sur le site web « Atlantico », le point de vue de Bertrand Vergely, philosophe et théologien : « L’Église, combien de divisions ? On connaît la célèbre phrase de Staline, bien révélatrice de son matérialisme et de sa volonté hégémonique qui entendait écarter définitivement l’Église de la face du monde. L’Église, combien de divisions ? Mais, beaucoup, aurait-on tendance à répondre aujourd’hui. Et, même, beaucoup trop ! Non plus, cette fois, en référence aux unités blindées ou, plus largement, aux armées auxquelles pensait le maître du Kremlin, mais à celles qui divisent les catholiques entre eux.
« L’Église, combien de divisions ? On connaît la célèbre phrase de Staline, bien révélatrice de son matérialisme et de sa volonté hégémonique qui entendait écarter définitivement l’Église de la face du monde. L’Église, combien de divisions ? Mais, beaucoup, aurait-on tendance à répondre aujourd’hui. Et, même, beaucoup trop ! Non plus, cette fois, en référence aux unités blindées ou, plus largement, aux armées auxquelles pensait le maître du Kremlin, mais à celles qui divisent les catholiques entre eux.