
La multiplication des poursuites, en RDCongo, contre de hauts personnages accusés de détournements de fonds, sème la confusion sur la scène politique. Pour tenter d’y voir plus clair, La Libre Afrique.be a interrogé le politologue Jean Omasombo, professeur à l’Université de Kinshasa et chercheur au Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren (Bruxelles). Entretien avec Marie-France Cros :
"De toutes les inculpations signifiées ces dernières semaines à des figures politiques de la RDCongo, laquelle vous paraît-elle la plus significative?
« Celle de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Tshisekedi. Bien que Joseph Kabila ne l’aime pas depuis leur rupture de 2009, Vital Kamerhe avait, en 2013, offert ses services à celui qui était encore le chef de l’Etat à l’époque, dans le cadre des « Concertations nationales », espérant être nommé Premier ministre. Mais Kabila n’en avait pas voulu et avait reconduit Augustin Matata. En 2015, Kamerhe s’était alors rapproché de Moïse Katumbi, qui venait de prendre ses distances avec Kabila. Mais en juin 2016, lors de la réunion de Genval (Belgique) pour unifier l’opposition, Katumbi avait dribblé Kamerhe en gagnant le soutien de Etienne Tshisekedi, alors que l’élection présidentielle était en vue, soutien que Kamerhe n’était jamais parvenu à obtenir, en particulier en 2011. Mais le Vieux décède en février 2017. Pendant la campagne électorale du dernier trimestre 2018, Kamerhe – que Bemba et Katumbi ne supportent pas – rallie Félix Tshisekedi, plus par faiblesse et opportunisme que par conviction. Avec ce dernier, il va signer, à Nairobi, un accord qui éloignait le duo du reste de l’opposition et prévoyait qu’à la prochaine campagne pour une présidentielle Tshisekedi soutiendrait Kamerhe pour la magistrature suprême. Kamerhe a donc fait élire Joseph Kabila en 2006 et permis de nouer le deal Kabila-Tshisekedi de 2018, hissant ce dernier à la Présidence. C’est un faiseur de roi. Mais je doute qu’il soit jamais roi lui-même. C’est un architecte politique bon joueur, intelligent et opportuniste certes, mais il a peu de chance d’atteindre le sommet du pouvoir (Premier ministre ou chef de l’Etat) parce qu’il est défavorisé par son manque de base politique conséquente. »
Si les poursuites judiciaires à son encontre devaient aboutir à une condamnation, quelles en seraient les conséquences politiques?
« Le « lynchage » public de Kamerhe me semble être décidé à la fois par Kabila et Tshisekedi. On irait vers sa mort politique. Car, même si tous puisent impunément dans les caisses de l’Etat, avec une telle condamnation Kamerhe deviendrait un voleur attitré. Son effacement libère deux espaces : a) il consacre la mort de CASH (NDLR: alliance UDPS et UNC, le parti de Kamerhe) et l’UDPS, que l’omniprésence de Kamerhe indispose, va occuper seule l’étroit couloir de pouvoir jusque-là laissé par le camp Kabila ; b) Félix Tshisekedi, qui passe aux yeux de tous pour l’élève de Kamerhe, ne disposerait désormais plus que de sa « ceinture ethnique » (dont sa troupe de militants de rue) comme bouclier; il se fragilise puisqu’il est désormais placé directement face à Joseph Kabila. Sans capacité de déséquilibrer l’armature du camp kabiliste, qui l’étouffe, Tshisekedi fait figure de prochaine proie d’un Joseph Kabila impatient de regagner au plus vite son poste. »

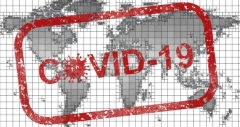 La pandémie de Covid-19 (coronavirus) pousse à s’interroger : comment Dieu peut-il permettre de telles calamités ? La présence du mal, en effet, est l’un des arguments le plus souvent avancés pour refuser l’existence de Dieu. Aucune réponse n’est totalement satisfaisante si l’on n’admet pas une part de mystère. De Paul Clavier sur le site web du mensuel « La Nef » :
La pandémie de Covid-19 (coronavirus) pousse à s’interroger : comment Dieu peut-il permettre de telles calamités ? La présence du mal, en effet, est l’un des arguments le plus souvent avancés pour refuser l’existence de Dieu. Aucune réponse n’est totalement satisfaisante si l’on n’admet pas une part de mystère. De Paul Clavier sur le site web du mensuel « La Nef » : Dans les temps inédits où l’on se calfeutre pour éviter la propagation du coronavirus, Emmanuel Hussenet, auteur de Robinson des glaces, explorateur passionné des banquises et philosophe, donne son témoignage à Théophane Leroux pour les lecteurs du magazine « Famille Chrétienne » :
Dans les temps inédits où l’on se calfeutre pour éviter la propagation du coronavirus, Emmanuel Hussenet, auteur de Robinson des glaces, explorateur passionné des banquises et philosophe, donne son témoignage à Théophane Leroux pour les lecteurs du magazine « Famille Chrétienne » :

