 Selon I.Media le pape François a décidé de consacrer le mois de mai à un "marathon de prière" afin de demander à Dieu la fin de la pandémie, a annoncé le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation (21 avril) :
Selon I.Media le pape François a décidé de consacrer le mois de mai à un "marathon de prière" afin de demander à Dieu la fin de la pandémie, a annoncé le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation (21 avril) :
« Face à la pandémie de Covid-19, le pape François sort l’artillerie lourde. Il a décidé de consacrer le mois de mai, mois de Marie, à un marathon de prière afin de demander à Dieu la fin de la pandémie, a annoncé le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation ce 21 avril. Le thème choisi par le pontife, « La prière à Dieu montait sans cesse de toute l’Église » (Ac, 12,5), sera le fil rouge de l’initiative qui devrait impliquer une trentaine de sanctuaires du monde entier.
L’initiative les encourage à promouvoir la récitation du chapelet auprès des fidèles, des familles et des communautés. Le pape François ouvrira en personne cette chaîne de prière le 1er mai et la conclura le 31 mai.
Un thème symboliquement fort
Le verset retenu par le pape François pour ce marathon de prière – « La prière à Dieu montait sans cesse de toute l’Église » – est issu des Actes des apôtres. Ce livre du Nouveau Testament raconte les débuts de la communauté chrétienne après la résurrection du Christ et son ascension au Ciel.
L’extrait choisi intervient alors que l’apôtre Pierre vient de se faire arrêter par le roi Hérode Agrippa. Le récit rapporte que tous les membres de la communauté chrétienne se mettent alors à prier pour lui. Et, la nuit précédant sa comparution, Pierre, qui était pourtant enchaîné et surveillé par deux soldats, est délivré par un ange ; preuve, pour l’Église, que la prière peut délivrer les hommes des pires turpitudes.
Lire aussi :Joseph en mars, Marie en mai… à chaque mois de l’année, sa dévotion particulière
Le mois de mai est traditionnellement consacré à la Vierge Marie. À cette occasion, l’intercession de la Mère du Christ est souvent demandée en récitant la prière mariale du chapelet.
L’an passé, le pape François avait aussi dédié ce mois de prière à la fin de la pandémie. Le 30 mai 2020, il avait dirigé la prière du chapelet devant la reproduction de la grotte de Lourdes des jardins du Vatican, en communion avec de nombreux sanctuaires mariaux du monde entier. »
Ref. le pape François lance un marathon de prière pour en finir avec la pandémie
Lire aussi :Une prière pour les 100.000 morts du Covid-19 en France
On cherche une initiative belge similaire pour les 24.000 personnes qui ont succombé à ce jour dans notre pays.
JPSC
 Le débat euthanasique n’a hélas plus cours en Belgique : le pire est advenu et l’opinion inerte est chloroformée depuis longtemps déjà. Il n’en va pas encore de même en France. Entre autres, l’écrivain Houellebecq démontait, voici peu, la manipulation du discours publicitaire euthanasique avec l’objection retentissante d’un seul mot : la morphine. Oui, mais encore ? L’absence de douleur ne donne pas nécessairement un sens à la vie. Voici un commentaire D’Henri Quantin, lu sur le site web « aleteia » (21 avril 2021) :
Le débat euthanasique n’a hélas plus cours en Belgique : le pire est advenu et l’opinion inerte est chloroformée depuis longtemps déjà. Il n’en va pas encore de même en France. Entre autres, l’écrivain Houellebecq démontait, voici peu, la manipulation du discours publicitaire euthanasique avec l’objection retentissante d’un seul mot : la morphine. Oui, mais encore ? L’absence de douleur ne donne pas nécessairement un sens à la vie. Voici un commentaire D’Henri Quantin, lu sur le site web « aleteia » (21 avril 2021) :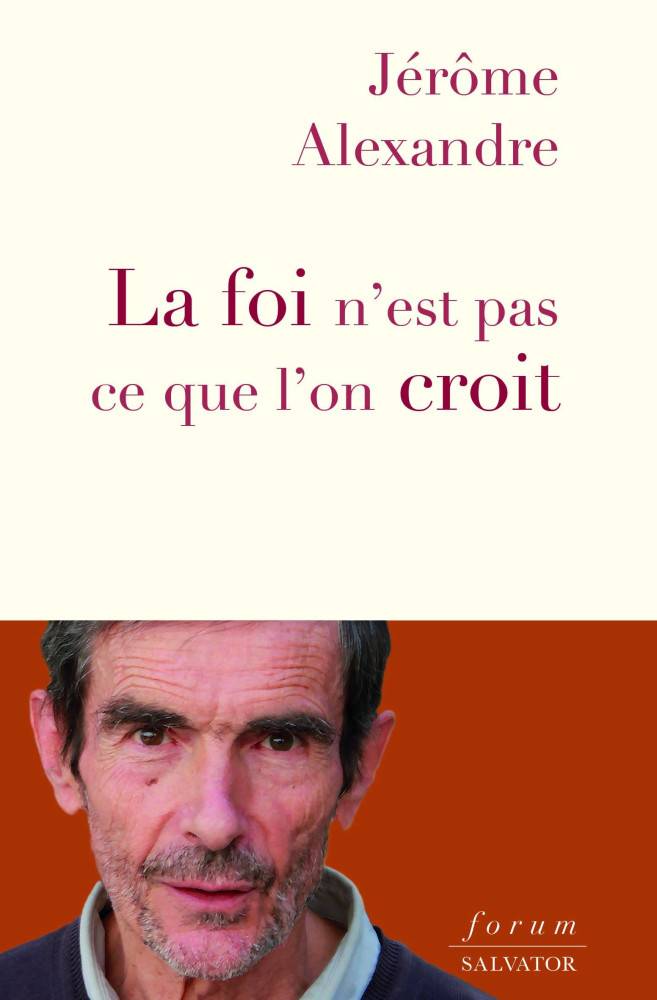
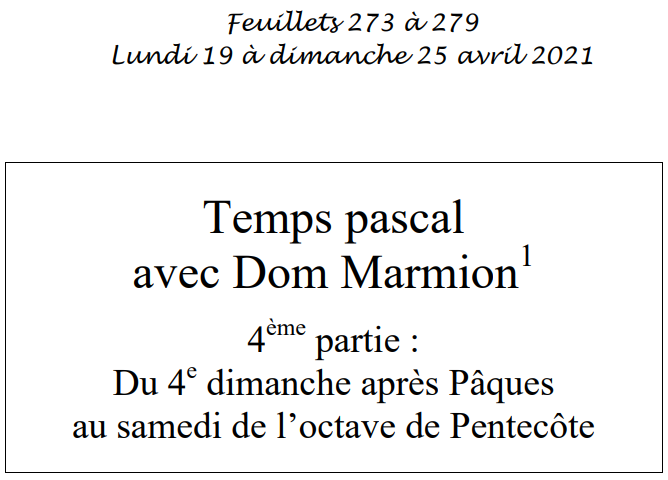

 Faut-il alors s’étonner que le Collège des Jésuites (« Alfajiri » plus de 2500 élèves) de cette ville congolaise ait aussi une section latine et que la devise de ce vaste établissement s’intitule « Stella Duce » en l’honneur de la Vierge Marie (Notre-Dame de la Victoire) : l’étoile qui pilote ce grand navire ancré sur la presqu’île de Nya-Lukemba ?
Faut-il alors s’étonner que le Collège des Jésuites (« Alfajiri » plus de 2500 élèves) de cette ville congolaise ait aussi une section latine et que la devise de ce vaste établissement s’intitule « Stella Duce » en l’honneur de la Vierge Marie (Notre-Dame de la Victoire) : l’étoile qui pilote ce grand navire ancré sur la presqu’île de Nya-Lukemba ?


