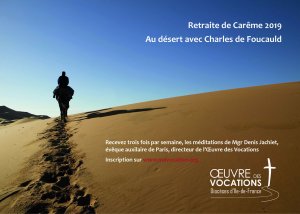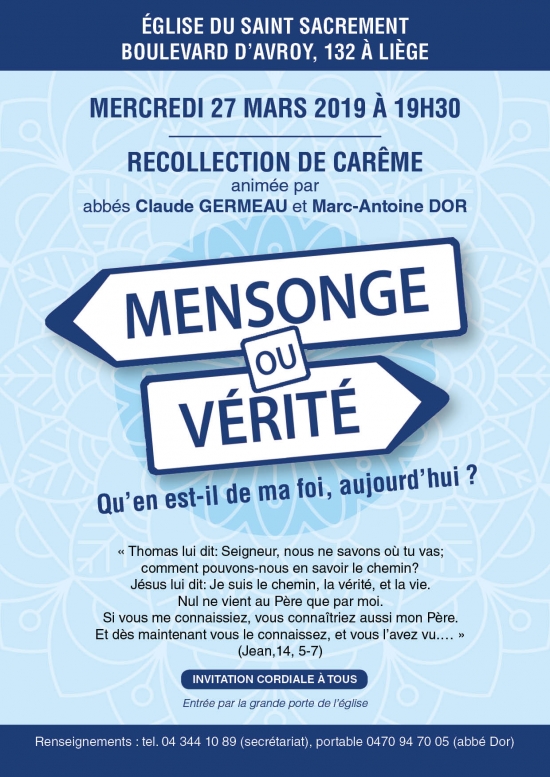A la Basilique romaine de Sainte-Sabine pour la messe et l’imposition des cendres :
 « Sonnez du cor, prescrivez un jeûne sacré » (Jl 2, 15), dit le prophète dans la Première Lecture. Le Carême s’ouvre avec un son strident, celui d’une corne qui ne caresse pas les oreilles, mais organise un jeûne. C’est un son puissant, qui veut ralentir notre vie qui va toujours au pas de course, mais souvent ne sait pas bien où. C’est un appel à s’arrêter - un arrête-toi - , à aller à l’essentiel, à jeûner du superflu qui distrait. C’est un réveil pour l’âme.
« Sonnez du cor, prescrivez un jeûne sacré » (Jl 2, 15), dit le prophète dans la Première Lecture. Le Carême s’ouvre avec un son strident, celui d’une corne qui ne caresse pas les oreilles, mais organise un jeûne. C’est un son puissant, qui veut ralentir notre vie qui va toujours au pas de course, mais souvent ne sait pas bien où. C’est un appel à s’arrêter - un arrête-toi - , à aller à l’essentiel, à jeûner du superflu qui distrait. C’est un réveil pour l’âme.
Au son de ce réveil est joint le message que le Seigneur transmet par la bouche du prophète, un message bref et pressant : « Revenez à moi » (v. 12). Revenir. Si nous devons revenir, cela signifie que nous sommes allés ailleurs. Le Carême est le temps pour retrouver la route de la vie. Parce que dans le parcours de la vie, comme sur tout chemin, ce qui compte vraiment est de ne pas perdre de vue le but. Lorsqu’au contraire dans le voyage, ce qui intéresse est de regarder le paysage ou de s’arrêter pour manger, on ne va pas loin. Chacun de nous peut se demander : sur le chemin de la vie, est-ce que je cherche la route ? Ou est-ce que je me contente de vivre au jour le jour, en pensant seulement à aller bien, à résoudre quelques problèmes et à me divertir un peu ? Quelle est la route ? Peut-être la recherche de la santé, que beaucoup disent venir avant tout mais qui un jour ou l’autre passera ? Peut-être les biens et le bien-être ? Mais nous ne sommes pas au monde pour cela. Revenez à moi, dit le Seigneur. A moi. C’est le Seigneur le but de notre voyage dans le monde. La route est fondée sur Lui.
Pour retrouver la route, aujourd’hui nous est offert un signe : des cendres sur la tête. C’est un signe qui nous fait penser à ce que nous avons en tête. Nos pensées poursuivent souvent des choses passagères, qui vont et viennent. La légère couche de cendres que nous recevrons est pour nous dire, avec délicatesse et vérité : des nombreuses choses que tu as en tête, derrière lesquelles chaque jour tu cours et te donne du mal, il ne restera rien. Pour tout ce qui te fatigue, de la vie tu n’emporteras avec toi aucune richesse. Les réalités terrestres s’évanouissent, comme poussière au vent. Les biens sont provisoires, le pouvoir passe, le succès pâlit. La culture de l’apparence, aujourd’hui dominante, qui entraîne à vivre pour les choses qui passent, est une grande tromperie. Parce que c’est comme une flambée : une fois finie, il reste seulement la cendre. Le Carême est le temps pour nous libérer de l’illusion de vivre en poursuivant la poussière. Le Carême c’est redécouvrir que nous sommes faits pour le feu qui brûle toujours, non pour la cendre qui s’éteint tout de suite; pour Dieu, non pour le monde ; pour l’éternité du Ciel, non pour la duperie de la terre ; pour la liberté des enfants, non pour l’esclavage des choses. Nous pouvons nous demander aujourd’hui : de quel côté suis-je ? Est-ce que je vis pour le feu ou pour la cendre ?
Dans ce voyage de retour à l’essentiel qu’est le Carême, l’Evangile propose trois étapes que le Seigneur demande de parcourir sans hypocrisie, sans comédie : l’aumône, la prière, le jeûne. A quoi servent-elles ? L’aumône, la prière et le jeûne nous ramènent aux trois seules réalités qui ne disparaissent pas. La prière nous rattache à Dieu ; la charité au prochain ; le jeûne à nous-mêmes. Dieu, les frères, ma vie : voilà les réalités qui ne finissent pas dans le néant, sur lesquelles il faut investir. Voilà où le Carême nous invite à regarder : vers le Haut, avec la prière qui nous libère d’une vie horizontale, plate, où on trouve le temps pour le ‘je’ mais où l’on oublie Dieu. Et puis vers l’autre avec la charité qui libère de la vanité de l’avoir, du fait de penser que les choses vont bien si elles me vont bien à moi. Enfin, il nous invite à regarder à l’intérieur, avec le jeûne, qui nous libère de l’attachement aux choses, de la mondanité qui anesthésie le cœur. Prière, charité, jeûne : trois investissements pour un trésor qui dure.
Jésus a dit : « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 6, 21). Notre cœur regarde toujours dans quelque direction : il est comme une boussole en recherche d’orientation. Nous pouvons aussi le comparer à un aimant : il a besoin de s’attacher à quelque chose. Mais s’il s’attache seulement aux choses terrestres, tôt ou tard, il en devient esclave : les choses dont on se sert deviennent des choses à servir. L’aspect extérieur, l’argent, la carrière, les passe-temps : si nous vivons pour eux, ils deviendront des idoles qui nous utilisent, des sirènes qui nous charment et ensuite nous envoient à la dérive. Au contraire, si le cœur s’attache à ce qui ne passe pas, nous nous retrouvons nous-même et nous devenons libres. Le Carême est un temps de grâce pour libérer le cœur des vanités. C’est un temps de guérison des dépendances qui nous séduisent. C’est un temps pour fixer le regard sur ce qui demeure.
Où fixer alors le regard le long du chemin du Carême ? C'est simple: sur le Crucifié. Jésus en croix est la boussole de la vie, qui nous oriente vers le Ciel. La pauvreté du bois, le silence du Seigneur, son dépouillement par amour nous montrent les nécessités d’une vie plus simple, libre de trop de soucis pour les choses. De la Croix Jésus nous enseigne le courage ferme du renoncement. Parce que chargés de poids encombrants, nous n’irons jamais de l’avant. Nous avons besoin de nous libérer des tentacules du consumérisme et des liens de l’égoïsme, du fait de vouloir toujours plus, de n’être jamais content, du cœur fermé aux besoins du pauvre. Jésus sur le bois de la croix brûle d’amour, il nous appelle à une vie enflammée de Lui, qui ne se perd pas parmi les cendres du monde ; une vie qui brûle de charité et ne s’éteint pas dans la médiocrité. Est-il difficile de vivre comme lui le demande ? Oui, c'est difficile, mais il conduit au but. Le Carême nous le montre. Il commence avec la cendre, mais à la fin, il nous mène au feu de la nuit de Pâques ; à découvrir que, dans le tombeau, la chair de Jésus ne devient pas cendre, mais resurgit glorieuse. Cela vaut aussi pour nous, qui sommes poussière : si avec nos fragilités nous revenons au Seigneur, si nous prenons le chemin de l’amour, nous embrasserons la vie qui n’a pas de couchant. Et nous serons certainement dans la joie. »
Ref. MESSE, BÉNÉDICTION ET IMPOSITION DES CENDRES
JPSC


 « Sonnez du cor, prescrivez un jeûne sacré » (Jl 2, 15), dit le prophète dans la Première Lecture. Le Carême s’ouvre avec un son strident, celui d’une corne qui ne caresse pas les oreilles, mais organise un jeûne. C’est un son puissant, qui veut ralentir notre vie qui va toujours au pas de course, mais souvent ne sait pas bien où. C’est un appel à s’arrêter - un arrête-toi - , à aller à l’essentiel, à jeûner du superflu qui distrait. C’est un réveil pour l’âme.
« Sonnez du cor, prescrivez un jeûne sacré » (Jl 2, 15), dit le prophète dans la Première Lecture. Le Carême s’ouvre avec un son strident, celui d’une corne qui ne caresse pas les oreilles, mais organise un jeûne. C’est un son puissant, qui veut ralentir notre vie qui va toujours au pas de course, mais souvent ne sait pas bien où. C’est un appel à s’arrêter - un arrête-toi - , à aller à l’essentiel, à jeûner du superflu qui distrait. C’est un réveil pour l’âme.