
Lu ce commentaire de Gabrielle Cluzel sur le site « Boulevard Voltaire »
« On peut décider de ne pas en parler. C’est, d’ailleurs, le choix d’une grande partie de la presse qui préfère, ces jours-ci, se concentrer sur Mai 68, le ramadan ou la poignée de bloqueurs d’université.
Ce n’est pas les intéressés, d’ailleurs, que ça va déranger, leur génération ne regarde plus depuis longtemps la télé. Mais, disons-le tout de suite aux médias : il ne faudra pas, ensuite, aller se plaindre, les gars, s’ébaubir, pousser des oh, des ah (comme pour LMPT), « Menfin ! d’où sortent tous ces gens-là ? » quand ce mouvement de fond silencieux, cette jeunesse florissante, discrète, mais décomplexée – c’est ce qui fait la différence avec ses aînés -, sortira du bois pour telle ou telle cause, et que l’on ne pourra plus l’ignorer.
Car cela viendra.
Mai 68 a 50 ans, Daniel Cohn-Bendit, 73. Eux autres, les 12.000 pèlerins lancés sur la route de Chartres en ce week-end de Pentecôte par le pèlerinage Notre-Dame de chrétienté, ont 21 ans en moyenne. 30 pour le clergé qui les encadre.
Ils rient, ils s’amusent, ils prennent des airs tragi-comiques pour contempler leurs ampoules, leur bronzage agricole et leurs cheveux en pétard après deux nuits sous la tente, comme tous les jeunes de leur âge. Et puis ils prient, ils chantent, ils s’agenouillent, ils souffrent, ils offrent, ils méditent, ils posent leur téléphone pour descendre, durant trois jours, au fond de leur âme, comme aucun jeune de leur âge.
Ils ont affreusement mal aux pieds et horriblement mal dormi mais – allez comprendre – en redemandent chaque année, et ramènent en sus des copains au « pélé ». La liturgie y est, depuis toujours, en forme extraordinaire mais, par une porosité croissante, l’origine des pèlerins dépasse largement le cercle des chapelles dites « tradi ».
Sur les réseaux sociaux, même les identitaires, qui ont habituellement la dent dure avec les cathos (naïfs, cuculs, gentillets), s’étonnent, admiratifs : « 12.000 jeunes rassemblés, Ô embrouille, Ô dégradation, pas un papier par terre. Comment ce miracle est-il possible ? Qui est ce peuple éduqué et respectueux ? Quelle est cette communauté qui n’emmerde personne ? », tweete Damien Rieu.
La messe de clôture solennelle du lundi, en la cathédrale de Chartres, est comparable, mutatis mutandis, à la Rollex de Sarkozy vue par Séguéla : qui n’a jamais assisté à l’immense procession, sous les cantiques, de ce jeune clergé précédé par un interminable cortège de bannières, d’étendards et de statues de la Vierge, a un peu raté sa vie. La bonne nouvelle est que, dans l’Église, toute erreur a sa rédemption : il pourra y aller l’an prochain.
Cette année, elle était célébrée par le cardinal Sarah, et cette présence symbolique, infiniment touchante, sonnait comme un juste retour des choses : dans son premier livre Dieu ou rien, sans renier sa culture familiale, il disait sa grande reconnaissance pour les missionnaires français : « Mon entrée dans la famille du Christ doit tout au dévouement exceptionnel des pères spiritains. Je garderai ma vie durant une immense admiration pour ces hommes qui avaient quitté la France, leurs familles et leurs attaches afin de porter l’amour de Dieu aux confins du monde. »
Des dizaines d’années après, c’est lui qui vient transmettre le précieux dépôt à de jeunes Français pas plus vieux que le gamin qu’il était, c’est lui qui vient rendre son héritage à un peuple qui l’a oublié. Et il le fait d’une voix forte, sans ambages, avec des accents de Jean-Paul II au Bourget : « Terre de France, réveille-toi ! », « Peuple de France, retourne à tes racines ! » Il fustige un monde occidental pris en étau entre le nihilisme et l’islamisme, l’exhorte à prendre exemple sur ses ancêtres dont la foi a bâti ces cathédrales, demande aux jeunes d’être « les saints et les martyrs » de demain. Pour la langue de buis, ne pas compter sur lui. Le cardinal guinéen a secoué les puces, pour son bien, de l’Occident chrétien. Et si c’était cela, aussi, l’universalité de l’Église ? »
Ref : Le cardinal Sarah aux 12.000 pèlerins de Chartres : Terre de France, réveille-toi !
De ses voyages apostoliques sur le continent noir, le pape, aujourd'hui émérite, Benoît XVI avait déjà retenu ceci:
La rencontre de Afrique avec sa joyeuse passion pour la foi est un grand encouragement. Là ne se perçoit aucun signe de cette fatigue de la foi, si répandue parmi nous, rien de cette lassitude de l'être chrétien toujours à nouveau perceptible chez nous. Malgré toutes les peines de l'Afrique, la joie d'être chrétien et le fait d'être soutenu par le bonheur intérieur de connaître le Christ donnent les énergies pour se mettre à sa disposition sans se replier sur son propre bien-être : voilà un grand remède contre la fatigue du fait d'être chrétien que nous expérimentons en Europe.
Benoît XVI, discours à la curie romaine, 22/12/2011
JPSC
 A ce titre, l’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville célébrera la Solennité de la Fête le dimanche 3 juin à 10 heures en l’église du Saint-Sacrement située au cœur de la Cité ardente (Bd d’Avroy, 132, face à la statue équestre de Charlemagne).
A ce titre, l’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville célébrera la Solennité de la Fête le dimanche 3 juin à 10 heures en l’église du Saint-Sacrement située au cœur de la Cité ardente (Bd d’Avroy, 132, face à la statue équestre de Charlemagne).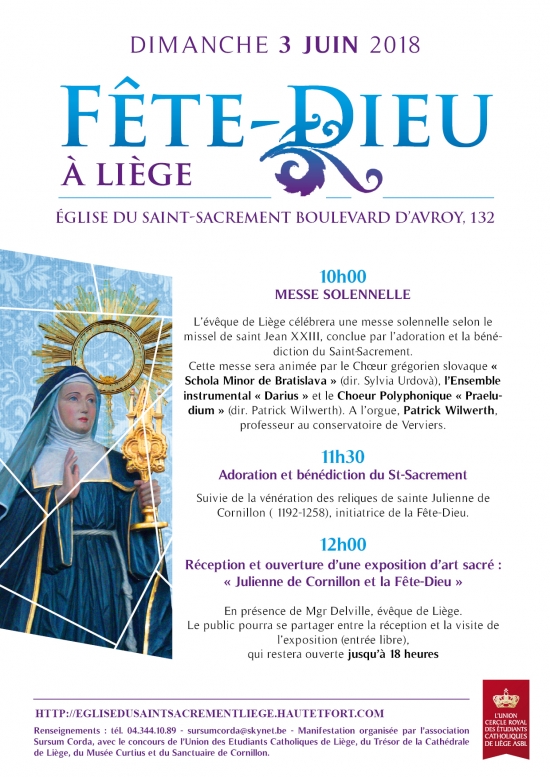
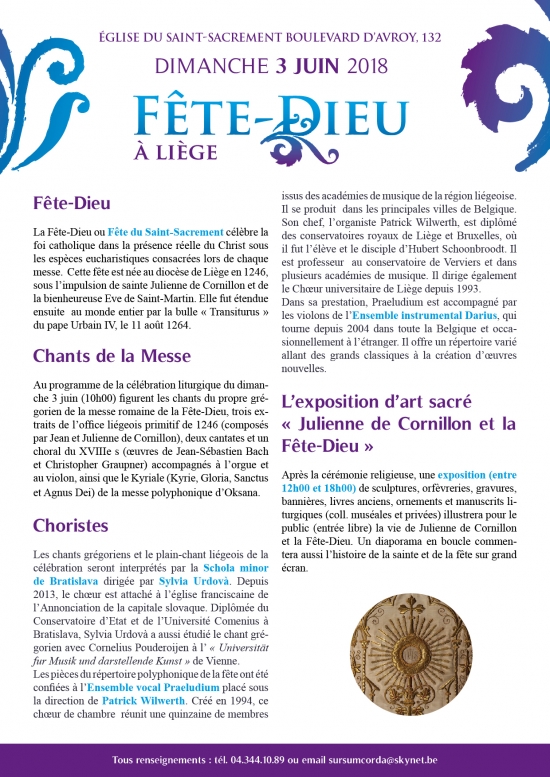
 « Le « Festival grégorien de Watou » (Belgique) s’est achevé. Notre ami Bernard Deheegher résume la façon dont il s’est déroulé :
« Le « Festival grégorien de Watou » (Belgique) s’est achevé. Notre ami Bernard Deheegher résume la façon dont il s’est déroulé : « On sait qu’une assemblée spéciale du Synode des évêques va se réunir, en octobre 2019, pour l’Amazonie, et qu’elle traitera de l’ordination d’hommes mariés pour répondre aux « nécessités pastorales » locales. De plus, le cardinal Stella, Préfet de la Congrégation pour le Clergé, personnage majeur de la Curie du Pape François, a confirmé, dans un entretien publié dans Tutti gli uomini di Francesco « Tous les hommes de François », de Fabio Marchese Ragona: (San Paolo, 2018), que le Saint-Siège est bien en train d’étudier la possibilité de « l'ordination d’hommes mariés pour un sacerdoce à temps partiel ». Le Cardinal Stella a en outre précisé que l'abolition de la règle du célibat pour les candidats à l’ordination ne concernerait pas seulement l’Amazonie, mais aussi « quelques îles du Pacifique, et pas seulement ». Cette atteinte gravissime à la structure spirituelle du sacerdoce dans l’Eglise latine a été relayée au Canada, par une discussion exploratoire des évêques du Québec, en Allemagne, au Mexique (région du Chiapas), au Brésil, en Afrique du Sud. Dans ce contexte, le cardinal Sarah (photo) a consacré un passage de son homélie prononcée, dans la cathédrale de Chartres, le 21 mai, lors de la messe conclusive du Pèlerinage de « Notre-Dame de Chrétienté », à la défense du célibat sacerdotal :
« On sait qu’une assemblée spéciale du Synode des évêques va se réunir, en octobre 2019, pour l’Amazonie, et qu’elle traitera de l’ordination d’hommes mariés pour répondre aux « nécessités pastorales » locales. De plus, le cardinal Stella, Préfet de la Congrégation pour le Clergé, personnage majeur de la Curie du Pape François, a confirmé, dans un entretien publié dans Tutti gli uomini di Francesco « Tous les hommes de François », de Fabio Marchese Ragona: (San Paolo, 2018), que le Saint-Siège est bien en train d’étudier la possibilité de « l'ordination d’hommes mariés pour un sacerdoce à temps partiel ». Le Cardinal Stella a en outre précisé que l'abolition de la règle du célibat pour les candidats à l’ordination ne concernerait pas seulement l’Amazonie, mais aussi « quelques îles du Pacifique, et pas seulement ». Cette atteinte gravissime à la structure spirituelle du sacerdoce dans l’Eglise latine a été relayée au Canada, par une discussion exploratoire des évêques du Québec, en Allemagne, au Mexique (région du Chiapas), au Brésil, en Afrique du Sud. Dans ce contexte, le cardinal Sarah (photo) a consacré un passage de son homélie prononcée, dans la cathédrale de Chartres, le 21 mai, lors de la messe conclusive du Pèlerinage de « Notre-Dame de Chrétienté », à la défense du célibat sacerdotal :
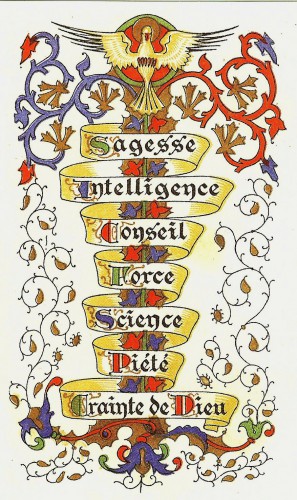
 L’abbé Guilhem Le Coq est un ancien aumônier du pèlerinage de Chartres. Pour l’hebdomadaire « Famille chrétienne », il revient ici sur l’actualité des intuitions des promoteurs de cette grande « migration » annuelle :
L’abbé Guilhem Le Coq est un ancien aumônier du pèlerinage de Chartres. Pour l’hebdomadaire « Famille chrétienne », il revient ici sur l’actualité des intuitions des promoteurs de cette grande « migration » annuelle :