 Lu ce 27 août sur le site web de « La Libre Belgique », cette carte blanche bienvenue, signée par des personnalités représentatives de la société civile (voir la liste in fine de l’article) :
Lu ce 27 août sur le site web de « La Libre Belgique », cette carte blanche bienvenue, signée par des personnalités représentatives de la société civile (voir la liste in fine de l’article) :
« La gestion de la pandémie nécessite une confrontation large et multidisciplinaire des connaissances et des idées.
La gestion actuelle de la crise sanitaire de la Covid-19 montre énormément de failles et trop d’inadéquation. Elle manque singulièrement de clarté et de transparence. Les questionnements qu’elle provoque restent désespérément sans réponse. Il faut dans les plus brefs délais mettre sur pied un ou plusieurs groupes de travail, indépendants du monde politique, constitués d’un large panel de personnes compétentes dans tous les secteurs impactés par cette crise (médical, santé publique, économie, secteurs sociaux, enseignement, justice, etc.) et représentatif de l’ensemble des citoyens.
La légitimité des experts actuellement aux commandes doit être remise en question.
La crise est actuellement gérée par quelques experts dont les critères de sélection restent jusqu’ici inconnus et incompris. Leurs éventuels conflits d’intérêts ne sont pas déclarés. Trop de décisions ont été basées sur des données scientifiquement infondées et dont les conséquences directes et indirectes ont été sous-évaluées. Le processus d’auto-évaluation tel que prévu par le gouvernement sous forme de Commission parlementaire ne permettra pas une vraie remise en question, pourtant indispensable.
Les erreurs du passé ne peuvent plus être reproduites.
Ces groupes de travail devront évaluer objectivement les bénéfices et les conséquences néfastes du système de confinement imposé par le gouvernement afin de les mettre en balance.
L’efficacité des mesures prises pour limiter la propagation du virus doit être évaluée. Il semble bien que les pays n’ayant pas pris des mesures aussi restrictives que les nôtres n’aient pas été confrontés à une mortalité différente, bien au contraire. Les faits n’ont jamais corroboré aucune des estimations catastrophistes du nombre de décès de certains biostatisticiens et modélisateurs, comme ils n’ont pas pu confirmer les effets espérés du confinement. Confiner les personnes saines n’a aucun fondement scientifique, et confiner les personnes malades avec les personnes saines aura pu favoriser les contaminations entre personnes vivant sous le même toit.
Sur le plan médical, le confinement a entraîné une surmortalité dans les autres pathologies. Des données récentes estiment cette surmortalité à au moins 30 % de la surmortalité globale (1), ce qui correspond précisément au nombre de patients "suspects de Covid-19" et que le gouvernement belge, contrairement à ses voisins, a comptabilisés dans la mortalité liée au Covid-19, surestimant celle-ci de façon importante. D’autres chiffres corroborent ce phénomène puisque les hôpitaux belges ont observé une nette diminution du nombre de patients pris en charge pour infarctus du myocarde pendant la période du confinement, et en France pendant la même période une grosse augmentation du nombre d’arrêts cardiaques extra-hospitaliers et un excès de mortalité liées à ceux-ci, qui n’est pas expliquée par l’existence du Covid-19 à lui seul (2,3). La médecine préventive n’a pu être conduite correctement, en particulier les diagnostics de cancer ont diminué de moitié (4) (moins 2 500 diagnostics par mois en Belgique) avec une surmortalité attendue également (5,6).
Sur le plan de la santé publique, la Covid-19 doit être remise en perspective avec l’ensemble des autres pathologies et les mesures prises ne peuvent plus être disproportionnées au regard d’autres fléaux au moins tout aussi mortels.
Sur le plan psychosocial, le confinement a généré de la violence conjugale et de la maltraitance infantile. Le taux de pauvreté explose et cette dernière est reconnue pour diminuer l’espérance de vie de plusieurs années (7). Le stress sous de nombreuses formes, généré par le confinement, aura sans aucun doute des effets néfastes sur la santé mentale (8).
Sur le plan économique, 50 milliards se sont évaporés. Jamais autant d’argent n’aura été investi pour "sauver" si peu de vies, même dans les estimations les plus folles du nombre de décès soi-disant évités (chiffre qui reste inconnu à ce jour). Tout cet argent ne pourra plus être investi dans des secteurs pourtant tout aussi indispensables comme la sécurité sociale, l’enseignement, la justice et les soins de santé eux-mêmes.
Sur le plan juridique, on constate que bon nombre de mesures, adoptées par l’exécutif, reposent sur des bases légales inadéquates et non valables. Celles-ci ne permettent pas de servir de fondement pour imposer, par exemple, le port obligatoire du masque, le traçage, la distanciation sociale ou interdire les rassemblements. Plus encore, le pouvoir exécutif est incompétent pour accompagner ces mesures des sanctions pénales prévues par la loi de 2007. Les mesures futures doivent être prises dans le respect de la Constitution belge (9). On ne compte plus les régimes discriminatoires et les différences de traitement entre les différentes professions. Les règles changent sans cesse et ne sont même plus identifiables, et ce au mépris de la sécurité juridique. La négligence des libertés fondamentales, de la démocratie et de l’état de droit est une porte ouverte à poursuivre ou réitérer cette négligence dans le futur pour d’autres prétextes bons ou mauvais. Nous devons sérieusement nous interroger sur le principe de pouvoir porter atteinte à ces valeurs fondamentales quelle que soit la situation. Unia et l’INDH ont eux-mêmes appelé à la prudence dans le maniement des mesures attentatoires aux droits fondamentaux (10). La justice a été mise à l’arrêt avec des conséquences néfastes pour de nombreuses victimes. La justice et la police ont été détournées de leurs missions habituelles pour faire respecter les directives gouvernementales.
Sur le plan éthique, les principes de justice distributive, de non-malfaisance et d’autonomie qui sont les bases de l’éthique médicale ont été bafoués. L’exemple le plus illustratif est celui des personnes âgées vivant en résidence, qui ont été enfermées contre leur gré, privées de relations sociales et de soins médicaux, soi-disant pour leur bien… Ils représentent la majorité de ces morts "suspects Covid-19" dont on peut raisonnablement penser qu’ils sont décédés d’autres choses que l’on n’a tout simplement pas prises en charge. Chaque personne à risque devrait être libre de se protéger comme bon lui semble. Les experts et le gouvernement semblent ignorer que beaucoup de nos aînés préféraient mourir heureux et entourés que de vivre confinés les derniers mois de leur vie.
Tous ces éléments sont bien entendu interdépendants et ne peuvent être envisagés séparément.
La gestion future de la crise doit être scientifiquement fondée, rationnelle et proportionnée.
Le point actuellement le plus important à débattre est de définir précisément le but des mesures anti-Covid-19. Initialement, il fallait éviter la saturation des hôpitaux en aplatissant la courbe, ce qui était compréhensible. Toutefois, aucune donnée objective sur le bénéfice du confinement de l’entièreté de la population n’a été fournie à ce jour. Ensuite, les mesures ont été prolongées et il semble maintenant qu’il faille à tout prix éviter de se faire infecter par un virus dont la dangerosité ne dépasse pas celle de la grippe saisonnière que nous vivons chaque année dans la "quasi" indifférence générale. Cela ne nous paraît plus raisonnable.
Le gouvernement a été jusqu’ici incapable d’organiser un dépistage massif, méthode pourtant reconnue efficace pour isoler les malades et limiter la propagation du virus (11). En lieu et place, les citoyens se voient à nouveau limités dans leurs libertés fondamentales. Ceci n’est plus acceptable.
D’autres points majeurs doivent également être débattus.
Le vaccin nous a été présenté d’emblée comme l’unique solution à la fin de cette épidémie, alors que son innocuité, son efficacité et la durée de son éventuelle protection dans le temps sont incertaines. D’autres solutions à moyen ou long terme doivent être envisagées, comme l’immunité collective. En dehors des espaces où la distanciation physique ne peut être respectée, le port du masque n’a strictement aucun intérêt.
Les risques à long terme liés à l’excès d’hygiène doivent être pris en compte.
Il ne peut plus y avoir de victimes collatérales.
Les enfants doivent pouvoir reprendre l’école maternelle, primaire et secondaire dans des conditions normales, moyennant des mesures d’hygiène de base comme le lavage des mains. Des restrictions d’espace et de temps de détente, de jeux ou de relations sociales ne doivent plus exister. Les recommandations très récentes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies confirment que la fermeture et la réouverture des écoles n’ont pas eu d’impact significatif sur la transmission du virus dans la communauté (12). Nous supportons entièrement l’avis de la Task Force pédiatrique exprimé dans sa carte blanche du 12/08/2020 (13).
Les étudiants du supérieur doivent retrouver le chemin des auditoires et de la vie sociale en général.
Les secteurs de la culture, de l’Horeca, de l’événementiel doivent pouvoir reprendre leurs activités au plus vite.
Les citoyens ont droit à une information objective et honnête.
De façon urgente, les citoyens doivent avoir accès à des informations claires, objectives, professionnelles et indépendantes des médias mainstream et de leur sensationnalisme. Le climat actuel de covidophobie est tout à fait injustifié et génère une anxiété néfaste pour une partie importante de la population.
En définitive, nous demandons la mise sur pied urgente de groupes de travail larges et multidisciplinaires qui puissent enfin proposer des mesures scientifiquement prouvées efficaces, proportionnées au regard des autres problèmes de société et de santé publique, sans effets collatéraux néfastes et dans le respect de l’état de droit, de la démocratie et des libertés individuelles.
Signataires:
Pr LATERRE Pierre-François, chef de service, soins intensifs, cliniques universitaires St-Luc, UCLouvain ;
Pr RENTIER Bernard, professeur de virologie honoraire et recteur honoraire, président du Conseil de WBE, Université de Liège ;
M. DE CALLATAY Étienne, économiste Orcadia AM- UCLouvain - Unamur ;
M. NOELS Geert, Hoofdeconoom Econopolis ;
Dr QUISQUATER Jean-Jacques docteur en informatique, chercheur associé MIT École polytechnique de Louvain UCLouvain, Académie royale de Belgique ;
Dr VINETTI Marco, soins intensifs, cliniques St-Pierre Ottignies ;
Dr DECHAMPS Mélanie, cheffe de clinique adjoint, soins intensifs cardiovasculaires, spécialiste doctorante au FNRS, cliniques universitaires St-Luc, UCLouvain ;
Me GREGOIRE Antoine, avocat barreau de Liège ;
Pr RODENSTEIN Daniel, pneumologue, professeur émérite UCLouvain ;
Dr COLIENNE Christine, praticienne hospitalière, soins intensifs cliniques universitaires St-Luc UCLouvain ;
Pr MINGUET Cassian, médecin généraliste Centre académique de médecine générale ;
Dr DECHAMPS Michel, neuropédiatre, président du comité d’accompagnement enfance maltraitée ONE ;
M. DE HERTOG Didier enseignant, ancien directeur d’établissement institut St-Stanislas, Bruxelles ;
Dr GOLDSTEIN Dan, anesthésiste, CHR Haute Senne ;
Dr DAGNEAUX Isabelle médecin généraliste, philosophe, Unamur ;
Pr ANNEMANS Lieven, Gewoon Hoogleraar in de Gezondheidseconomie, VUB, Ugent ;
M. QUATREMER Jean journaliste, journal Libération ;
Dr HORMAN Stéphane, médecin généraliste, Houffalize ;
Dr HORLAIT Geoffrey, chef de clinique adjoint, soins intensifs, CHU Mont-Godinne, UCLouvain ;
Dr VANSTAPEL Caroline médecin généraliste, Bois de Villers ;
Pr VAN BELLEGEM Sébastien, statisticien, doyen honoraire UCLouvain ;
Dr PONCIN Renaud, oncologue cliniques St-Pierre Ottignies ;
Pr ANCAENEGEM Olivier chef de service, soins intensifs cardiovasculaires cliniques universitaires St-Luc UCLouvain ;
M. BULLENS Quentin, docteur en psychologie HEPN ;
M. PANISI Régis historien Head of knowledge management Stibbe ULB ;
Dr POITOUX Émilie pédiatre hôpital de Nivelles ;
Dr THONON Geneviève pédiatre Centres hospitaliers Jolimontois ;
Mme THIRIFAYS Stéphanie juge de la jeunesse et de la famille, tribunal de première instance de Namur division Dinant ;
Mme HOTTON Julie, cheffe du service de biologie clinique cliniques de l’Europe ;
M. MAHAUX Michel économiste de la santé ;
Pr DE BECKER Emmanuel, chef de service psychiatrie infanto-juvénile cliniques universitaires St-Luc UCLouvain ;
Dr BASTIN Philippe chef de service, psychiatrie cliniques de l’Europe ;
Dr LABEHAUT Fabrice médecin généraliste La Hulpe ;
Pr LINKOWSKI Paul neuropsychiatre professeur émérite ULB ;
Pr FIERENS Jacques, professeur extraordinaire émérite de l’UNamur, professeur émérite de l’UCLouvain, chargé de cours honoraire de l’ULiège ;
M. BERNARD Alfred directeur de recherches FNRS professeur émérite UCLouvain ;
Pr BAERT Stijn Econoom arbeid Ugent ;
Dr DUTILLEUX Catherine anesthésiste, coordinatrice du centre multidisciplinaire de traitement de la douleur et des céphalées CHR Verviers ;
Dr LUYASU Samuel, spécialiste en médecine interne et en soins intensifs UC Louvain ;
Dr GABRIEL Brieuc, anesthésie réanimation GhdC ;
M. JANSEN Arnaud avocat barreau de Bruxelles ;
Dr GERARD Ludovic chef de clinique adjoint, soins intensifs cliniques universitaires St-Luc UCLouvain ;
Dr THIRY Anne-Sophie, neurologue centre médical Neurogen, La Hulpe ;
Pr VANMEERBEEK Marc, département de médecine générale, unité de recherche soins primaires et santé CHU Sart Tilman ;
Dr DUPUIS Pierre-Yves médecin généraliste, Namur ;
Dr MONIOTTE Stéphane chef du département de pédiatrie, advisor cliniques universitaires St-Luc, UCLouvain Belgian Pediatric Task Force Covid-19 ;
M. JACOB Joël, directeur de catégorie adjoint haute école Albert Jacquard ;
Dr LEMAIRE Guillaume, chef de clinique adjoint, anesthésie cardio-vasculaire, Cliniques universitaires St-Luc ;
Dr DEMOUSTIER Philippe gynéco-obstétrique ISPPC Charleroi ;
Mme WEIS Barbara, assistante en chimie ULB ;
Dr DUTILLIEUX Marie-Hélène, médecin généraliste UCL ; éthique biomédicale UCL, UCLouvain ;
M. LACROIX Nicolas directeur LCRX Event ;
Pr THIRION Nicolas, professeur de droit ULiège ;
Dr SCHEPENS Gauthier ophtalmologue CHR Mons Hainaut ;
Dr NOEL Philippe, médecin généraliste, médecin référent du CRF "Hautes Fagnes" pour personnes addictes, Malmedy ;
M. BOUGENIES Patrice expert-comptable et conseil fiscal, membre de l’Institut des experts-comptables et conseils fiscaux de Belgique ;
Dr LUYMOEYEN Vanessa médecin généraliste ;
Dr NEMITZ Heike médecin généraliste, ONE ;
M. LABORDERIE Vincent politologue UCLouvain ;
M. SERVAIS Olivier professeur d’anthropologie UCLouvain ;
M. VADOT Nicolas dessinateur de presse ;
Mme ROBIN Chantal sage-femme et enseignante en HE Liège ;
Mme COURTOY Sylvie, directrice pédagogique Fernelmont ;
Dr BRIHAYE Pierre chef de clinique adjoint, responsable de la rhinologie pédiatrique, service ORL-CCF, hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola.
Références
- S H Woolf, D A Chapman, R T Sabo, et al. Excess Deaths From COVID-19 and Other Causes. JAMA Network open. 01.07.2020.
- M Claes, JF Argacha, P Collart et al. Impact of Covid-19 related public containment measures on the ST elevation myocardial infarction epidemic in Belgium: a nationwide, serial, cross-sectional study. Acta Cardiologica 2020.
- E Marijon, N Karam, D Jost et al. Out-of-hospital cardiac arrest during the Covid-19 pandemic in Paris, France: a population-based, observational study. The Lancet public health 2020; 5: 437-443.
- Belgian Cancer Registry. 07.2020.
- C Maringe, J Spicer, M Morris, et al. The impact of the COVID-19 pandemic on cancer deaths due to delays in diagnosis in England, UK: a national, population-based, modelling study. Lancet Oncol 2020; 21: 1023–34.
- A Sud, B Torr, M E Jones, et al. Effect of delays in the 2-week-wait cancer referral pathway during the COVID-19 pandemic on cancer survival in the UK: a modelling study. Lancet Oncol 2020; 21: 1035–44.
- Sciensano. Socio-economic inequalities in life expectancy and health expectancies and selfperceived, Belgium, 2011 or 2013.
- S K Brooks, R K Webster, L E Smith et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet 2020; 395: 912-920.
- « Art. 10. Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.L'égalité des femmes et des hommes est garantie. » « Art. 11. La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. »
- P Charlier (Directeur du centre interfédéral pour l’égalité des chances UNIA) et M Fella (responsable de l’institution nationale des droits de l’Homme INDH). Cherche : équilibre belge entre droits Fondamentaux et intérêt général. La libre Belgique. 12.08.2020.
- R Steinbrook. Contact Tracing, Testing, and Control of COVID-19-Learning From Taiwan. JAMA Intern Med. 01.05.2020.
- Covid-19 in children and the role of school setteing in covid 19 transmission. European center
for disease Prevention and control. 06.08.2020.
- La Belgian Pediatric Covid-19 Task Force. Tous les enfants doivent retourner à l’école à temps plein le 1er septembre. LaLigue.be. 12.08.2020. "
Ref. Lettre ouverte à nos responsables politiques : Il est urgent de revoir totalement la gestion de la crise Covid-19
JPSC
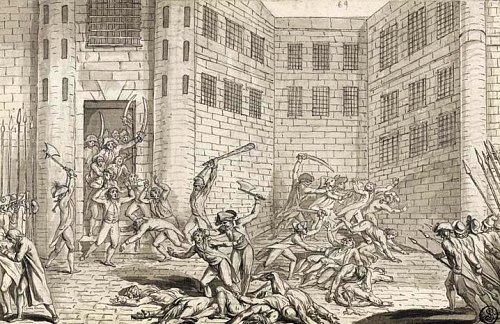



 Lu ce 27 août sur le site web de « La Libre Belgique », cette carte blanche bienvenue, signée par des personnalités représentatives de la société civile (voir la liste in fine de l’article) :
Lu ce 27 août sur le site web de « La Libre Belgique », cette carte blanche bienvenue, signée par des personnalités représentatives de la société civile (voir la liste in fine de l’article) :

 Sursum corda : avant d’entrer dans la Prière eucharistique, peu avant que Dieu vienne nous visiter à la messe avec sa Croix glorieuse, l’Église invite les fidèles à élever leur cœur vers le Mystère rédempteur qui leur ouvre ainsi le ciel. La collecte de ce jour a également cette perspective céleste, ad superna semper intenti – tout tendus vers les réalités d’En-Haut. Notre Dame monte au ciel avec son corps et son âme, son Assomption nous donne d’espérer pour tout de bon les réalités d’En-Haut. La recevant chez elle, Élisabeth déjà témoignait qu’en entrant chez elle, c’était le ciel qui entrait. L’évangile de ce jour pétille déjà de l’éternité : Benedictus, benedicta, beata (Luc 1,41-50). Élisabeth atteste que le fruit du sein de Marie est le Béni du Père des cieux, aussi Marie est-elle bénie entre toutes les femmes, comme le dit nos Ave Maria. Avec Élisabeth nous répétons ces mots avec plus de vérité que lorsque le peuple d’Israël acclama Judith victorieuse d’Holopherne (Judith 13,18). Oui, il nous plaît de renchérir avec la vieille cousine : Bienheureuse êtes-vous, Marie, d’avoir cru à l’invitation divine d’œuvrer à l’Incarnation ; et elle-même constate que toutes les générations convergent vers sa personne en la déclarant telle : Beatam me dicent omnes generationes (Luc 1,48). Oui, le ciel est ouvert et Marie nous y attend.
Sursum corda : avant d’entrer dans la Prière eucharistique, peu avant que Dieu vienne nous visiter à la messe avec sa Croix glorieuse, l’Église invite les fidèles à élever leur cœur vers le Mystère rédempteur qui leur ouvre ainsi le ciel. La collecte de ce jour a également cette perspective céleste, ad superna semper intenti – tout tendus vers les réalités d’En-Haut. Notre Dame monte au ciel avec son corps et son âme, son Assomption nous donne d’espérer pour tout de bon les réalités d’En-Haut. La recevant chez elle, Élisabeth déjà témoignait qu’en entrant chez elle, c’était le ciel qui entrait. L’évangile de ce jour pétille déjà de l’éternité : Benedictus, benedicta, beata (Luc 1,41-50). Élisabeth atteste que le fruit du sein de Marie est le Béni du Père des cieux, aussi Marie est-elle bénie entre toutes les femmes, comme le dit nos Ave Maria. Avec Élisabeth nous répétons ces mots avec plus de vérité que lorsque le peuple d’Israël acclama Judith victorieuse d’Holopherne (Judith 13,18). Oui, il nous plaît de renchérir avec la vieille cousine : Bienheureuse êtes-vous, Marie, d’avoir cru à l’invitation divine d’œuvrer à l’Incarnation ; et elle-même constate que toutes les générations convergent vers sa personne en la déclarant telle : Beatam me dicent omnes generationes (Luc 1,48). Oui, le ciel est ouvert et Marie nous y attend.
