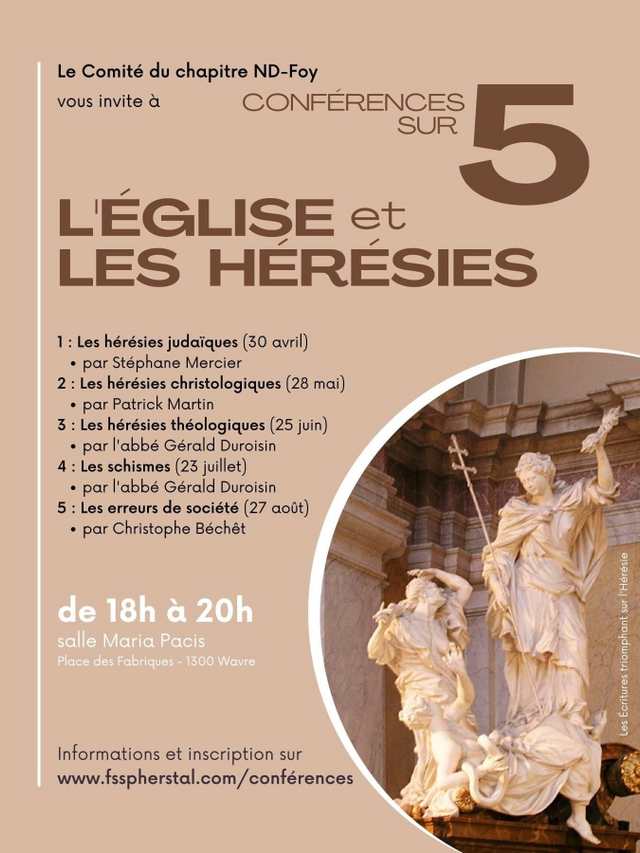La dépénalisation de l’avortement est secondaire par rapport au droit à la vie : tous ces textes que la France et l’Europe ont signés l’expriment
Devons-nous, Monsieur le président, vous rappeler les textes nationaux, européens et internationaux dont la France et les autres États membres sont signataires et qui s’opposent frontalement à une telle évolution ? Comment peut-on envisager de mettre ainsi de côté la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies, qui assure la reconnaissance autant que l’application universelle du droit à la vie et de « la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine » , sans distinction, qu’ils soient nés ou en gestation ?
Avez-vous oublié la convention de Rome de 1950, voulue par les pères fondateurs, pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit de toute personne à la vie et le fait que la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement ?
Avez-vous oublié que la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Onu en 1989, dispose que « l’enfant […] a besoin d’une protection spéciale […] , notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance » ?
Comment pouvez-vous céder aux pressions des lobbies en faisant fi de ces textes dont la France et l’Europe, que vous représentez l’une et l’autre, sont signataires ? Au titre de quelle prérogative osez-vous maltraiter ainsi les droits de l’homme ? Comment pouvez-vous oublier que l’avortement, c’est la mort d’êtres humains ? Comment pouvez-vous envisager d’imposer à tous les États membres le non-respect de la vie comme principe fédérateur ?
Il est du devoir de tout pouvoir d’État de protéger la vie humaine. Oui, la loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. La dépénalisation de l’avortement est secondaire par rapport au droit à la vie : tous ces textes que la France et l’Europe ont signés l’expriment. Le droit à la vie physique est le premier des droits fondamentaux. Il serait contre nature et absolument paradoxal d’inverser ces repères.
Devons-nous nous faire biologistes pour vous rappeler que la vie humaine commence dès l’instant de la conception, à la fusion des gamètes, et qu’il n’y a pas de différence substantielle mais seulement une différence de développement entre le zygote qui apparaît immédiatement après la fécondation, le fœtus et le nouveau-né à la naissance ? Sur le plan biologique, il s’agit bien d’une vie humaine, d’un être humain vivant.
Non, le crime contre l’enfant à naître n’est pas un droit à conquérir
Alors oui, s’il le faut, nous nous ferons tour à tour philosophes, historiens, biologistes, mais aussi avocats de la vie pour combattre cette erreur anthropologique fondamentale qui consiste à faire d’un drame une valeur. Non, le crime contre l’enfant à naître n’est pas un droit à conquérir. En revanche, oui, l’avortement a profondément dénaturé les droits de l’homme, droits fondamentaux auxquels nous adhérons universellement. L’avortement brandi comme valeur laisse chaque année des milliers de femmes dans le désarroi, sans alternative à l’interruption de grossesse. Ce sont ces alternatives que l’Europe devrait prioriser. En les sommant d’exercer un droit présenté comme une chance, la société les abandonne avec leur souffrance et la blessure d’avoir recouru à cet acte qui peut détruire et abîmer aussi la vie des femmes.
Monsieur le président, la seule considération de la dignité et du respect de toute vie humaine doit toujours guider vos actions dans la présidence que vous occupez. Elle donne une limite objective à votre liberté et à votre pouvoir. Nous, citoyens européens, voulons pouvoir compter sur la démocratie pour que nos représentants n’instrumentalisent pas le pouvoir dont ils sont dépositaires, afin de nous imposer, contre notre conscience et contre tout processus démocratique une idéologie mortifère.
Si ce n’est pas le cas, nous nous mobiliserons, car protéger les plus vulnérables n’est pas une option. Nous voulons construire une Europe vraiment humaine. Nous espérons que vous saurez l’entendre.
* Tribune cosignée par 103 ONG issues de quinze États membres de l’Union européenne, rassemblées par la plate-forme culturelle européenne One of Us. Slovaquie : Donum Vitae, Forum Zivota, Human Rights and Family Policy Institute / Danemark : Retten Til Liv, Respekt for Menneskeliv / République Tchèque : Hnutí Pro život ČR ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. / France : Fondation Jérôme Lejeune, Femina Europa, Marche pour La Vie, Comité Protestant pour la Dignité Humaine, Choisir la vie, Les Eveilleurs, Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques / Pologne : Ordo Uris, ONE OF US Poland, Human Life International Polska, Polish Association of the Defenders of Human Life, Small Feet Foundation / Portugal : Federação Portuguesa pela Vida. / Malte : Life Network Foundation, Doctors For Life Malta, Malta Unborn Child Platform, I See Life / Pays-Bas : One of Us Nederland,Schreuw om Leven, Dutch Patient Federation, Dutch Lawyers Association Pro Vita / Luxembourg : Pour La Vie Naissante / Italie : Movimento Per la Vita Italiano / Hongrie : Feher-Center Association / Croatie : Cro-Vita Alliance / Autriche : Österreichische Lebensbewegung / Espagne : Federación Española de Asociaciones Provida, Fundación Jerome Lejeune España, Foro Español de la Familia / Belgique : New Women for Europe.