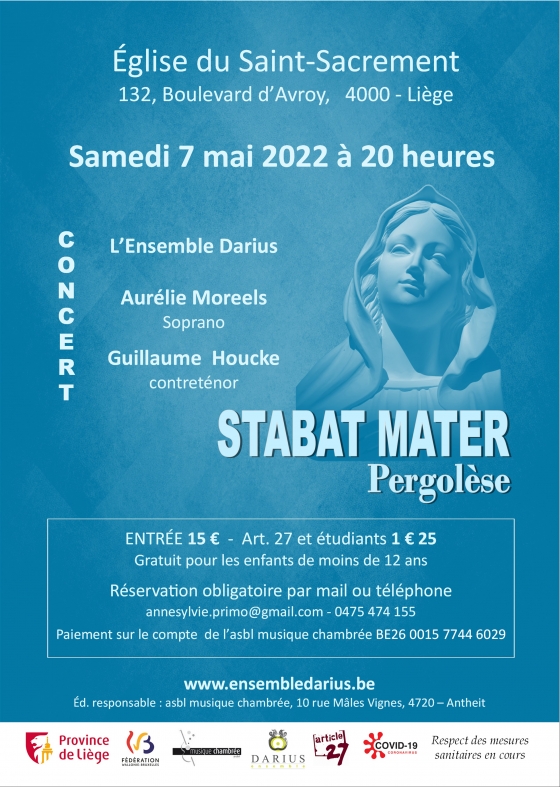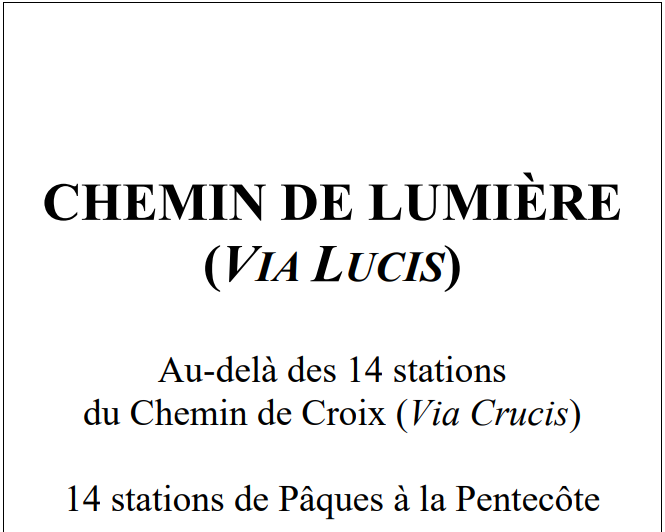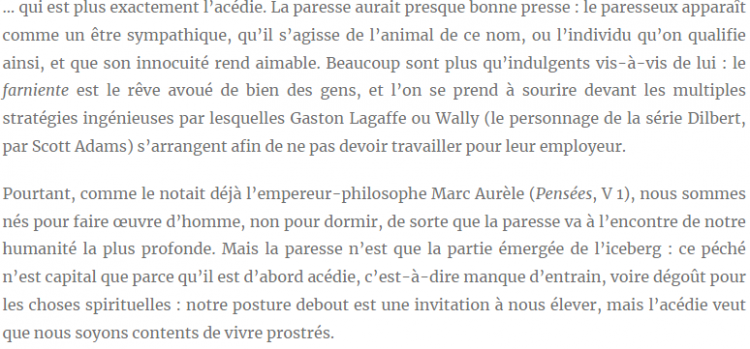D'Anna Bono sur la Nuova Bussola Quotidiana :
Inde : les chrétiens persécutés même à Pâques
20-04-2022
Les fondamentalistes hindous n'ont pas épargné les chrétiens, même pendant la semaine sainte. Dans l'Uttar Pradesh, une foule de nationalistes hindous a encerclé une église protestante. Les fidèles sont accusés de "conversions forcées" et 36 d'entre eux sont arrêtés par la police. L'accusation de "conversion forcée" est le prétexte classique pour cibler les chrétiens.
Les fondamentalistes hindous n'ont pas non plus épargné les chrétiens pendant la semaine sainte. En Inde, où les épisodes de violence à l'encontre des communautés chrétiennes sont de plus en plus fréquents, le Vendredi saint, une centaine de fidèles de l'église évangélique de Hariharganj, dans le district de Fatehpur (Uttar Pradesh), célébraient les rites de Pâques dans leur église lorsque des dizaines de personnes, peut-être une centaine, ont encerclé le bâtiment et bloqué les sorties. Leur leader, Himanshu Dikshit, avait peu avant dénoncé 55 membres de la communauté, les accusant d'avoir forcé environ 90 hindous à se convertir au christianisme. La police a arrêté 36 personnes tout en laissant en liberté les autres croyants emprisonnés dans l'église. La communauté chrétienne du district a immédiatement organisé une collecte pour obtenir la libération sous caution des chrétiens arrêtés, qui ont heureusement été libérés le jour même.
Himanshu Dikshit est membre du Vishwa Hindu Parishad, une organisation nationaliste de droite qui fait campagne pour affirmer l'Hindutwa, l'identité hindoue. L'accusation, toujours totalement infondée, de conversion au christianisme par la force ou la tromperie est l'un des moyens qu'il utilise pour persécuter les chrétiens : les menacer, les intimider, inciter le reste de la population contre eux. Depuis 2014, depuis que le gouvernement fédéral est présidé par le Premier ministre Narendra Modi, leader du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party, les fondamentalistes hindous sont devenus plus agressifs, sachant qu'ils bénéficient du soutien du gouvernement et peuvent compter, comme c'est souvent le cas, sur la collaboration des autorités et des forces de sécurité locales, toujours prêtes à accepter leurs plaintes et réticentes, cependant, à enregistrer celles des chrétiens victimes d'abus et à prendre des mesures pour identifier et traduire en justice les responsables. L'arrestation des chrétiens à Fatehpur est illégale et totalement condamnable", a déclaré à AsiaNews Monseigneur Gerald Mathias, évêque de Lucknow, capitale de l'Uttar Pradesh. L'accusation de conversion illégale est absolument infondée et a été fabriquée par les fondamentalistes hindous. Les fondamentalistes sont de plus en plus enhardis et se comportent en justiciers, prenant la loi en main. La police est souvent un spectateur muet et l'encourage même. Malheureusement, ces incidents se multiplient et on peut se demander si la liberté de religion garantie par la Constitution est réellement respectée et par tous".
L'Uttar Pradesh est l'un des États où se concentre la violence. Il y a eu 102 des 468 incidents graves enregistrés en 2021 par le United Christian Forum, une organisation interconfessionnelle qui dispose d'un numéro vert où les cas d'abus peuvent être signalés. C'est également l'un des huit États de la fédération indienne (composée de 28 États et de huit territoires) qui ont adopté les Freedom of Religion Acts, la loi anti-conversion qui interdit aux minorités religieuses de convertir "de force" la population. Outre l'Uttar Pradesh, où elle a été adoptée en 2020, les lois sur la liberté de religion sont en vigueur dans les États suivants : Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand et Uttarakhand. Dans deux autres États, l'Arunachal Pradesh et le Rajastan, la loi a été adoptée mais n'est pas en vigueur, et dans le Tamil Nadu, elle a été adoptée mais ensuite abrogée. Le gouvernement du Karnataka envisage également de céder aux demandes des fondamentalistes hindous, qui font également pression pour que la loi soit adoptée au niveau fédéral.
Jeff King, président d'International Christian Concern, confirme que l'Uttar Pradesh est l'un des États indiens où la liberté de religion est la plus violée : "Lorsque les autorités légitiment les actions violentes en arrêtant les victimes, elles envoient le message que les activités criminelles sont approuvées par les autorités tant qu'elles visent les minorités religieuses. Cette attitude de la part des autorités ne fait qu'aggraver la situation de la liberté religieuse et accroître la vulnérabilité des chrétiens, les exposant à davantage de violence. Les lois anti-conversion sont en fait ciblées, sujettes à interprétation et conduisent à une réduction totale des droits des chrétiens à exprimer publiquement leur foi".
Un autre responsable de l'International Christian Concern a qualifié d'acte de persécution très grave le fait que, précisément pendant la semaine sainte, les chrétiens ne puissent pas pratiquer librement leur foi, "en célébrant l'un des moments les plus importants du calendrier chrétien".
La semaine avait déjà commencé par un épisode d'intolérance. Le 12 avril, sept bénévoles de Prison Ministry India, une association qui travaille dans les prisons, se sont rendus dans une prison du district de Gadag, au Karnataka, où ils ont organisé des temps de prière et distribué des exemplaires de la Bible. Un fondamentaliste hindou, qui a visité une prison peu de temps après, l'a remarqué, a pris des photos des bibles et les a ensuite détruites. Deux mouvements fondamentalistes hindous, le Vishwa Hindu Parishad et le Bajrang Dal, ont déposé une plainte dénonçant les actions des volontaires comme une tentative de conversion forcée et demandant des sanctions à leur encontre.