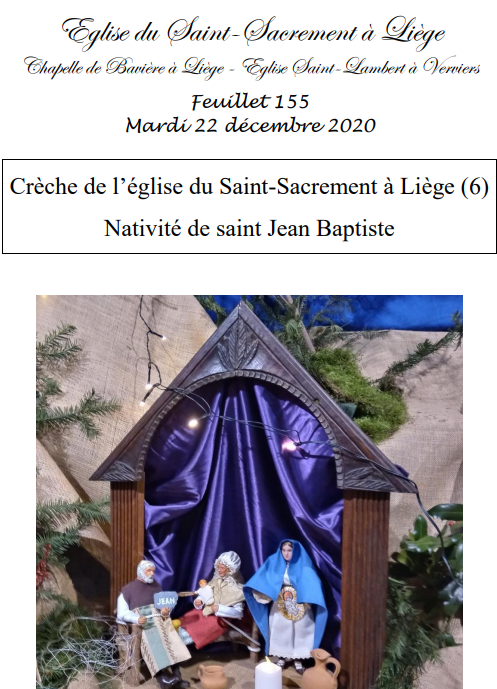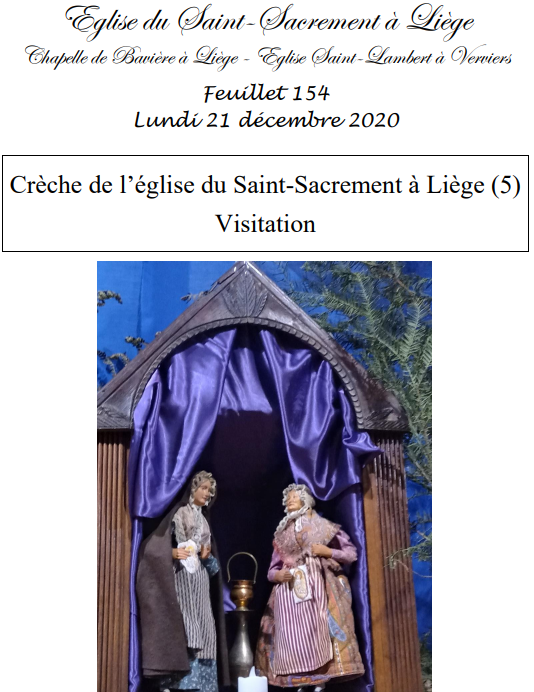Il est «moralement acceptable d'utiliser des vaccins anti-Covid-19 qui ont eu recours à des lignées cellulaires de fœtus avortés dans leur processus de recherche et de production». Dans le cas de la pandémie actuelle, «tous les vaccins reconnus comme cliniquement sûrs et efficaces peuvent être utilisés en restant conscient que le recours à ces vaccins ne signifie pas une coopération formelle avec l'avortement dont sont issues les cellules à partir desquelles les vaccins ont été produits». C’est la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui l’affirme dans une note signée par le préfet, le cardinal Luis Ladaria, et le secrétaire, l'archevêque Giacomo Morandi, et explicitement approuvée par le Pape François jeudi 17 décembre.
Le document de la Congrégation, publié alors que de nombreux pays s'apprêtent à mettre en œuvre des campagnes de vaccination, fait autorité. Il clarifie les doutes et les questions qui ont émergé des déclarations parfois contradictoires sur le sujet. La note «sur la moralité de l'utilisation de certains vaccins anti-Covid 19» rappelle trois prises de position antérieures sur le même sujet: celle de l'Académie pontificale pour la Vie en 2005; l'instruction Dignitas Personae de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 2008; et enfin une nouvelle note de l'Académie pontificale pour la Vie en 2017.
La Congrégation pour la Doctrine de la Foi n'entend pas «juger de la sécurité et de l'efficacité» des vaccins actuels contre le Covid-19, ceci relevant de la responsabilité des chercheurs et des agences de médicaments, mais se concentre sur l'aspect moral de l'utilisation de ceux qui sont développés sur des lignées cellulaires provenant de tissus obtenus à partir de deux fœtus qui n'ont pas été spontanément avortés dans les années 1960. L'Instruction Dignitas Personae, approuvée par Benoît XVI, précise à cet égard qu'il existe «des responsabilités différenciées», car «dans les entreprises qui utilisent des lignées de cellules d’origine illicite, la responsabilité de ceux qui décident de l’orientation de la production n’est pas la même que la responsabilité de ceux qui n’ont aucun pouvoir de décision». Et donc, fait valoir la note publiée aujourd'hui reprenant l'Instruction de 2008, lorsque pour différentes raisons des vaccins «éthiquement incontestables» contre le Covid-19 ne sont pas disponibles, il est «moralement acceptable» de se faire vacciner avec ceux qui ont utilisé des lignées cellulaires de fœtus avortés.
La raison de ce consentement est que la coopération au mal de l'avortement, dans le cas de qui se fait vacciner, est «lointaine» et que le devoir moral de l'éviter «n'est pas contraignant», soutient la Congrégation, «si nous sommes en présence d'un grave danger, tel que la propagation, autrement incontrôlable, d'un agent pathogène grave» comme le virus à l’origine de la Covid-19. Il faut donc considérer, précise la Congrégation, que «dans un tel cas, tous les vaccins reconnus comme cliniquement sûrs et efficaces peuvent être utilisés en sachant avec certitude que le recours à ces vaccins ne signifie pas une coopération formelle avec l'avortement dont dérivent les cellules à partir desquelles les vaccins ont été produits».
La Congrégation précise que «l'utilisation moralement licite de ces types de vaccins, en raison des conditions particulières qui la rendent telle, ne peut constituer en soi une légitimation, même indirecte, de la pratique de l'avortement, et présuppose une opposition à cette pratique de la part de ceux qui y ont recours». Elle ne doit pas non plus impliquer une approbation morale de l'utilisation de lignées cellulaires provenant de fœtus avortés. La note demande de fait aux entreprises pharmaceutiques et aux agences gouvernementales de santé de «produire, approuver, distribuer et offrir des vaccins éthiquement acceptables qui ne créent pas de problèmes de conscience».
Mais la Congrégation, tout en rappelant que «la vaccination n'est pas, en règle générale, une obligation morale et donc qu'elle doit être volontaire», souligne également le devoir de rechercher le bien commun. Ce bien commun, «en l'absence d'autres moyens pour arrêter ou même prévenir l'épidémie, peut recommander la vaccination, notamment pour la protection des plus faibles et des plus exposés». Ceux qui, pour des raisons de conscience, refusent les vaccins produits avec des lignées cellulaires provenant de fœtus avortés, doivent cependant «prendre des mesures pour éviter, par d'autres moyens prophylactiques et un comportement approprié, de devenir des vecteurs de transmission de l'agent infectieux». Afin d'éviter «tout risque pour la santé de ceux qui ne peuvent être vaccinés pour des raisons cliniques ou autres et qui sont les plus vulnérables».
Enfin, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi définit comme «un impératif moral» de garantir des vaccins efficaces et éthiquement acceptables accessibles «même aux pays les plus pauvres et de façon non contraignante», car l’inaccessibilité aux vaccins «deviendrait une autre raison de discrimination et d'injustice».