De Holly Ordway sur le Catholic World Report :
La foi magnanime de J.R.R. Tolkien
L'auteur du Seigneur des Anneaux n'était pas fanatique, il avait un grand cœur. Notre culture pourrait tirer de lui une leçon sur la façon de conserver des convictions fermes tout en ayant de larges sympathies.
1er septembre 2023

"La foi de Tolkien : Holly Ordway explore la foi catholique souvent négligée du célèbre auteur. A droite : L'édition de 1988 du "Seigneur des Anneaux", publiée par William Morrow. (Image : Amazon)
J.R.R. Tolkien, qui est mort il y a cinquante ans (le 2 septembre 1973), représente un casse-tête pour notre culture diversifiée et divisée.
Le Seigneur des anneaux est un best-seller mondial. Il a été traduit en plus de cinquante langues, de l'arabe au chinois en passant par le thaï et le turc. Les adaptations cinématographiques sont appréciées par des millions de personnes qui n'ont jamais lu le livre. La série télévisée "Les anneaux du pouvoir" d'Amazon a été la plus chère jamais réalisée, et une deuxième saison est en cours de préparation.
Pourtant, le contraste entre l'auteur et le public est saisissant. Catholique fervent et traditionaliste, Tolkien priait Dieu en latin, vouait une dévotion à la Vierge Marie et qualifiait l'eucharistie de "seule grande chose à aimer sur terre". La plupart de ses lecteurs ne croient pas en ces choses et n'en ont même pas une connaissance élémentaire.
C'est un paradoxe qui mérite d'être étudié. Un homme profondément chrétien a produit une œuvre imaginative qui est fantastiquement populaire auprès des lecteurs de toutes les confessions et d'aucune.
Les biographes ont été réticents à explorer sa foi. Humphrey Carpenter, auteur de la biographie officielle, reconnaît l'importance "totale" du christianisme pour Tolkien, mais le présente surtout comme un attachement affectif à sa mère, Mabel, décédée lorsqu'il avait douze ans. Un autre biographe, Raymond Edwards, relègue la foi de Tolkien à une annexe. Jusqu'à récemment, le groupe Facebook Tolkien Society interdisait toute discussion sur la religion.
Pourquoi cette réticence ? Les gens craignent-ils que leur auteur préféré se révèle étroit d'esprit, voire se montre bigot à l'égard de ceux qui n'appartiennent pas à sa propre communauté religieuse ?
Ce sont des questions que j'ai abordées dans mon nouveau livre, Tolkien's Faith : A Spiritual Biography. Ce que j'ai découvert montre que Tolkien avait effectivement des convictions fermes, mais qu'il avait aussi de larges sympathies.
Le Seigneur des Anneaux contient un échange célèbre entre Gandalf et Frodon, au cours duquel le magicien dit au hobbit : "Ne sois pas trop pressé de distribuer la mort en jugement". Cette phrase illustre l'approche de Tolkien à l'égard de ceux qui ne partageaient pas ses convictions religieuses. Il croyait que tous les hommes étaient faits à l'image et à la ressemblance de Dieu et qu'ils avaient reçu le don de conscience. Oui, il considère que certains "rejettent leurs chances de noblesse ou de salut, et semblent 'damnables'". Mais il choisit le mot avec soin : "damnable" plutôt que "damné". Comme il le fait remarquer, "nous qui sommes tous 'dans le même bateau' ne devons pas usurper la place du Juge".
Lorsque Tolkien s'est lié d'amitié avec C.S. Lewis, ce dernier n'était pas encore le célèbre auteur de classiques chrétiens tels que Mere Christianity et les Chroniques de Narnia, mais un athée. Leur amitié n'a jamais été subordonnée à la conversion de Lewis.
Les convictions de Tolkien étaient claires : il était convaincu que l'Église catholique avait été fondée par Jésus-Christ et que saint Pierre avait été autorisé par Jésus à gouverner l'Église, cette autorité ayant été héritée par ses successeurs, les papes. Mais il admettait aussi avoir connu des prêtres "ignorants, hypocrites, paresseux, pompiers, au cœur dur, cyniques, méchants, cupides, vulgaires, snobs, et même (à vue de nez) immoraux".
Deux choses peuvent être vraies à la fois. L'Église, selon Tolkien, était "mourante mais vivante, corrompue mais sainte, autoréformatrice et réformatrice". Elle n'était pas un foyer pour les personnes déjà parfaites, mais un lieu où les pécheurs pouvaient, par la grâce de Dieu, s'améliorer. Tolkien se confessait fréquemment parce qu'il se considérait comme quelqu'un ayant besoin de cette grâce.
S'il savait où se situait sa propre loyauté spirituelle, il ne tirait pas de conclusions négatives définitives sur le statut moral, et encore moins sur la destinée éternelle, des autres. Pourquoi ? Parce que, comme le fait remarquer Gandalf, "même les très sages ne peuvent pas voir toutes les extrémités".
Dans une lettre, Tolkien explique que les catholiques doivent s'imposer des normes élevées, mais que tout jugement sur autrui doit être "tempéré par la miséricorde". Il utilisait la "double échelle" de la rigueur pour soi-même et de la miséricorde pour les autres.
En résumé, il n'y a rien à craindre de l'étude de la foi de Tolkien. Il n'était pas fanatique, il avait un grand cœur.
Notre culture pourrait tirer de lui une leçon sur la façon d'entretenir des convictions fermes tout en ayant de larges sympathies. Je pense d'ailleurs que sa capacité à trouver cet équilibre délicat est l'une des raisons pour lesquelles ses œuvres sont devenues si populaires.
Les lecteurs ont-ils l'impression que la Terre du Milieu a été produite par un homme au caractère magnanime ? Son esprit généreux est-il le ressort secret de son succès ? Je pense que ce n'est pas impossible.

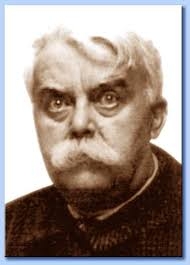 « Figure souvent méconnue de nos jours, Léon Bloy fut pourtant une figure flamboyante de la littérature française du XIXe siècle. Profondément catholique, ne vivant que pour l'absolu et détestant le « Bourgeois » - ce « cochon qui voudrait mourir de vieillesse » - son oeuvre est marquée par un style violent, éclatant, volontiers pamphlétaire. On ne saurait, toutefois, minimiser l'incroyable drôlerie qui se dégage des critiques de ses congénères. « Dans son rapport à l'absolu et à la foi, Bloy s'est rendu insupportable à ses contemporains, avec beaucoup de méthode, d'énergie et de compétence. Mais, Bloy, au fond, c'est un peu le sel. S'il n'y a pas de Léon Bloy, avec quoi salera-t-on ? », s'amuse François Angelier, auteur et producteur de l'émission « Mauvais genre » sur
« Figure souvent méconnue de nos jours, Léon Bloy fut pourtant une figure flamboyante de la littérature française du XIXe siècle. Profondément catholique, ne vivant que pour l'absolu et détestant le « Bourgeois » - ce « cochon qui voudrait mourir de vieillesse » - son oeuvre est marquée par un style violent, éclatant, volontiers pamphlétaire. On ne saurait, toutefois, minimiser l'incroyable drôlerie qui se dégage des critiques de ses congénères. « Dans son rapport à l'absolu et à la foi, Bloy s'est rendu insupportable à ses contemporains, avec beaucoup de méthode, d'énergie et de compétence. Mais, Bloy, au fond, c'est un peu le sel. S'il n'y a pas de Léon Bloy, avec quoi salera-t-on ? », s'amuse François Angelier, auteur et producteur de l'émission « Mauvais genre » sur