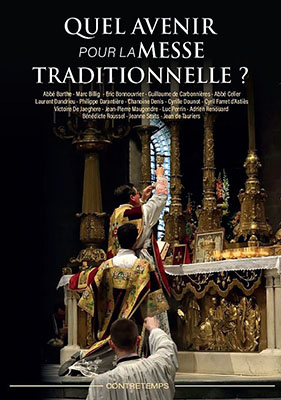Saint François de Sales (+ 28 décembre 1622): catéchèse de Benoît XVI (2 mars 2011) (source)
Chers frères et soeurs,
«Dieu est le Dieu du coeur humain» (Traité de l’Amour de Dieu, I, XV): dans ces paroles apparemment simples, nous percevons l’empreinte de la spiritualité d’un grand maître, dont je voudrais vous parler aujourd’hui, saint François de Sale, évêque et docteur de l’Eglise. Né en 1567 dans une région frontalière de France, il était le fils du Seigneur de Boisy, antique et noble famille de Savoie. Ayant vécu à cheval entre deux siècles, le XVIe et le XVIIe, il rassemblait en lui le meilleur des enseignements et des conquêtes culturelles du siècle qui s’achevait, réconciliant l’héritage de l’humanisme et la tension vers l’absolu propre aux courants mystiques. Sa formation fut très complète; à Paris, il suivit ses études supérieures, se consacrant également à la théologie, et à l’Université de Padoue celles de droit, suivant le désir de son père, qu’il conclut brillamment par une maîtrise in utroque iure, droit canonique et droit civil. Dans sa jeunesse équilibrée, réfléchissant sur la pensée de saint Augustin et de saint Thomas d’Aquin, il traversa une crise profonde qui le conduisit à s’interroger sur son salut éternel et sur la prédestination de Dieu à son égard, vivant avec souffrance comme un véritable drame spirituel les questions théologiques de son époque. Il priait intensément, mais le doute le tourmenta si fort que pendant plusieurs semaines, il ne réussit presque plus à manger et à dormir. Au comble de l’épreuve, il se rendit dans l’église des dominicains à Paris, ouvrit son coeur et pria ainsi: «Quoi qu’il advienne, Seigneur, toi qui détiens tout entre tes mains, et dont les voies sont justice et vérité; quoi que tu aies établi à mon égard...; toi qui es toujours un juge équitable et un Père miséricordieux, je t’aimerai Seigneur (...) je j’aimerai ici, ô mon Dieu, et j’espérerai toujours en ta miséricorde, et je répéterai toujours tes louanges... O Seigneur Jésus, tu seras toujours mon espérance et mon salut dans la terre des vivants» (I Proc. Canon., vol. I, art. 4). François, âgé de vingt ans, trouva la paix dans la réalité radicale et libératrice de l’amour de Dieu: l’aimer sans rien attendre en retour et placer sa confiance dans l’amour divin; ne plus demander ce que Dieu fera de moi: moi je l’aime simplement, indépendamment de ce qu’il me donne ou pas. Ainsi, il trouva la paix, et la question de la prédestination — sur laquelle on débattait à cette époque — s’en trouva résolue, car il ne cherchait pas plus que ce qu’il pouvait avoir de Dieu; il l’aimait simplement, il s’abandonnait à sa bonté. Et cela sera le secret de sa vie, qui transparaîtra dans son oeuvre principale: le Traité de l’amour de Dieu.
En vainquant les résistances de son père, François suivit l’appel du Seigneur et, le 18 décembre 1593, fut ordonné prêtre. En 1602, il devint évêque de Genève, à une époque où la ville était un bastion du calvinisme, au point que le siège épiscopal se trouvait «en exil» à Annecy. Pasteur d’un diocèse pauvre et tourmenté, dans un paysage de montagne dont il connaissait aussi bien la dureté que la beauté, il écrivit: «[Dieu] je l’ai rencontré dans toute sa douceur et sa délicatesse dans nos plus hautes et rudes montagnes, où de nombreuses âmes simples l’aimaient et l’adoraient en toute vérité et sincérité; et les chevreuils et les chamois sautillaient ici et là entre les glaciers terrifiants pour chanter ses louanges» (Lettre à la Mère de Chantal, octobre 1606, in OEuvres, éd. Mackey, t. XIII, p. 223). Et toutefois, l’influence de sa vie et de son enseignement sur l’Europe de l’époque et des siècles successifs apparaît immense. C’est un apôtre, un prédicateur, un homme d’action et de prière; engagé dans la réalisation des idéaux du Concile de Trente; participant à la controverse et au dialogue avec les protestants, faisant toujours plus l’expérience, au-delà de la confrontation théologique nécessaire, de l’importance de la relation personnelle et de la charité; chargé de missions diplomatiques au niveau européen, et de fonctions sociales de médiation et de réconciliation. Mais saint François de Sales est surtout un guide des âmes: de sa rencontre avec une jeune femme, madame de Charmoisy, il tirera l’inspiration pour écrire l’un des livres les plus lus à l’époque moderne, l’Introduction à la vie dévote; de sa profonde communion spirituelle avec une personnalité d’exception, sainte Jeanne Françoise de Chantal, naîtra une nouvelle famille religieuse, l’Ordre de la Visitation, caractérisé — comme le voulut le saint — par une consécration totale à Dieu vécue dans la simplicité et l’humilité, en accomplissant extraordinairement bien les choses ordinaires: «... Je veux que mes Filles — écrit-il — n’aient pas d’autre idéal que celui de glorifier [Notre Seigneur] par leur humilité» (Lettre à Mgr de Marquemond, juin 1615). Il meurt en 1622, à cinquante-cinq ans, après une existence marquée par la dureté des temps et par le labeur apostolique.