De Youna Rivallain sur le site "Le Monde des Religions" :
PERSÉCUTIONS RELIGIEUSES
« La conversion des musulmans au christianisme est trop peu évoquée »
Algérien, le père Paul-Élie Cheknoun est un ancien musulman devenu catholique, et il accompagne de nombreux musulmans désirant se convertir. Il est l’un des invités de la 10e Nuit des Témoins, qui accueille jusqu’au 19 mars des fidèles de pays où les chrétiens sont victimes de persécutions.
Jusqu’au 19 mars 2018 a lieu la Nuit des Témoins organisée par l'Aide à l'Église en détresse. Des veillées de prière sont dédiées à ceux qui souffrent de persécution à cause de leur foi. Pour cette dixième édition – organisée cette année à Montpellier, Paris, La Roche-sur-Yon, Rouen, au Luxembourg et à Rome –, l'organisation œuvrant dans 150 pays a invité trois témoins venus du Mexique, d’Égypte et d’Algérie.
Originaire de ce dernier pays, le père Paul-Élie Cheknoun est un ancien musulman devenu évangélique, puis catholique et ordonné prêtre en 2016. Aujourd'hui prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon, la vie du père Cheknoun s'organise entre la France, où il évangélise parmi les musulmans, et l'Algérie, où il accompagne les convertis de l'islam vers le christianisme. «Un phénomène trop peu évoqué», d'après lui.
Comment se déroule une conversion de l'islam vers le christianisme en Algérie ? Quels sont les obstacles ?
Ils sont nombreux. Officiellement, l'islam est la religion d'État, mais la République d'Algérie est laïque, autorisant la liberté de culte, et donc l'apostasie. Cependant, nombre de décideurs politiques sont musulmans et tendent à privilégier la loi islamique.
Le phénomène de conversion de l'islam vers le christianisme est massif : les Églises évangéliques, qui enregistrent le plus de conversions, parlent aujourd'hui de dizaines de milliers de convertis, bien que les chiffres restent très peu précis.
De fait, le gouvernement a réagi à ce phénomène. Par exemple, une loi de 2006 a eu pour objectif d'endiguer les conversions : tous les missionnaires du pays ont été expulsés. Ainsi, si l'État garantit officiellement la liberté de confession, la réalité du terrain est bien différente : conformément à la sharia, les apostats sont rejetés par leur famille, menacés de mort ou de mise en quarantaine, et doivent fuir.
Ma mission est tant que prêtre est d'accompagner ces convertis rejetés par les leurs et dispersés dans tout le pays, à travers l'administration des sacrements, les enseignements, la célébration de la messe en kabyle ou en arabe… Une fois par an, l'Église d'Algérie organise également des rassemblements, afin de les regrouper et de les accompagner dans leur conversion. Cependant, nous conseillons à tous les convertis d'être discrets et de ne pas exposer leur religion de manière visible. Certains, en Algérie, ne supportent même pas la vue d'une croix.
Vous évangélisez également les musulmans en France. Comment êtes-vous accueilli?
La proportion de musulmans intégristes en France est plus importante que dans les pays dits musulmans, pour la simple et bonne raison que pour les fidèles issus de l'immigration, l'islam est devenu une identité. La plupart des djihadistes ayant rejoint l'État islamique sont d'ailleurs originaires d'Europe ! Beaucoup se convertissent également en Europe, et il est bien connu que les convertis sont souvent plus radicaux que les musulmans dits « de souche ».
Je fais partie de la Fraternité missionnaire Jean-Paul II à Fréjus, et nous faisons souvent de l'évangélisation directe, c'est-à-dire dans la rue, sur la plage, etc. Nous rencontrons beaucoup de musulmans. Je suis souvent trahi par mon « faciès » : nombre de ceux que je rencontre perçoivent que je suis d'origine maghrébine. Lorsque je dis que je suis algérien, ils comprennent alors que je suis apostat, et me rappellent que l'apostasie est punie de mort. Je dirais donc que l'évangélisation des musulmans marche mieux avec mes frères prêtres de la communauté qu'avec moi. Je participe en revanche à de nombreuses conférences ou enseignements, où je témoigne de mon expérience en tant que converti.
Vous avez été évangélique avant de vous convertir au catholicisme. Les évangéliques ont-ils plus de facilité à diffuser le message de l'Évangile en Algérie ?
On évoque souvent les difficultés de l'Église catholique en termes d'évangélisation, face à des évangéliques plus zélés. L'Église catholique est une institution officielle, hiérarchisée et surtout très visible, ce à quoi échappent les évangéliques qui bénéficient de structures indépendantes et parsemées qui les rendent plus discrets. Tandis que pour devenir prêtre, un catholique doit faire dix ans d'études, les évangéliques ont bien plus de facilité à former rapidement et discrètement la population locale. Ce type de formation s'est avéré très utile lorsque que la loi contre le «prosélytisme» en Algérie a été votée en 2006 : tous les missionnaires ayant été chassés du pays, les évangéliques ont repris la direction de leurs lieux de culte, tout en restant discrets.
Ainsi, lorsque les islamistes décident de tuer des chrétiens, ils tuent des catholiques car ils représentent les chrétiens « visibles » : nous avons des églises, des diocèses… Cependant, la situation des évangéliques a aussi empiré dernièrement : clandestins dans les années 90, leurs lieux de culte étaient autorisés depuis cinq ou six ans. Hélas, depuis un mois, l'État algérien a entrepris de fermer les temples un par un.
Avez-vous pu témoigner du phénomène des conversions en France ?
Tous les ans, nous organisons des rassemblements de convertis en France, et nous pouvons rendre compte de centaines de musulmans dans ce cas. C'est un phénomène de plus en plus répandu : beaucoup de musulmans rejoignent des Églises évangéliques, ainsi que l'Église catholique – même s'ils sont moins nombreux. Cependant, on ne parle pas de ce phénomène : je pense que c'est parce que ce n'est pas politiquement correct d'aborder cette question.
À Toulon, la proportion de personnes issues de l'islam est en augmentation constante parmi les catéchumènes adultes, et ce chaque année – de l'ordre de 10 à 15 %. Mais, encore une fois, ce phénomène n'est jamais abordé. C'est pour ça qu'il était important pour moi de participer à la Nuit des Témoins : je veux témoigner de ma conversion.
Quel regard les chrétiens d'Algérie portent-ils sur la béatification, annoncée récemment, des 19 religieux et religieuses assassinés dans le pays entre 1994 et 1996, dont les 7 moines de Tibhirine ?
Pour nous, c'est une grande fête ! Nous sommes en train de chercher un lieu pour la célébrer. Les béatifications devraient se dérouler à Oran, à l'automne, en présence du pape. Nous sommes actuellement en négociation avec le gouvernement algérien qui, si la cérémonie a lieu en Algérie, souhaiterait insérer ces béatifications dans le cadre de commémorations en mémoire des 200 000 victimes de la guerre civile algérienne, chrétiennes et musulmanes – 99 imams avaient notamment été assassinés pour avoir refusé de justifier la violence. En cas de refus du gouvernement, cet événement devrait avoir lieu en France.
Comment voyez-vous l'avenir de l'Église catholique en Algérie ? Pensez-vous que le traitement des apostats s'améliorera ?
Il est pour moi essentiel que chacun puisse vivre sa foi aussi librement que possible et découvre l'amour de Dieu. Ma mission est de soutenir les chrétiens, convertis ou non.

 Plusieurs livres récents évoquent l’engagement des chrétiens dans la cité avec pour toile de fond un monde occidental qui n’est plus chrétien, preuve qu’il s’agit là d’une question majeure. Petit tour d’horizon de ces différents ouvrages par Christophe Geffroy, dans le mensuel « La Nef », mars 2018 :
Plusieurs livres récents évoquent l’engagement des chrétiens dans la cité avec pour toile de fond un monde occidental qui n’est plus chrétien, preuve qu’il s’agit là d’une question majeure. Petit tour d’horizon de ces différents ouvrages par Christophe Geffroy, dans le mensuel « La Nef », mars 2018 :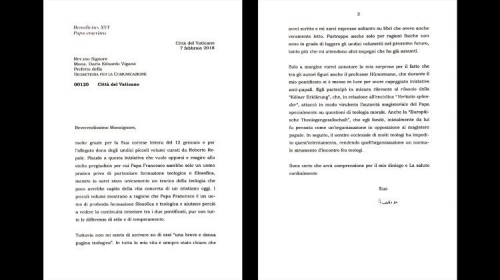 Nous avions parlé
Nous avions parlé