La vie de saint Eleuthère (source)
Le Missel diocésain est assez bavard au sujet d’Eleuthère : « Issu d’une grande famille de la région de Tournai, Eleuthère serait le descendant d’un converti de saint Piat. Il fut élevé, avec son ami saint Médard, à la cour des monarques mérovingiens dont Tournai était la résidence. En 486, le christianisme étant en suspicion, Eleuthère se réfugie à Blandain. En 495, la conversion de Clovis change la destinée d’Eleuthère : il est choisi comme évêque de Tournai et sacré par saint Rémy.
L’implication du politique et du religieux – qui est un des aspects de la société mérovingienne – amène sans doute Eleuthère à assumer les responsabilités du pouvoir. Il s’efforce de reconquérir son peuple contre le paganisme et l’hérésie. Il sera victime des hérétiques : assailli et enlevé par eux, il est blessé et laissé pour mort. Il succomba à la suite de ses blessures (536). Il eût mérité le titre de martyr ».
Ainsi, Eleuthère serait né vers 456 sous Childéric, roi des Francs salins (dont la cour était à Tournai). C’est d’ailleurs la présence de la cour à Tournai qui valut sans doute à cette ville de devenir siège épiscopal.
Eleuthère appartenait à une famille chrétienne où se transmettait pieusement le souvenir d’un aïeul non seulement converti par saint Piat, mais même martyrisé avec lui. Il avait reçu au baptême le beau nom grec d’Eleuthère (eleutheros : « libre »).
Eleuthère a dû faire partie de ces jeunes nobles élevés et formés à la cour ; sans doute a-t-il dès lors connu Clovis qui avait sensiblement le même âge que lui. Il semble aussi qu’il y ait alors connu Médard – malgré la différence d’âge – celui-ci, né vers 470, devait avoir une quinzaine d’années de moins que lui.
Selon la tradition, c’est en 486 qu’il serait devenu évêque (selon d’autres, en 495, donc à l’âge de 40 ans). Il soutint ses fidèles dans leurs difficultés. Mais, ses adversaires lui rendant la vie intenable, il quitta le cœur de la ville pour s’installer à quelques kilomètres de là, à Blandain, probablement dans une propriété familiale d’où il dirigea quelques années son immense diocèse avant de rentrer à Tournai. Et puis, il se mit à évangéliser avec ardeur les Francs qui s’étaient installés dans la région : les Barbares, et aussi ceux qui étaient devenus ariens (les ariens nient la divinité du Christ).
Le baptême de Clovis, à la fin du Ve siècle, dut grandement réjouir Eleuthère – et changea sans doute la donne dans l’opposition qu’il avait rencontrée parmi les habitants de Tournai ; beaucoup d’entre eux acceptèrent alors le baptême, à l’exemple de Clovis, l’enfant du pays. Selon la légende, Eleuthère baptise, en une semaine, onze mille païens.
Saint Eleuthère aurait été évêque pendant quarante ans, d’où sa grande célébrité.
Il aurait été deux fois à Rome pour y demander conseil : il rencontra d’abord le pape Symmaque (qui exerça son ministre de 498 à 514), puis le pape Hormisdas (514-523) : celui-ci lui remit des reliques qu’il rapporta pieusement dans son église et qui furent l’occasion, de la part de son peuple, d’un accueil triomphal en procession jusqu’à sa cathédrale.
En 531 ou 532, des hérétiques ne lui pardonnèrent pas d’avoir organisé un synode à Tournai (sur la Trinité, sur la divinité du Christ) et lui tendirent une embuscade alors qu’il sortait de la Cathédrale. Grièvement blessé, l’évêque devait mourir peu de temps après des suites de ses blessures. C’est pourquoi la tradition aimerait en faire un martyr mais comme il n’est pas mort sur le coup et qu’il a survécu quelques semaines à cet attentat, il n’a pas reçu officiellement ce titre. Avant de mourir, il implora le pardon pour ses meurtriers.
Fête liturgique : 20 février


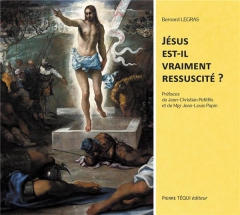 Jésus est-il vraiment ressuscité ?
Jésus est-il vraiment ressuscité ?