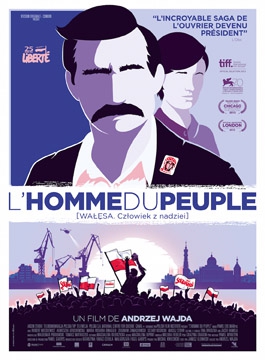Lu sur ce site canadien :
Rémi Brague : « Dans les gènes de l'islam, l'intolérance »
Rémi Brague est philosophe et historien de la pensée médiévale arabe et juive. Il est l’auteur, entre autres, de « Europe, la voie romaine » (1999), « La loi de Dieu. Histoire philosophique d’une alliance » (Gallimard, 2005), et de « Modérément moderne » (Flammarion, 2014). Il s’exprime au sujet des assassinats de Charlie Hebdo :
« L’attentat contre les dessinateurs de Charlie Hebdo rappelle de vieilles histoires qu’il me faut malheureusement rappeler ici.
À l’époque de Mahomet, dans l’Arabie du début du VIIe siècle, il n’y avait évidemment pas de journalistes, faute de journaux, d’imprimerie, etc. Mais il y avait des poètes. Leurs vers, transmis d’abord de bouche à oreille, pouvaient être louangeurs ou satiriques. Ils influençaient l’opinion, comme le font de nos jours les organes de presse. Lorsque Mahomet se mit à prêcher son dieu unique, prétendit en être le messager et se mit à légiférer en Son nom, déclarant ceci « permis » ou cela « interdit », certains de ces poètes se moquèrent de lui. Mahomet savait pardonner à ceux qui l’avaient combattu, mais ne tolérait pas qu’on mette en doute sa mission prophétique. Il demanda donc qui allait le débarrasser de ces poètes. Des volontaires se présentèrent et les assassinèrent. Ils tuèrent d’abord Ka'b ibn Achraf, un juif, puis Abou Afak, un vieillard, enfin Asma bint Marwan, une femme qui allaitait. Leurs meurtres sont racontés dans la plus ancienne biographie de Mahomet, « La vie de l’envoyé d’Allah » (Sirâ) d’Ibn Ichak, éditée par Ibn Hicham vers 830. Abdourrahman Badawi en a donné une traduction rocailleuse, mais intégrale (Beyrouth, Albouraq, 2001, 2 vol.), qu’on préférera aux nombreuses adaptations de ce texte, qui sont toutes plus ou moins romancées. Mahomet assura les assassins qu’ils n’avaient commis aucune faute, un peu dans l’esprit du verset du Coran : « Ce n’est pas vous qui les avez tués ; mais Dieu les a tués » (sourate VIII, verset 17 a).
On comprend l’embarras des musulmans d’aujourd’hui. Je ne possède pas de statistiques fondées sur des sondages d’opinion parmi eux, mais tout nous invite à croire que leur grande majorité désapprouve ces crimes. Et, en tout cas, ceux qui s’expriment les condamnent sans nuances. Ce qui est à leur honneur. Mais, au-delà du refus constamment réitéré, et d’ailleurs légitime, de l’« amalgame » et de la « stigmatisation », comment dire que ces agissements n’ont rien à voir avec l’islam ? Le Coran appelle Mahomet « le bel exemple » (sourate XXXIII, verset 21), qu’il est loisible, voire louable, d’imiter. Comment ne pas comprendre que certains se croient autorisés à commettre en son nom et pour le venger ce genre de crimes ? »

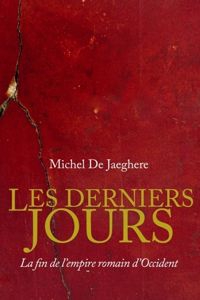 Sur FIGAROVOX
Sur FIGAROVOX