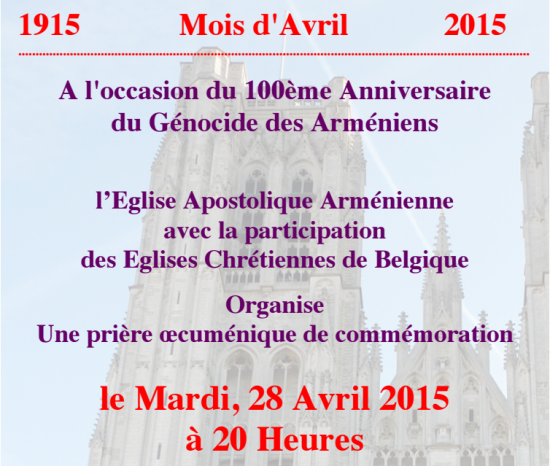
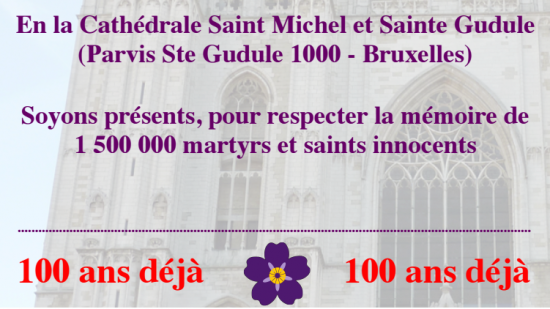
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
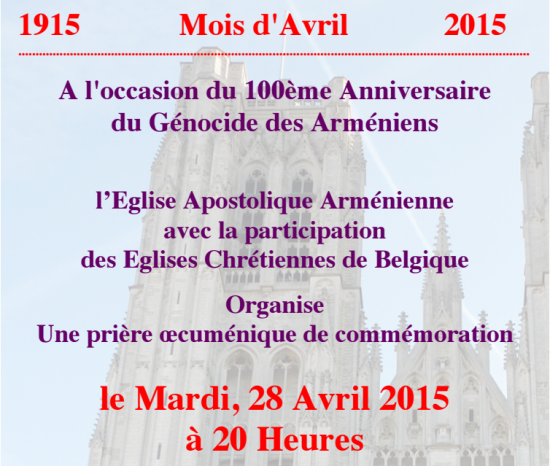
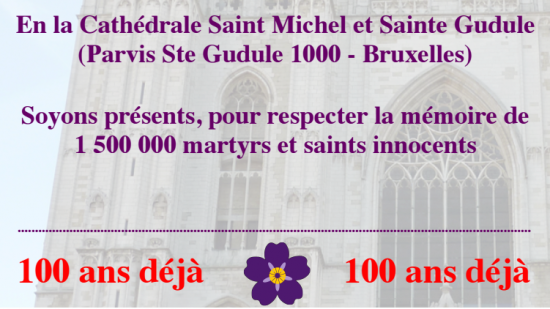
Audience au Synode patriarcal de l'Eglise arménienne
Cité du Vatican, 9 avril 2015 (VIS). Le Saint-Père a reçu les vingt évêques du Synode patriarcal de l'Eglise arménienne qui prendront part dimanche à la messe qu'il célébrera en la Basilique vaticane à l'occasion de la fête de saint Grégoire de Narek. Rappelant d'emblée qu'il s'agira d'une prière de suffrage pour tous les fidèles arméniens assassinés il y a cent ans: Ensemble "nous invoquerons la divine miséricorde afin qu'elle nous aide tous à guérir cette blessure dans l'amour de la vérité et de la justice, et à trouver au plus tôt le chemin de la réconciliation et de paix entre des peuples qui ne sont pas encore parvenus à un consensus raisonnable sur la lecture de ce drame". Saluant le clergé, les religieux, les séminaristes et les fidèles de cette Eglise orientale catholique, il a signalé qu'outre ceux provenant de l'Arménie, seront présents dimanche des arméniens catholiques de la diaspora, des Etats-Unis et d'Amérique latine, d'Europe, de Russie et d'Ukraine: "C'est avec tristesse que je pense à ces régions comme celle d'Alep qui furent il y a un siècle des lieux d'accueil des survivants et sont aujourd'hui en péril les chrétiens" eux mêmes. Evoquant la conversion de l'Arménie dès 301, le Pape François a rappelé "l'admirable patrimoine spirituel et culturel du peuple arménien...et sa capacité millénaire de surmonter épreuves et persécutions. Toujours reconnaissants envers le Seigneur, continuez de lui être fidèles", en lui demandant la sagesse du coeur car commémorer les victimes de 1915 "nous place devant les ténèbres du Mysterium Iniquitatis. L'Evangile nous dit que les forces les plus obscures peuvent naître dans le coeur de l'homme et en arriver à programmer l'anéantissement systématique d'êtres humains, considérés non comme frères mais comme ennemis et adversaires, comme des individus sans dignité. Pour les croyants, la question du mal reconduit au mystère de la Passion rédemptrice. Nombre des arméniens assassinés ou contraints à un exode interminable ont su prononcer le nom du Christ. Les pages dramatiques de l'histoire arménienne, qui prolongent d'une certaine manière la Passion du Christ, contiennent le germe d'une résurrection, et il est du devoir des pasteurs d'éduquer les fidèles à la nécessité de relire le passé avec des yeux neufs, de manière à comprendre que leur peuple n'est pas que celui des souffrances du Christ mais aussi de la résurrection. S'il est important d'avoir la mémoire du passé, il faut savoir en tirer de quoi alimenter le présent avec l'annonce évangélique et le témoignage de la charité. Soutenez donc un parcours de formation permanente du clergé et des personnes consacrées, vos premiers collaborateurs. Leur communion avec vous sera renforcé par une fraternité exemplaire pleinement exprimée au sein du Synode et avec votre Patriarche". Pensons aussi à tous ceux qui oeuvrèrent en faveur de vos ancêtres, tel Benoît XV qui s'adressa au Sultan Méhmet VI en vue de faire cesser les pogroms d'arméniens. "Grand ami de l'Orient chrétien, il déclara en 1920 saint Efrem docteur de l'Eglise universelle. Et je suis heureux que notre rencontre advienne à la veille de la même démarche que je ferai dimanche à l'attention de saint Grégoire de Narek, auquel je confie le dialogue entre votre Eglise et l'Eglise apostolique d'Arménie". L'oecuménisme du sang vous lie à elle.
 Et si l'héritage du pape polonais était plus vital que ce nous voulons en voir ? Bilan sur la dette que l'Eglise catholique a envers Jean Paul II. Une « paposcopie » de Jean Mercier (JPSC) :
Et si l'héritage du pape polonais était plus vital que ce nous voulons en voir ? Bilan sur la dette que l'Eglise catholique a envers Jean Paul II. Une « paposcopie » de Jean Mercier (JPSC) :
« Il y a dix ans exactement, je m’envolais vers Rome pour couvrir les derniers instants de Jean Paul II. Moments extraordinaires, presque irréels, que je ne me remémore jamais sans émotion, voire une certaine nostalgie. La longue attente, pendant plus de 24 heures sur la Place Saint-Pierre, dans la nuit froide, et puis l’annonce de la mort, suivie du son lancinant du glas... Comment oublier ce soulagement presque joyeux qui a envahi la foule (surtout italienne) ce 2 avril 2005, sur la Place Saint-Pierre ? Seuls les Polonais apparaissaient glacés de chagrin...
Dix ans après, que reste t-il de Jean Paul II ? On a parfois l’impression que l’héritage s’est un peu perdu dans les sables, en raison du pontificat très “solaire” de Bergoglio, qui semble éclipser le tandem Wojtyla-Ratzinger. Il me semble au contraire qu’il nous reste un très fort héritage, bien plus fort en tous cas qu’une analyse trop politique le laisserait croire. Il s’agit de scruter les profondeurs.
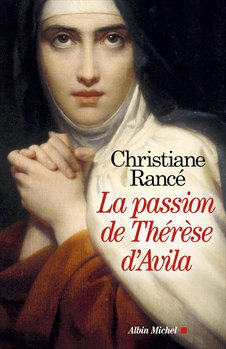 Lu sur la-croix.com (Claire Lesegretain):
Lu sur la-croix.com (Claire Lesegretain):
« Thérèse d’Avila, c’est l’action amoureuse ! »
Alors que l’on célèbre, samedi 28 mars, le 500e anniversaire de la naissance de sainte Thérèse d’Avila, la romancière Christiane Rancé publie une excellente biographie de cette grande mystique espagnole (1).
ENTRETIEN avec Christiane Rancé, romancière et essayiste
Pourquoi la jeune Teresa de Ahumada y Cepeda décide-t-elle d’entrer au carmel à l’âge de 20 ans alors qu’elle aimait tant plaire ?
Christiane Rancé : Elle-même n’a pas tout dit à ce sujet… Dans son autobiographie, elle dit qu’elle a été heureuse chez les augustines du couvent de Notre-Dame-de-Grâce lorsque son père l’y a envoyée à l’âge de 16 ans. Et pourtant, ces 18 mois d’internat étaient une mesure disciplinaire : elle s’était conduite de façon très dissipée avec ses cousins ; elle avait un amoureux qu’elle retrouvait en cachette. Rien d’irrémédiable n’avait été commis, dit-elle, mais sa réputation était menacée.
De plus, après le mariage de sa sœur Maria, Thérèse – orpheline de mère depuis l’âge de 13 ans – portait la charge de la maison. Elle avait une petite sœur et neuf frères. Dans l’Espagne du XVIe siècle, les femmes ne pouvaient vivre qu’à l’ombre d’un père, d’un mari ou d’un prêtre. Mais son père s’étant appauvri, il ne pouvait lui allouer la dot dont il avait gratifié sa fille aînée. Thérèse ne pouvait donc plus prétendre à un beau mariage. Et puis elle a vu sa mère mourir à 33 ans, épuisée à la naissance de son neuvième enfant. Enfin, à Notre-Dame-de-Grâce, elle a trouvé une bibliothèque et la conversation d’une religieuse érudite et inspirée. Et après une lecture édifiante chez un vieil oncle, elle jure de se faire religieuse : « Je voyais que c’était l’état le plus sûr et peu à peu je me décidai à me faire violence pour l’embrasser », écrira-t-elle.
Quelle influence ses lectures spirituelles ont-elles eu dans son parcours intérieur ?
C. R. : Enfant, Thérèse lit quelques hagiographies. Au couvent, elle dévore tous les grands auteurs chrétiens qui viennent d’être traduits en castillan. Elle subit deux très fortes influences : celle de Francisco de Osuna, et son « Troisième abécédaire spirituel », et surtout, celle de saint Augustin dont les « Confessions » la bouleversent.
De Dominique de la Barre sur le site du journal suisse « Le Temps » :
« A première vue, Pie XII et le pape François présentent peu de traits communs. Le premier affiche une figure élancée d’aristocrate, le second, d’origine modeste, une physionomie rondouillarde; l’un fait une carrière brillante au sein de la curie, tandis que l’autre se révélera un évêque de proximité; là où Pie XII adopte une attitude hiératique, François fait appel à un langage simple, voire familier. Pourtant, à septante ans de distance, un point les réunit, à savoir la difficulté à déterminer la bonne réponse à apporter face à des forces hostiles à l’Eglise comme à l’humanité tout entière.
Eugenio Pacelli est élu pape alors que règne le temps des totalitarismes et des guerres. Bon connaisseur de l’Allemagne pour y avoir vécu dix-sept ans, il devra aborder la question de l’attitude à adopter envers le nazisme et sa conception païenne de l’homme. On a beaucoup reproché à Pie XII ses silences face à la Shoah mais à vrai dire ces silences se font entendre dès l’invasion allemande de la Pologne, pays de tradition catholique, à laquelle fera suite une occupation d’une extrême brutalité, au cours de laquelle six millions de Polonais trouveront la mort, dont trois millions de juifs et trois millions de «gentils». Dès 1939, ceux-ci attendront en vain une condamnation des violences nazies; en majorité catholiques, les Polonais s’attendent à ce que le pape veille en premier lieu sur ses propres ouailles, qu’il réprouve les violences commises par les Allemands, dont environ un quart sont aussi catholiques, et qu’il expose de manière claire ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. En vain. Pie XII, alors fraîchement élu, s’en tiendra à une stricte neutralité entre les belligérants et à une diplomatie discrète. Lorsque la réalité de la Shoah deviendra claire, Pie XII sera pressé de toutes parts d’élever la voix en public contre ce qui apparaît de plus en plus nettement comme une extermination systématique des juifs d’Europe. En 1942, à l’occasion du message radiodiffusé de Noël, le pape prononcera la phrase suivante: «Ce vœu [de mettre fin à la guerre], l’humanité le doit à des centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, par le seul fait de leur nationalité ou de leur race, sont vouées à la mort ou à une progressive disparition.»
Saint-Héribert (source)
 (...) Saint Héribert fut à la fois un grand homme d'État, chancelier de l'empire germanique, et un éminent pontife, archevêque de Cologne.
(...) Saint Héribert fut à la fois un grand homme d'État, chancelier de l'empire germanique, et un éminent pontife, archevêque de Cologne.
Héribert naquit vers l'an 970; il était fils du comte Hugo de Worms. Ses études commencées à l'école du chapitre de cette ville, se continuèrent à l'abbaye de Gorze, près de Metz, où il surpassa les moines par l'étendue de son savoir, ses connaissances théologiques et sa profonde piété. A son retour, l'évêque de Worms le nomma prévôt de la cathédrale, l'ordonna prêtre et le fit entrer dans la chancellerie royale, où convergeaient toutes les activités politiques et administratives de l'empire.
Le jeune clerc n'aurait pu recevoir une meilleure formation diplomatique, mais son séjour à la chancellerie devait en plus avoir une importance décisive sur le cours de sa vie, car c'est là qu'il fut remarqué et apprécié par l'empereur Othon III. Celui-ci en fit, en 993, son chancelier pour les affaires d'Italie, pays compris dans le saint empire romain germanique, et son conseiller intime, son compagnon inséparable. Il voulut aussi lui confier l'évêché de Wurzbourg, mais Héribert se désista en faveur de son frère Henri.
Héribert devait la ferveur royale à son service désintéressé pour l'État Il n'aspirait pas, comme la plupart des nobles de l'entourage impérial, à étendre les possessions de son lignage. Demeurant toujours dans le voisinage d'Othon, il s'appliquait à déjouer les plans irréfléchis de l'impétueux et inexpérimenté monarque, comme inversement de favoriser toutes ses bonnes dispositions et ses actes généreux de dévotion, Il l'accompagna dans ses deux premières expéditions à Rome, assista à son couronnement en 996 et participa activement à plusieurs conciles. Il influença efficacement l'élection de deux papes pieux et capables, Grégoire V et Sylvestre II.

Mgr Delville, évêque de Liège, célébrera l'Eucharistie de la fête de la Bse Eve de Saint-Martin, le lundi 16 mars à 19h.
Il nous rappellera le rôle de la recluse Eve qui accompagna et encouragea sainte Julienne de Cornillon, puis promut l'institution universelle de la Fête-Dieu après son décès. Mgr Jean-Pierre nous invitera surtout à vivre de plus en plus dans l'amour qui animait ces deux saintes pour Jésus-Eucharistie et pour l'adoration eucharistique.
Après la célébration, verre de la fraternité et visite dans la basilique de nombreuses oeuvres d'art du "circuit Bse Eve de Saint-Martin".
La bienheureuse Ève de Liège, recluse à Saint-Martin (source)
Nous sommes peu renseignés sur la vie de la bienheureuse Ève sinon son implication dans la reconnaissance officielle de la Fête-Dieu dans l'Église. La vie de cette recluse est étroitement liée à celle de sainte Julienne du Mont-Cornillon, inspiratrice de cette fête. Unies par l'amitié et par leur amour commun envers l'Eucharistie, ces deux femmes du treizième siècle consacreront tous leurs efforts humains et spirituels pour que s'accomplisse le désir de Dieu de voir cette nouvelle fête instituée dans l'Église.

 De Zenit.org :
De Zenit.org :
Film sur Pie XII : "Shades of Truth", un succès avant même sa sortie en salle
La réalisatrice des "Ombres de vérité" répond aux critiques
Antonio Gaspari
Le film "Shades of Truth", "Ombres de vérité", écrit et réalisé par Liana Marabini a été présenté à Rome le 2 mars. Il est produit par Condor Pictures.
Des acteurs d’exception, parmi lesquels Christophe Lambert, Marie-Christine Barrault, Giancarlo Giannini, Remo Girone, Gedeon Burkhard, David Wall, pour un film qui sera présenté hors concours, à l’occasion du Festival de Cannes et pendant les dix jours de la Rencontre mondiale des familles, en septembre 2015, à Philadelphie (Etats-Unis).
Le film raconte l’histoire d’un journaliste chargé de mener une enquête sur Pie XII. Très sceptique et critique au début, il rencontre des témoins qui vont peu à peu remettre sa thèse en question. Au cours des différentes rencontres avec des personnes qui ont survécu à l’holocauste, ou avec leurs enfants, l’enquêteur découvre que Pie XII n’a pas été un pape craintif qui n’aurait pas réussi à s’opposer à Hitler, mais qu’il a réellement réussi à sauver des centaines de milliers de juifs des chambres à gaz.
Devant les réactions à la projection du film ont été vives, parfois critiques et polémiques, mais parfois aussi très élogieuses, ZENIT a rencontré la réalisatrice, Liana Marabini.
Zenit - Les réactions à la projection du film ont été variées. Certaines sont très positives, d’autres neutres et quelques-unes très négatives. Vous y attendiez-vous ?
Liana Marabini - Oui, je m’y attendais. C’est un sujet très controversé et il est normal que les réactions soient de toutes sortes. Personne ne peut être assez ingénu pour penser que les avis seront unanimes. Le but du film est de faire parler de Pie XII et des injustices qu’il a subies et qu’il subit encore, en apportant des preuves étayées : non pas des preuves inédites, mais une sélection de celles qui existent déjà et il y en a énormément. Le film a été pensé non comme un monument historique mais comme une fenêtre ouverte sur une période controversée et il donne un espace pour permettre d’approfondir le sujet. Pie XII est le personnage le plus incompris du XXème siècle, alors c’est bien de chercher à expliquer un peu les choses, surtout le pourquoi de son silence.
Il ne faut pas ensevelir le pape Pacelli sous les cendres de l’oubli que l’histoire accumule parfois sur les choses et sur les personnes.
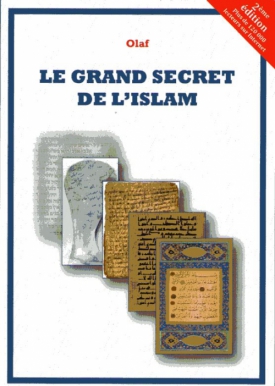 Le grand secret de l'islam - 2éme édition
Le grand secret de l'islam - 2éme édition
 (Source : Zenit.org)
(Source : Zenit.org)
"Ombres de vérité", un film sur l'action de Pie XII en faveur des juifs
Federico Cenci
- Le film-enquête « Shades of Truth » (Ombres de vérité), sur l'action de Pie XII en faveur des juifs pendant la shoah, a été projeté en avant-première à l’Institut « Maria Bambina » de Rome, le 2 mars 2015, jour anniversaire de sa naissance et de son élection comme pape.
Réalisé par l'historienne Liana Marabini, il sera présenté en mai au Festival de Cannes, et en septembre à Philadelphie, lors de la VIIIème Rencontre mondiale des familles à laquelle participera le pape François.