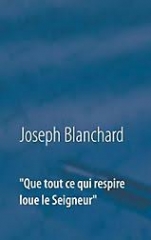Du site de France Catholique :
ENTRETIEN AVEC LE P. MICHEL GITTON
L’art d’être chrétien
propos recueillis par Aymeric Pourbaix

Quel rôle pour l’église dans une société pluraliste et relativiste ?
Père Michel Gitton : D’abord d’être une sorte de poil à gratter, qui empêche la bonne conscience libérale et ce qu’on nomme tellement justement « la pensée unique » de se croire seules détentrices des valeurs.
Ensuite, elle peut susciter le débat, et faire découvrir la sagesse dont elle est porteuse, elle qui a une mémoire, ce que n’ont plus les principaux acteurs de la société actuelle. Ayant une mémoire, elle a aussi une capacité d’envisager l’avenir autrement qu’à travers les statistiques.
Enfin, sa grande affaire, c’est d’évangéliser tous azimuts et de prouver ainsi par les faits son dynamisme reçu de l’Esprit Saint.
La foi ne peut déserter le terrain des faits, dites-vous. C’est une tentation moderne ?
La tentation gnostique est de tous les temps. Mais aujourd’hui où nous naviguons dans le virtuel, il est si facile de prendre ses désirs pour des réalités, ses bons sentiments pour des œuvres de charité et de miséricorde, la dernière opinion parue sur les réseaux sociaux pour une certitude définitive…
« Au milieu des ruines nous avons tout à reconstruire » : le chantier semble immense, voire disproportionné à vues humaines. Y a-t-il des précédents historiques ?
J’en vois au moins deux : quand, après les invasions barbares, il a fallu que l’Église d’Occident réinvente une culture, redonne le goût et les moyens d’un travail méthodique sur les textes, la musique, la pensée.
Et également – avec moins de brio, mais de façon aussi courageuse – quand après la Révolution et l’Empire, l’Église, se retrouvant dans une situation très différente de ce qui avait été la sienne avant 1789, a su rejoindre une nouvelle sensibilité. Et retrouver les besoins profonds du peuple français, forger des modèles, etc.
Une des difficultés actuelles consiste à vouloir prendre un parti dans les questions de foi. L’unité des catholiques est-elle encore possible ?
Je le crois, nous ne sommes plus dans les années 1980. Notamment chez les jeunes, on cherche là où il y a du solide et une cohérence avec la vie spirituelle. Il ne s’agit pas d’un retour en arrière ou d’une mode rétro. Tant qu’à risquer sa vie sur le Christ, on n’imagine pas que la foi soit un contenu fluent à dimension variable.
Comment prendre les questions par le haut, comme vous le suggérez ?
En acceptant de se dépayser et de faire le détour par les sources de la Révélation : la sainte Écriture, lue et méditée, les Pères de l’Église, la Tradition et le Magistère de l’Église, les maîtres de la vie spirituelle. Cela ne nous donnera pas forcément une réponse toute faite, surtout si la question est nouvelle. Mais nous trouverons dans cette référence le recul nécessaire pour aller au cœur du sujet. Nous n’avons pas à inventer le christianisme, mais nous avons à interroger à nouveaux frais cette sagesse qui est portée par vingt siècles de vie chrétienne.
Si le paradoxe est un art éminemment catholique, est-il à même de convaincre nos contemporains ?
Je ne sais pas s’il sera toujours convaincant, mais je sais que les affirmations unilatérales tueront à bref délai toutes les velléités d’avancer.
Qu’est-ce qui permet au catholique de se prémunir contre l’idéologie et de garder le « flair surnaturel de la tradition » ?
Vous vous en doutez : la prière. Seule la confrontation avec Dieu dans la prière peut nous arracher à ce penchant si inscrit dans notre être : celui de vouloir nous justifier. Justifier nos façons de penser, garder nos habitudes, et ainsi refuser de jeter le filet au large.

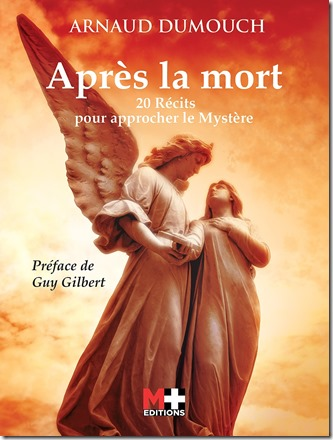 "Merci pour votre beau travail en faveur de la Communion des saints. Votre initiative de rendre accessible à tous les réalités de la foi qui concernent la communion des saints et notre éternité bienheureuse est excellente. Je la trouve en totale conformité avec la mission du Sanctuaire ND de Montligeon."
"Merci pour votre beau travail en faveur de la Communion des saints. Votre initiative de rendre accessible à tous les réalités de la foi qui concernent la communion des saints et notre éternité bienheureuse est excellente. Je la trouve en totale conformité avec la mission du Sanctuaire ND de Montligeon."
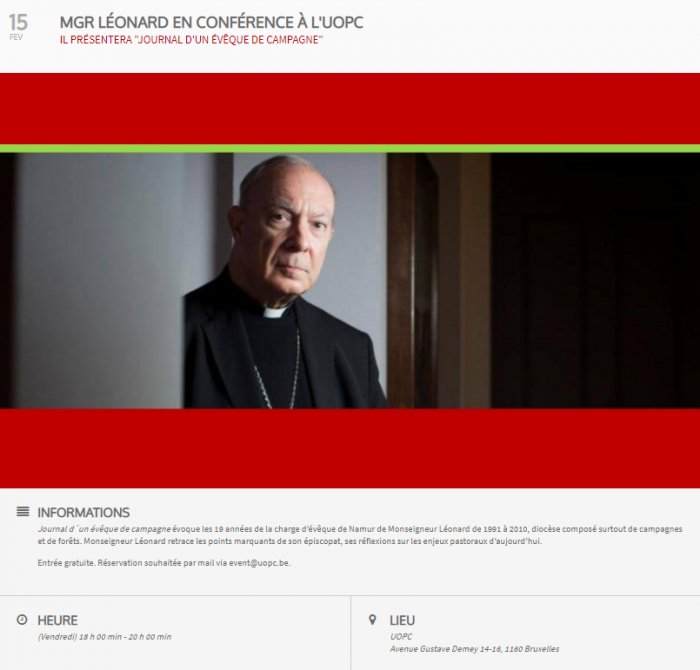
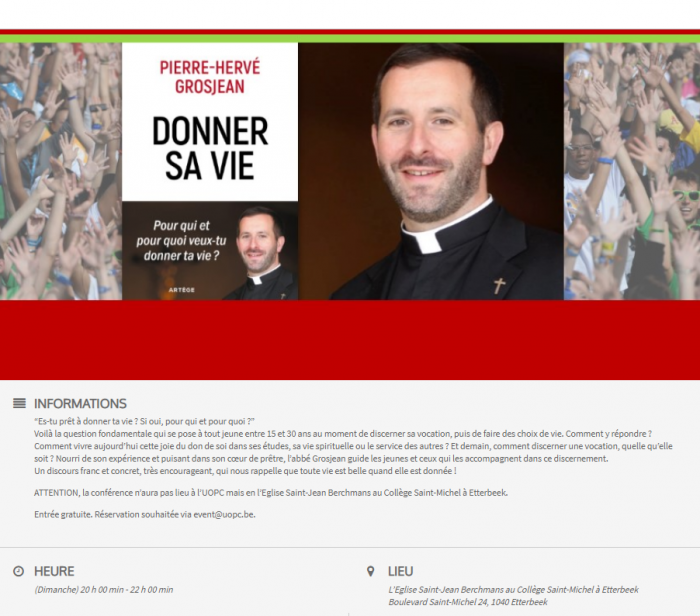

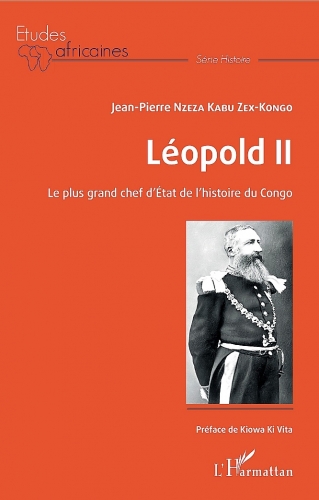 « C’est sous ce titre provocateur que Jean-Pierre Nzeza Kabu Zex-Kongo, docteur en géographie et enseignant, publie un ouvrage qui ne manquera pas d’attirer l’attention à l’heure où le « Musée royal de l’Afrique centrale » de Tervuren est rebaptisé « Africa Museum » en dépit de sa pauvreté en matière africaine hors Congo et offre aux visiteurs une présentation de l’Afrique centrale « déléopoldisée » avec autant de finesse que n’en mit Khrouchtchev à déstaliniser l’URSS.
« C’est sous ce titre provocateur que Jean-Pierre Nzeza Kabu Zex-Kongo, docteur en géographie et enseignant, publie un ouvrage qui ne manquera pas d’attirer l’attention à l’heure où le « Musée royal de l’Afrique centrale » de Tervuren est rebaptisé « Africa Museum » en dépit de sa pauvreté en matière africaine hors Congo et offre aux visiteurs une présentation de l’Afrique centrale « déléopoldisée » avec autant de finesse que n’en mit Khrouchtchev à déstaliniser l’URSS.