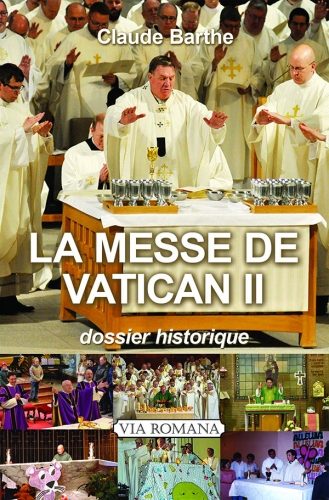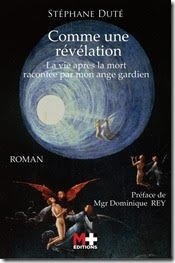De Benoît Lannoo sur le site cathobel.be :
Une déclaration d’amour aux chrétiens d’Orient

Marie Thibaut de Maisières et Simon Najm – (c) B. Lannoo
C’est à la Villa Empain à Bruxelles qu’a été présenté le merveilleux livre « Chrétiens d’Orient. Mon Amour », le 28 novembre. Il ne s’agit pas d’un dictionnaire, mais d’« une déclaration d’amour classée par ordre alphabétique ». Et le bénéfice de sa vente sert à aider le Comité de soutiendes chrétiens d’Orient à préserver ou à reconstruire un Orient dans lequel les chrétiens puissent vivre.
« Au début, je croyais que l’idée de faire cet ouvrage était irréaliste, mais grâce aux talents et au dévouement de Marie Thibaut de Maisières et de sa large équipe, nous voici avec une merveilleuse déclaration d’amour pour les chrétiens d’Orient entre les mains », dit le docteur belgo-libanais Simon Najm, président du Comité de soutien des chrétiens d’Orient (CSCO). C’est lui qui, fin 2013, était à la base de ce comité regroupant toutes les Eglises du Moyen-Orient actives en Belgique – les arméniens, les chaldéens, les coptes catholiques et les coptes orthodoxes, les maronites, les melkites, les syriaques catholiques et les syriaques orthodoxes – et l’Église latine de Belgique. Ils se réunissent régulièrement à l’Abbaye maronite de Saint-Charbel à Bois-Seigneur-Isaac pour chercher ensemble comment servir les communautés d’Orient vivant chez nous, mais surtout comment aider les chrétiens d’Orient à rester dans leurs terres natales ou à y retourner.
Richesse dans la diversité
« Notre livre démontre que le Moyen-Orient sans chrétiens n’a pas d’avenir », dit Marie. « Si une cohabitation pacifique ne réussit pas là-bas, comment pourrait-elle réussir ici ? La cohabitation pacifique en Orient – qui a souvent été possible et qui l’est encore – est donc un grand exemple pour nous en Occident. Toutes les religions abrahamiques sont nées au Moyen-Orient : le judaïsme, le christianisme et l’islam. Il est fondamental que cette cohabitation persiste en Orient, pour nous mais aussi – sinon pas surtout – pour les musulmans, qui risquent se faire engloutir par le fanatisme, sans la présence chrétienne parmi eux. » Après avoir travaillé pendant un an à convaincre 45 auteurs à participer à l’ouvrage et à livrer une centaine de textes à temps, Marie demeure pleine d’espoir. « J’ai ressenti tellement d’amour pour les chrétiens d’Orient, en Orient aussi ! » Et un énorme respect pour ceux qui ont le courage de rester ou de retourner au Moyen-Orient…
« Le fil conducteur du livre est la question : qui sont-ils, au fond, ces chrétiens d’Orient ? », explique Marie. « Quelles sont les composantes de la mosaïque, quelles sont leurs langues et leurs cultures, comment l’aide humanitaire s’organise-t-elle, comment font-ils la guerre, la politique mais aussi la nourriture… Ce sont les questions des Occidentaux par rapport à la chrétienté d’Orient. Mais – surprise ! – le résultat semble être amusant pour les Orientaux aussi. Ma sœur, par exemple, qui est mariée avec un orthodoxe, explique à quel point nourriture est égale à amour, en Orient. Pour nous, c’est une idée irréelle, car nous sommes tout le temps au régime. Ma sœur explique dès lors qu’il lui a fallu dix ans de mariage avant de comprendre qu’en disant à ses filles devant sa belle-mère qu’elles ne pouvaient pas abuser de desserts, elle les privait de l’amour de leur grand-mère. » Tout le monde, en effet, souffre d’un manque de recul par rapport à ses propres usages.
Maison de la femme
Entretemps, la paix semble en train de revenir en Orient… « Il faudra construire un nouveau modèle de citoyenneté », estime Marie, « mais il y a de jeunes gens qui ont les ressources culturelles et spirituelles pour le faire. Or nous devons être là pour les soutenir, notamment financièrement, car sans développement économique, le développement culturel n’est pas possible. » C’est la raison pour laquelle le CSCO continue de lancer de nouveaux projets au Moyen-Orient. « Nous offrons de l’aide alimentaire et de l’aide au logement à des réfugiés en Irak, en Syrie et au Liban », nous énumère le docteur Simon. « Nous soutenons des dispensaires à Deir El Ahmar au Liban et à Qamishli en Syrie, une école primaire à Hassaké et trois mouvements de jeunesses à Alep, un centre d’aide psychologique à Alqosh en Irak, mais aussi l’orphelinat de Bethléem tenu par les sœurs de Saint-Vincent de Paul, un projet éducatif pour enfants organisé par les sœurs de Taybeh et les scouts de Beit Sahour, le tout en Palestine. »
Le Comité de soutien des chrétiens d’Orient est aussi particulièrement concerné par l’aide au retour des réfugiés dans la pleine de Ninive, en particulier à Teleskeff, où il soutient également un dispensaire et une « maison de la fille et de la femme irakienne ». Car cela demeure le message fondamental pour le docteur Simon : « Les chrétiens sont chez eux en Orient. Sans juger de la situation particulière de telle ou telle famille de réfugies, j’ose dire clairement : il faut que les chrétiens restent en Orient, il faut qu’ils retournent en Orient ».
Benoit LANNOO

« Chrétiens d’Orient. Mon Amour », sous la direction de Marie Thibaut de Maisières et Simon Najm, avec des photos de Johanna de Tessières et Olivier Papegnies et une mise en page de Marc Dausimont, Mardaga, 272 pages, 34,90 €.
Aider le CSCO est aussi possible en achetant un livre directement au CSCO en payant 40 € (inclus les frais d’envoi) au numéro de compte BE77 0689 0300 3642.
Le livre sera également en vente lors de la ‘Nuit des témoins’ le 7 décembre dès 20 h à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles et le 8 décembre dès 20 h à l’abbaye maronite Saint-Charbel à Bois-Seigneur-Isaac.