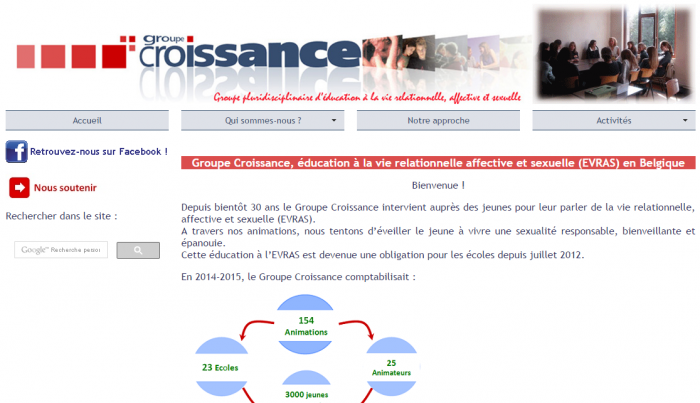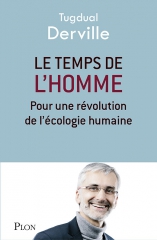De Radio Vatican :
L'Eglise canadienne réagit à la légalisation de l'euthanasie
(RV) Le meurtre a été légalisé au Canada. C’est en termes particulièrement sévères que l’épiscopat catholique a commenté l’adoption par le Parlement puis par le Sénat canadien d’un texte de loi autorisant l’aide médicale à mourir. Après plusieurs semaines de débat politiques, le Canada a en effet rejoint lundi le club des pays favorables à une mort aidée par les médecins. La nouvelle loi a été mise en chantier après l’annulation l’année dernière par la Cour suprême, la plus haute instance juridique du pays, d’une loi interdisant l’euthanasie. Dans une déclaration, l’archevêque de Toronto déclare craindre des abus, des dérapages, et des risques d’élargissement de la loi comme cela s’est produit dans d’autres pays ayant légalisé l’euthanasie.
Le cardinal Thomas Collins invite la société canadienne à s’interroger sur la différence fondamentale qui existe entre mourir et être tué ainsi que sur l’importance de l’interdépendance. La dignité d’une personne ne peut être réduite à son autonomie, à sa capacité à fonctionner selon des standards de prestation. L’archevêque de Toronto plaide une fois encore en faveur du développement des soins palliatifs auxquels n’ont accès à l’heure actuelle que 30% des malades canadiens. Il souhaite que les professionnels de santé pourront suivre leur conscience et refuser ce service. Selon la nouvelle loi, la procédure sera réservée aux adultes consentants, souffrant d’une maladie grave, incurable et irréversible dont la mort est raisonnablement prévisible à court terme.
Pression sur les plus vulnérables
Les personnes atteintes de maladies dégénératives ne pourront pas en bénéficier. Par ailleurs, les autorités canadiennes ont pris des mesures pour éviter un tourisme de suicide et pour protéger les personnes vulnérables ainsi que la liberté de conscience des professionnels de santé. Tout en rappelant qu’elle n’était pas en faveur d’un acharnement thérapeutique, l’Eglise canadienne avait engagé depuis le début une vaste campagne contre la légalisation de l’euthanasie ; de toute évidence elle ne compte pas baisser les bras.
Mgr Noël Simard, responsable de ce dossier pour la Conférence des évêques catholiques du Canada pense que le droit à l’euthanasie va devenir un devoir et que cela va mettre beaucoup de pressions sur les personnes âgées et les plus vulnérables. Il redoute aussi une baisse de subventions consacrées aux soins palliatifs. Les évêques devront maintenant démontrer que ce qui est légal n’est pas forcément moral. Il faut éliminer la souffrance, soulignent-ils, mais pas la personne qui souffre. (OB-RF)