Du site d'Alliance Vita :
L’impasse de l’euthanasie: Henri de Soos livre son analyse.
Son livre est donc à la fois l’expression d’une conviction, d’une réflexion, et d’une expérience de terrain.
5 arguments clés pour l’euthanasie sont ainsi examinés finement et avec rigueur : suivre l’exemple de pays étrangers, suivre l’opinion de certains sondages, mettre un cadre à des pratiques illégales existantes, mourir plutôt que souffrir, et exercer son ultime liberté.
Henri de Soos prend soin de détailler ces arguments avant de les soumettre à l’épreuve des faits et de l’argumentation.
Ainsi, le premier chapitre est consacré à l’exemple des pays étrangers, en particulier les pays du Bénélux, précurseurs dans ce type de législation. Hausse continue des euthanasies, poursuite d’un nombre important d’euthanasie clandestine, élargissement de la pratique pour des personnes ne souffrant pas de maladie en phase terminale. Les chiffres, officiels, et les cas de dérives, douloureux pour les proches, donnent un premier aperçu de l’impasse euthanasique.
La problématique des sondages, reflet mouvant d’une opinion parfois manipulée, est également abordée. Le livre décortique avec clarté le choix truqué proposé aux Français: « souffrir ou mourir? ».
Henri de Soos rappelle ces propos de Robert Badinter, artisan de l’abolition de la peine de mort en France, quand il était auditionné sur l’euthanasie en 2008: « Le droit à la vie est le premier des droits de tout être humain. […] Nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie ». L’édifice d’un Etat de droit, les progrès de la civilisation ont une pierre fondatrice sans laquelle la société se lézarde. Selon l’étymologie connue du mot « interdit » (inter-dit c’est-à-dire dit entre les humains), l’interdit de tuer est fondamental pour bâtir la confiance en l’autre, en particulier dans la relation entre soignant et soigné.
L’auteur n’ignore pas le clair-obscur des situations de fin de vie, la question délicate et complexe de la souffrance et consacre de belles pages à la réalité et la philosophie des soins palliatifs. Son éclairage est utile pour rappeler que l’euthanasie et l’acharnement thérapeutique sont les deux faces d’une même médaille: celle d’une volonté de maîtrise totale de la vie, par le soignant ou le patient. A l’opposé se situe le soin palliatif. Le « pallium », à l’origine chez les Romains, c’est un manteau. Protéger, accompagner, réconforter, la philosophie des soins palliatifs pose un regard non violent sur la personne. A contrario, l’auteur rappelle, à partir de témoignages vécus, la violence ressentie par des familles ou des soignants qui ont traversé des situations d’euthanasie.
Le dernier chapitre du livre aborde l’ultime argument présenté par les partisans de l’euthanasie: celui de la liberté. L’examen soigneux des arguments met au jour quelques contradictions dans le discours bien huilé. Ainsi celle de vouloir devancer une mort qu’on ne peut pas contrôler, et qui nous retire toute liberté. Ultime tentative de maîtrise de la vie, qu’on ne possède jamais, comme l’a rappelé un académicien philosophe à l’automne dernier. Ultra-moderne solitude ou relation de confiance. Calcul, contrôle ou gratuité de la vie qui nous est donnée. Le choix pour notre société est puissamment éclairé dans ce livre qui nous fait entrer dans la complexité de la fin de vie sans jamais céder à la facilité.



 « Une page se tourne avec l’évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, Mgr Dominique Rey : celle de 2021. Une autre, toute blanche encore, va se noircir de quelques lettres, de quelques mots, de quelques phrases : celle de 2022. Celui qui fêtait ses 20 années à la tête du diocèse, l’année dernière, fêtera, en 2022, ses 70 ans de pèlerinage terrestre, ou plutôt de navigation maritime. Car, face aux avis de tempête, sur cette mer agitée, il est entre deux eaux, comme l’Eglise de France. Dort-il comme le Christ au fond de sa barque ? Navigation en eaux troubles, avec cet évêque-skipper au long cours.
« Une page se tourne avec l’évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, Mgr Dominique Rey : celle de 2021. Une autre, toute blanche encore, va se noircir de quelques lettres, de quelques mots, de quelques phrases : celle de 2022. Celui qui fêtait ses 20 années à la tête du diocèse, l’année dernière, fêtera, en 2022, ses 70 ans de pèlerinage terrestre, ou plutôt de navigation maritime. Car, face aux avis de tempête, sur cette mer agitée, il est entre deux eaux, comme l’Eglise de France. Dort-il comme le Christ au fond de sa barque ? Navigation en eaux troubles, avec cet évêque-skipper au long cours.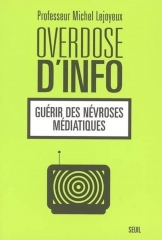 Michel Lejoyeux dirige le service psychiatrique de l’hôpital Bichat. Voici quinze ans, il publia un petit essai remarqué, Overdose d’info, guérir des névroses médiatiques (Seuil, 2006). À relire par temps de Covid. Le médecin réfléchit aux dépendances à ce que nos grands-parents appelaient « les nouvelles ». Qui pouvait imaginer que l’information fonctionne comme l’alcool ou la cigarette ? Lejoyeux distingue trois symptômes et ceux-ci jouent à plein régime depuis l’épidémie de la Covid.
Michel Lejoyeux dirige le service psychiatrique de l’hôpital Bichat. Voici quinze ans, il publia un petit essai remarqué, Overdose d’info, guérir des névroses médiatiques (Seuil, 2006). À relire par temps de Covid. Le médecin réfléchit aux dépendances à ce que nos grands-parents appelaient « les nouvelles ». Qui pouvait imaginer que l’information fonctionne comme l’alcool ou la cigarette ? Lejoyeux distingue trois symptômes et ceux-ci jouent à plein régime depuis l’épidémie de la Covid.