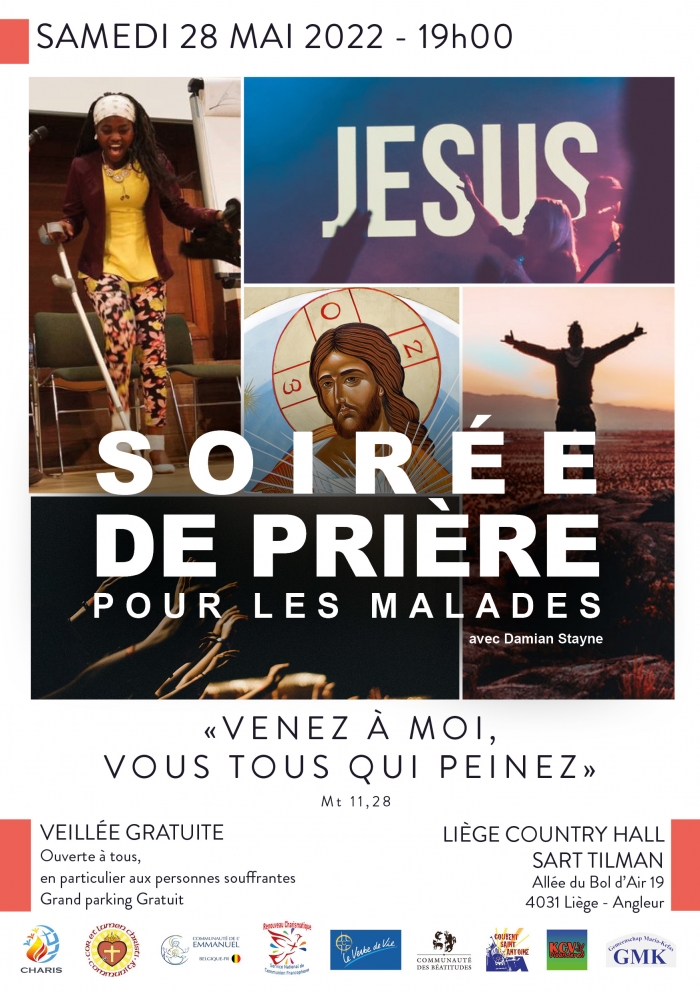I.Media - publié le 10/06/22 - mis à jour le 10/06/22 via le site web « aleteia :
 Le pape François a été contraint de reporter son voyage en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud prévu du 2 au 7 juillet 2022 officiellement en raison de son genou, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège le 10 juin 2022. C’est la première fois que le pape François reporte un voyage à l’étranger pour raison de santé.
Le pape François a été contraint de reporter son voyage en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud prévu du 2 au 7 juillet 2022 officiellement en raison de son genou, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège le 10 juin 2022. C’est la première fois que le pape François reporte un voyage à l’étranger pour raison de santé.
Le pape François a décidé de reporter son voyage en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, officiellement en raison de ses douleurs au genou. D’après plusieurs sources, des questions liées à la sécurité du déplacement pourraient aussi avoir pesé dans le choix d’ajourner cette visite initialement prévue du 2 au 7 juillet 2022.
À trois semaines seulement de son voyage en Afrique, le pape François a préféré y renoncer, le pontife de 85 ans ayant choisi d’accepter la demande de ses médecins de ne pas risquer de « compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours », a expliqué un communiqué du Saint-Siège diffusé le 10 juin. L’état du genou droit du Pape s’est dégradé ces dernières semaines, obligeant le chef de l’Église catholique à annuler certains déplacements et à utiliser un fauteuil roulant ou bien une canne. Début mai, il a confié au Corriere della Sera avoir un ligament déchiré et bénéficier d’infiltrations.
Un voyage qui aurait pu se réaliser en fauteuil roulant
Pourtant, malgré sa santé précaire et l’annonce du report du voyage au Liban imaginé à la mi-juin, le déplacement en RDC et au Soudan du Sud était jusqu’à présent maintenu. Le programme détaillé du voyage avait même été dévoilé le 28 mai, preuve que le pontife se sentait alors prêt à honorer ce rendez-vous africain. Au Vatican, on expliquait alors que le Pape aurait pu réaliser ce voyage en fauteuil roulant, certaines voix rappelant même que les derniers déplacements de Jean Paul II avaient démontré qu’un pape à la mobilité réduite pouvait se rendre à l’étranger.
Selon une source vaticane, la décision de suspendre le voyage a été prise ces dernières heures. Sans doute a-t-on considéré que les progrès attendus par les médecins n’étaient pas au rendez-vous et que ce voyage fatiguant mettrait finalement en péril un réel rétablissement du pape.
Une chose est certaine, aucune source officielle n’accorde du crédit aux rumeurs selon lesquelles le pape François serait atteint d’un cancer – depuis la lourde opération du pape au côlon, en juillet 2021, certains avancent cette hypothèse sans pour autant pouvoir l’étayer.
Les risques d’un attentat visant le Pape à Goma
Selon les informations d’IMedia, le facteur sécuritaire aurait aussi pu pousser le pape François à prendre cette décision exceptionnelle. Le pontife s’apprêtait en effet à fouler le sol de deux pays marqués par une forte instabilité. Le lundi 4 juillet, le pape prévoyait notamment de se rendre dans la ville de Goma, à l’est de la RDC, où la situation sécuritaire s’est fortement dégradée ces dernières semaines.
Dans cette région, les forces gouvernementales affrontent notamment les rebelles du M23 qui tentent de s’imposer au moyen de massacres et d’exactions sur fond de lutte ethnique. De violentes attaques ont eu lieu ces derniers jours dans cette région du nord Kivu.
Les menaces d’attentat visant directement le pape François et la menace terroriste caractérisée lors de rassemblements autour du Pape – comme par exemple lors de la messe – ont assurément pesé dans la balance.
Selon un diplomate proche du dossier, trois éléments parvenus au Saint-Siège auraient pu conduire à ajourner le déplacement du pape François. « Indépendamment du sujet de la santé du Pape, la sécurité dégradée dans l’est de la RDC, les menaces d’attentat visant directement le pape François et la menace terroriste caractérisée lors de rassemblements autour du pape – comme par exemple lors de la messe – ont assurément pesé dans la balance », affirme cette source. Elle estime que le Pape, considérant que sa venue à Goma pouvait engendrer de graves dommages collatéraux, a pris la décision de reporter l’intégralité du voyage.
Au Vatican, la question de la sécurité du voyage n’a jamais été invoquée pour expliquer un report. On rappelle d’ailleurs que le pape François, en 2015, s’était rendu en Centrafrique malgré les mises en garde de pays comme la France.
En fonction de la tenue ou non du voyage du pape François au Canada prévu du 24 au 30 juillet, l’hypothèse de ce report pour des raisons de sécurité pourrait prendre du poids. Ce ne serait pas une première : Jean Paul II avait dû annuler au dernier moment une visite à Sarajevo en 1994 pour des raisons de sécurité. Six années plus tard, le pontife polonais avait aussi dû renoncer à se rendre en Irak, alors sous le régime de Saddam Hussein.
Lire aussi :Ligament déchiré, infiltration du genou… Comment va le pape François ?
Lire aussi :Le pape François va-t-il voyager comme avant la pandémie ?
Ref. Santé, sécurité… Que sait-on du report du voyage du Pape en Afrique ?
 Le pape François a été contraint de reporter son voyage en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud prévu du 2 au 7 juillet 2022 officiellement en raison de son genou, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège le 10 juin 2022. C’est la première fois que le pape François reporte un voyage à l’étranger pour raison de santé.
Le pape François a été contraint de reporter son voyage en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud prévu du 2 au 7 juillet 2022 officiellement en raison de son genou, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège le 10 juin 2022. C’est la première fois que le pape François reporte un voyage à l’étranger pour raison de santé.