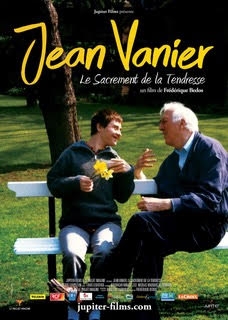Du site du quotidien le Soir :
Santé: 40% des Belges sont pour l’arrêt des soins pour les plus de 85 ans
Ce sont des résultats qui étonnent : selon une étude, seuls 35 % des Belges s’opposent à ce qu’on arrête les soins vitaux pour les plus âgés.
C’est une nouvelle stupéfiante : selon plusieurs études, menées au Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), à la Fondation Roi Baudouin et au cœur de l’Inami (dans un rapport secret), 40 % des Belges (et davantage de Flamands que de Wallons) songent sérieusement à conserver l’équilibre de la Sécu « en n’administrant plus de traitements coûteux qui prolongent la vie des plus de 85 ans ». On devine la suite : on aurait rapidement une médecine à deux vitesses, entre les patients qui doivent se contenter de la Sécu et ceux qui ont les moyens de se payer les médicaments non remboursés ou les opérations auxquelles ils n’auraient plus accès. Aux Pays-Bas, on ne place déjà plus de stimulateur cardiaque aux plus de 75 ans… l’appareil dépassant de loin le patient en espérance de fonctionnement.
Par comparaison, seuls 17 % se prononcent pour ne plus rembourser les frais de maladie ou d’accident qui sont la conséquence d’un comportement personnel (tabac, obésité), une solution contre laquelle 46 % des Belges s’élèvent. Bien davantage que les 35 % qui s’opposent à ce qu’on arrête les soins vitaux pour les plus âgés.
Au demeurant, la solidarité du groupe est fortement dépendante des perspectives du patient. Ainsi, si 69 % des Belges estiment légitime de dépenser 50.000 euros pour un traitement vital, ils ne sont que 28 % à conserver cette opinion si le patient a plus de 85 ans. S’il s’agit d’un appareil cardiaque, les deux groupes s’équilibrent (50 %-40 %). Et si la personne est dans le coma et que le traitement n’apporte qu’un an de vie, trois Belges sur dix sont d’accord, sauf chez les plus de 85 ans, la moitié des Belges estimant que « cela ne doit jamais être possible, quel que soit l’âge ». Les néerlandophones sont beaucoup plus enclins à exclure les personnes âgées de plus de 85 ans des soins plus onéreux. « Ces pourcentages en faveur de l’exclusion sont choquants », note le professeur Elchardus, qui a mené l’enquête pour l’Inami.
... mais il s'agirait d'une FAKE NEWS qui tourne et tourne dans nos médias :
en effet, les rapports dont il est question datent de 2014 et ne sont PAS secrets...Ils sont en ligne sur le site de l'INAMI.
La question est intéressante de savoir pourquoi le journaliste reprend du "vieux" pour en faire du "nouveau".
La question de la prise en charge des personnes âgées est essentielle. Pourquoi ne pas en parler, et re-parler, en effet ?
Surtout après la déclaration de la députée GroenLinks aux Pays-Bas, qui voudraient que dans le cadre des négociations gouvernementales et des élections européennes, le gouvernement hollandais décide de limiter certains traitements et soins aux personnes de plus de 70 ans.
L'écologie passerait-elle par là aussi ? Agisme ? Eugénisme ?
Par contre cela vaut la peine de se pencher sur la "Charte européenne de l'avancée en âge" pour faire toute leur place aux personnes âgées dans la société.
 Après
Après