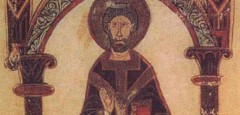L'homélie du pape François pour l'Epiphanie (source) :
Les Mages sont en route vers Bethléem. Leur pèlerinage parle à nous aussi qui sommes appelés à marcher vers Jésus, parce que c’est lui l’étoile polaire qui illumine les cieux de la vie et qui oriente les pas vers la vraie joie. Mais d’où est parti le pèlerinage des Mages à la rencontre de Jésus ? Qu’est-ce qui a poussé ces hommes d’Orient à se mettre en route ?
Ils avaient de très bons alibis pour ne pas partir. Ils étaient savants et astrologues, ils avaient renommée et richesse. Ayant atteint une telle sécurité culturelle, sociale et économique, ils pouvaient se contenter de ce qu’ils savaient et de ce qu’ils avaient, rester tranquilles. Au contraire, ils se laissent inquiéter par une question et par un signe : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile… » (Mt 2, 2). Leur cœur ne se laisse pas engourdir dans l’antre de l’apathie, mais il est assoiffé de lumière ; il ne se traîne pas avec lassitude dans la paresse, mais est embrasé par la nostalgie de nouveaux horizons. Leurs yeux ne sont pas tournés vers la terre, mais ils sont des fenêtres ouvertes sur le ciel. Comme l’a affirmé Benoît XVI, ils étaient « des hommes au cœur inquiet. […] Des hommes en attente qui ne se contentaient pas de leur revenu assuré et de leur position sociale. […] Ils étaient des chercheurs de Dieu » (Homélie, 6 janvier 2013).
Cette saine inquiétude qui les a portés à partir en pèlerinage, d’où est-elle née ? Elle est née du désir. Voilà leur secret intérieur : savoir désirer. Méditons là-dessus. Désirer c’est garder vivant le feu qui brûle en nous et qui nous pousse à chercher au-delà de l’immédiat, au-delà du visible. Désirer c’est accueillir la vie comme un mystère qui nous dépasse, comme une fissure toujours ouverte qui invite à regarder au-delà, parce que la vie n’est pas “toute ici”, elle est aussi “ailleurs”. Elle est comme une toile blanche qui a besoin de recevoir des couleurs. Un grand peintre, Van Gogh, écrivait que le besoin de Dieu le poussait à sortir de nuit pour peindre les étoiles (cf. Lettre à Theo, 9 mai 1889). Oui, parce que Dieu nous a faits ainsi : pétris de désir ; tournés, comme les Mages, vers les étoiles. Nous pouvons dire sans exagérer que nous sommes ce que nous désirons. Parce que ce sont les désirs qui élargissent notre regard et poussent notre vie au-delà : au-delà des barrières de l’habitude, au-delà d’une vie focalisée sur la consommation, au-delà d’une foi répétitive et fatiguée, au-delà de la peur de nous impliquer et de nous engager pour les autres et pour le bien. « Notre vie – disait saint Augustin – est une gymnastique du désir » (Traités sur la première Lettre de Jean, IV, 6).
Frères et sœurs, il en est pour nous comme des Mages : le voyage de la vie et le chemin de la foi ont besoin de désir, d’élan intérieur. Parfois nous vivons dans un esprit de “garage”, nous vivons garés, sans cet élan du désir qui nous fait avancer. Il est bon de nous demander : où en sommes-nous dans le voyage de la foi ? Ne sommes-nous pas depuis trop longtemps bloqués, parqués dans une religion conventionnelle, extérieure, formelle, qui ne réchauffe plus le cœur et ne change pas la vie ? Nos paroles et nos rites déclenchent-ils dans le cœur des personnes le désir d’aller vers Dieu, ou bien sont-ils une “langue morte” qui ne parle que de soi et à soi-même ? Il est triste qu’une communauté de croyants ne désire plus et, fatiguée, se contente de la gestion des choses au lieu de se laisser surprendre par Jésus, par la joie envahissante et inconfortable de l’Évangile. Il est triste qu’un prêtre ferme la porte du désir, il est triste de tomber dans le fonctionnalisme clérical ; c’est très triste.
La crise de la foi, dans notre vie et dans nos sociétés, est aussi liée à la disparition du désir de Dieu. Elle est liée au sommeil de l’Esprit, à l’habitude de se contenter de vivre au quotidien, sans s’interroger sur ce que Dieu veut de nous. Nous nous sommes trop repliés sur les cartes de la terre et nous avons oublié de lever le regard vers le Ciel ; nous sommes rassasiés de beaucoup de choses, mais dépourvus de la nostalgie de ce qui nous manque. La nostalgie de Dieu. Nous nous sommes fixés sur nos besoins, sur ce que nous mangerons et de quoi nous nous vêtirons (cf. Mt 6, 25), laissant s’évaporer le désir de ce qui va au-delà. Et nous nous trouvons dans la boulimie de communautés qui ont tout et, souvent, ne sentent plus rien dans le cœur. Des personnes fermées, des communautés fermées, des évêques fermés, des prêtres fermés, des personnes consacrées fermées. Parce que le manque de désir conduit à la tristesse et à l’indifférence. Des communautés tristes, des prêtres tristes, des évêques tristes.
Mais surtout, regardons-nous nous-mêmes et demandons-nous : où en est le voyage de ma foi ? C’est une question que nous pouvons aujourd’hui nous poser, chacun de nous. Où en est le voyage de ma foi. Est-elle au garage ou en chemin ? La foi, pour partir et repartir, a besoin d’être déclenchée par le désir, d’être impliquée dans l’aventure d’une relation vivante et dynamique avec Dieu. Mais mon cœur est-il encore animé du désir de Dieu ? Ou bien est-ce que je laisse l’habitude et les déceptions l’éteindre ? C’est aujourd’hui, frères et sœurs, le jour pour nous poser ces questions. C’est aujourd’hui le jour pour recommencer à nourrir le désir. Et comment faire ? Allons à “l’école du désir”, allons voir les Mages. Ils nous enseigneront dans leur école du désir. Regardons les pas qu’ils accomplissent et tirons quelques enseignements.
D’abord, ils partent au lever de l’étoile : ils nous enseignent qu’il faut toujours repartir chaque jour, dans la vie comme dans la foi, parce que la foi n’est pas une armure qui immobilise, mais un voyage fascinant, un mouvement continu et agité, toujours en recherche de Dieu, toujours en discernement sur le chemin.
Ensuite, les Mages, à Jérusalem, demandent. Ils demandent où se trouve l’Enfant. Ils nous enseignent que nous avons besoin d’interrogations, d’écouter avec attention les questions du cœur, de la conscience ; parce que c’est ainsi que, souvent, Dieu parle, qu’il s’adresse à nous plus avec des questions qu’avec des réponses. Et cela, nous devons bien le comprendre : Dieu s’adresse à nous plus par des questions que par des réponses. Mais laissons-nous inquiéter aussi par les interrogations des enfants, par les doutes, les espérances et par les désirs des personnes de notre temps. La voie c’est se laisser interroger.
Par ailleurs, les Mages défient Hérode. Ils nous enseignent que nous avons besoin d’une foi courageuse qui n’ait pas peur de défier les logiques obscures du pouvoir et qui devienne semence de justice et de fraternité dans une société où, encore aujourd’hui, beaucoup d’Hérode sèment la mort et massacrent des pauvres et des innocents, dans l’indifférence de beaucoup.
Les Mages, enfin, retournent « par un autre chemin » (Mt 2, 12) : ils nous provoquent à parcourir de nouvelles routes. C’est la créativité de l’Esprit qui fait toute chose nouvelle. C’est aussi, en ce moment, l’un des devoirs du Synode que nous sommes en train de faire : marcher ensemble dans l’écoute, pour que l’Esprit nous suggère des voies nouvelles, des chemins pour apporter l’Évangile au cœur de celui qui est indifférent, loin, de celui qui a perdu l’espérance mais qui cherche ce que les Mages ont trouvé, « une très grande joie » (Mt 2, 10). Sortir au-delà, aller de l’avant.
Mais au point culminant du voyage des Mages il y a un moment crucial : lorsqu’ils arrivent à destination “ils se prosternent et adorent l’Enfant” (cf. v. 11). Ils adorent. Rappelons-nous ceci : le voyage de la foi trouve élan et accomplissement seulement en présence de Dieu. C’est seulement si nous retrouvons le goût de l’adoration que le désir se renouvelle. Le désir te porte à l’adoration et l’adoration te renouvelle le désir. Parce que le désir de Dieu grandit seulement devant Dieu. Parce que seul Jésus guérit les désirs. De quoi ? Il les guérit de la dictature des besoins. Le cœur, en effet, tombe malade lorsque les désirs coïncident seulement avec les besoins. Dieu, au contraire, élève les désirs ; les purifie, les soigne, en les guérissant de l’égoïsme et en nous ouvrant à l’amour pour lui et pour les frères. Par conséquent, n’oublions pas l’Adoration, la prière d’adoration, qui n’est pas si répandue parmi nous : adorer, en silence. Par conséquent, n’oublions pas l’adoration, s’il vous plait.
Et ainsi, chaque jour, nous aurons la certitude, comme les Mages, que même dans les nuits les plus obscures brille une étoile. C’est l’étoile du Seigneur qui vient prendre soin de notre fragile humanité. Mettons-nous en route vers lui. Ne donnons pas à l’apathie et à la résignation le pouvoir de nous clouer dans la tristesse d’une vie plate. Prenons l’inquiétude de l’Esprit !… des cœurs inquiets ! Le monde attend des croyants un élan renouvelé ver le Ciel. Comme les Mages, levons la tête, écoutons le désir du cœur, suivons l’étoile que Dieu fait resplendir au-dessus de nous. Comme des chercheurs inquiets, restons ouverts aux surprises de Dieu. Frères et sœurs, rêvons, cherchons, adorons.
Traduction Copyright © Dicastère pour la Communication – Librairie éditrice vaticane
 L'archevêque de Chicago a sévèrement restreint les options pour célébrer la « vieille » messe. Maintenant, la résistance s'agite dans l'archidiocèse. Lu sur le site web Kath net :
L'archevêque de Chicago a sévèrement restreint les options pour célébrer la « vieille » messe. Maintenant, la résistance s'agite dans l'archidiocèse. Lu sur le site web Kath net :