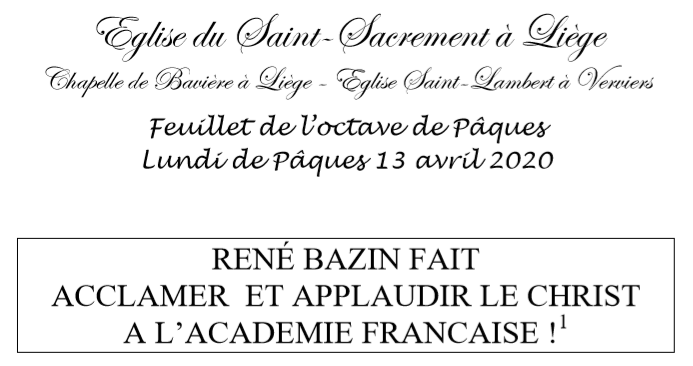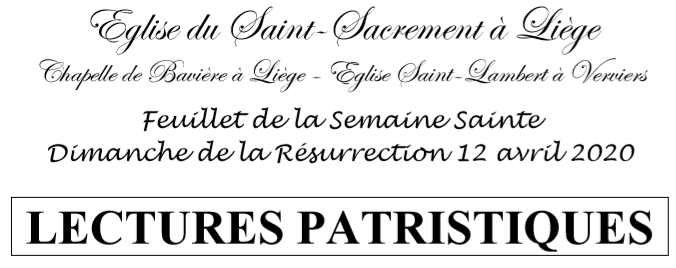Spiritualité - Page 263
-
Octave pascale en confinement; feuillet du Lundi de Pâques (13 avril) : le Christ applaudi à l'Académie Française
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Culture, Eglise, Foi, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -
Les célébrations du Lundi de Pâques sur les écrans et à la radio
https://www.egliseinfo.be/horaires/%2523internet%20all-celebration
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, liturgie, Spiritualité 0 commentaire -
Pâques : la parole forte de Mgr Aupetit
De Paris.Catholique.fr :
Homélie de Mgr Michel Aupetit - Vigile pascale à St Germain l’Auxerrois (Paris 1er) (à huis-clos)
Samedi 11 avril 2020
– Solennité de la Résurrection du Seigneur – Vigile pascale – Année A
- 7 lectures de la Vigile ; Rm 6, 3b-11 ; Mt 28, 1-10
Une pierre roulée, un tombeau vide ? C’est tout ? Ah non, c’est un peu court jeune homme, on espère bien d’autres choses en somme. Il nous faut du concret, du palpable, du démontrable. Depuis toujours il nous faut des certitudes, des réponses certaines. Et nous avons l’impression que le Seigneur ne nous laisse qu’avec des questions. Où est-il ce corps ? Comment peut-on le rencontrer ce Jésus ressuscité ? Comment le saisir ? Car nous avons besoin de saisir les choses pour être sûr qu’elles existent. Le Seigneur ne nous a laissé comme signe objectif de sa présence que ce morceau de pain sur lequel il a dit « Ceci est mon corps ». Mais nous voudrions pouvoir le vérifier, le soumettre à l’analyse chimique, savoir comment la matière organique de ce pain est devenu le corps de Jésus ressuscité.
C’est la grande question éternelle que Pilate pose : « Qu’est-ce que la vérité » ? Pour nous, la vérité doit être enfermée dans nos capacités de connaître, dans notre cerveau. S’il n’en est pas ainsi nous ne pouvons pas croire aux réalités qui nous entourent. C’est toute la démarche du positivisme et du scientisme du 19e siècle qui reléguaient la religion dans le domaine des superstitions. La science des hommes pourrait tout expliquer, disait-on. Beaucoup pensent encore ainsi. Et pourtant…
Il a fallu qu’un scientifique nous démontre que l’objet observé est modifié par l’observateur. Le temps et l’espace ne sont plus absolus mais varient en fonction de la vitesse de l’observateur. C’est la loi de la relativité restreinte d’Einstein. Nous pensions pouvoir tout connaître de la matière en particulier dans ses particules les plus minuscules. Or, Heisenberg a démontré qu’il nous est impossible de connaître en même temps la masse et la vitesse de cette particule. C’est le principe d’incertitude. Comment est-il possible qu’il y ait de l’incertitude dans les matières scientifiques ? Il faut donc se reporter sur les équations qui, elles, ne nous trompent pas. Hélas, il a fallu qu’un petit Autrichien vienne nous dire, en le démontrant avec des équations mathématiques, qu’il y a des réalités qui sont indémontrables. C’est le théorème de Godël qu’on appelle aussi le théorème d’incomplétude. Même l’astrophysique nous dit scientifiquement que nous n’avons aucune idée de 96 % du contenu de l’univers. Force est de constater qu’il nous est impossible d’enfermer le réel dans le tout de nos connaissances. Où est la vérité ?
C’est qu’il nous faut découvrir que la vérité n’est pas un concept. Non, la vérité, c’est une personne. Pilate était en face de la vérité. Il ne l’a pas connue. La vérité ne s’enferme pas dans un cerveau humain, la vérité se découvre dans une personne : « Je suis la vérité ». Autrement dit, la vérité ne peut se découvrir que dans une relation. Cette relation, dans la Bible, nous venons de l’entendre, s’appelle une alliance. C’est l’histoire de cette alliance que nous venons d’entendre et qui révèle la vérité de la création, la vérité de l’homme, la vérité de Dieu.
Il y a une alliance initiale qui relie la créature à son créateur. Cette alliance est décrite dans le récit de la création. Elle donne à l’homme d’accueillir la vie divine. C’est le sens même de l’arbre de la vie auquel il a accès. Mais, dans une relation chacun doit rester à sa place. Quand la créature veut se faire « créateur » et que l’homme veut « devenir comme Dieu » décrétant lui-même le bien et le mal, la rupture est consommée et la vérité n’entre pas en lui.
Alors Dieu va proposer une alliance avec un homme, Abraham. Une rencontre qui va permettre de refonder la vérité et la vie. Alors que les Cananéens sacrifient leurs enfants au dieu Moloch Baal et que tant de civilisations, comme les Aztèques, pensent que la fécondité ne peut naître que de la mort, Dieu va arrêter le bras d’Abraham en lui montrant que seule la confiance totale en lui est source de vie. Pourtant, cette tentation de supprimer la vie naissante demeure encore aujourd’hui avec l’avortement généralisé. Non plus en raison d’une recherche hypothétique de la fécondité, mais au nom de la liberté. « O liberté que de crime on commet en ton nom » disait déjà Madame Rolland en montant à l’échafaud.
« La vérité vous rendra libre ». C’est une nouvelle rencontre avec la vérité, une alliance de Dieu avec un peuple guidé par un homme choisi, Moïse, qui va nous révéler comment la liberté nous conduit à la vie. Ce peuple conduit par Moïse va sortir de l’esclavage en traversant les eaux de la mer. Ces eaux qui, traditionnellement, sont le signe de la mort, vont s’écarter pour laisser passer la vie. C’est la figure du baptême où nous sommes plongés dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui (Rm 6).
Car c’est bien lui, le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Après la rencontre d’un peuple avec le Seigneur, c’est bien l’alliance ultime de Dieu avec l’ensemble de l’humanité que va réaliser la rencontre sublime des deux en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai Homme. C’est lui, et lui seul, qui est le chemin qui mène à la vérité pour que jaillisse la vie.
Cette compréhension fondamentale de la fête de Pâques nous permet de comprendre enfin qui nous sommes. Chacun de nous devient une vérité pour lui-même. Ma vérité, c’est que je suis né d’une relation d’amour de mes parents. M’ont-ils désiré ? Ont-ils souhaité que cette relation fût fécondante ? Peu m’importe. Si je suis né d’une relation d’amour, normalement je ne peux être qu’aimé. C’est ainsi que j’ai compris un jour que je suis né d’une relation d’amour encore plus fondamentale : la Trinité. La communion d’amour entre le Père, le Fils et le Saint Esprit est l’acte d’amour premier de mon existence et de la vôtre. C’est notre vérité fondatrice et fondamentale.
Ceci éclaire d’une lumière fulgurante ce que nous fêtons cette nuit. La vie indestructible ne peut jaillir que d’un amour infini. C’est la Pâque du Seigneur, la révélation ultime de notre vocation.
+Michel Aupetit, archevêque de Paris.
Lien permanent Catégories : Actualité, Au rythme de l'année liturgique, Défense de la Vie, Eglise, Foi, Idées, Santé, Société, Spiritualité 1 commentaire -
La prière d'Andrea Bocelli dans la cathédrale de Milan
Du site du SoirMag.be :
L’émouvante prestation d’Andrea Bocelli, seul dans la cathédrale de Milan (vidéo)
Le moment était unique et émouvant. Ce dimanche 12 avril, Andrea Bocelli a chanté, seul dans la cathédrale de Milan déserte, seulement accompagné d’un organiste. Pour le ténor italien, il s’agissait plus d’une « prière » que d’un concert, à l’occasion du dimanche de Pâques. Sa prestation d’une demi-heure a été diffusée en direct sur Youtube. Et en ce lundi de Pâques, la vidéo a déjà été visionnée près de 24 millions de fois, rapporte BFM TV.
« Prier, dans la maison de Dieu et le jour de la principale célébration chrétienne, pour que nous puissions surmonter le plus tôt possible cette période dramatique et repartir avec une conscience nouvelle pour arriver à une nouvelle façon de s'occuper de son prochain et de la planète », avait déclaré le chanteur pour expliquer son projet.
En hommage aux victimes du coronavirus et à l’occasion de Pâques, Andrea Bocelli a ainsi entonné plusieurs airs de circonstance tels que le « Santa Maria » de Pietro Mascagni, l’« Ave Maria » de Charles Gounod ou encore le cantique chrétien « Amazing Grace ». Il a conclu sa « prière » à l’extérieur de la cathédrale de Milan. Un appel aux dons avait été lancé également, parallèlement à la diffusion du concert. Plus de 220 000 euros ont été récoltés par l’association du ténor, pour les hôpitaux italiens.
-
Pâques en confinement; feuillet du Dimanche de Pâques (12 avril 2020) : lectures patristiques
-
Les offices de Pâques sur les médias
Sur KTO :
10h00 : Messe de la Résurrection en direct de la grotte de Lourdes
11h00 : Messe de la Résurrection célébrée par le pape François, en direct de Rome
12h00 : Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François, en direct de Rome
18h30 : Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de Saint-Germain-l’Auxerrois
En Belgique :
https://www.egliseinfo.be/horaires/%2523internet%20all-celebration
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, liturgie, Médias, Spiritualité 0 commentaire -
Nous savons que le Christ est vraiment ressuscité !
Goûtons, encore et encore, à la joie pascale durant ces jours de l'octave. Cette belle séquence grégorienne (XIe siècle) nous y aidera :
Victimæ paschali laudes
immolent Christiani.Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.Mors et vita duello
conflixere mirando:
dux vitae mortuus,
regnat vivus.Dic nobis Maria,
quid vidisti in via?Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis:Angelicos testes,
sudarium, et vestes.Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilaeam.Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere:
tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen. Alleluia!À la Victime pascale, les chrétiens offrent un sacrifice de louanges.
L'Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié les pécheurs avec le Père.
La mort et la vie se sont affrontées en un duel admirable
le guide de la vie, bien que mort, règne vivant.
Dis-nous, Marie, ce que tu as vu en chemin.
J'ai vu le tombeau du Christ vivant et la gloire de sa résurrection,
Les anges témoins, le suaire et les vêtements.
Christ, notre espérance, est ressuscité, il précèdera les siens en Galilée.
Nous savons que le Christ est vraiment ressuscité des morts.
Toi, Roi vainqueur, aie pitié de nous.
Ainsi soit-il, Alleluia!
-
Suspension du culte public de l’Église alors qu'on célébre le mystère pascal : une pure coincidence ?
De l'Abbé Henri Vallançon, bibliste, sur le site de l'Homme Nouveau :
Pâques 2020 : le retrait de la gloire de Dieu

Dans le malheur qui frappe actuellement notre monde, avec cette épidémie, nombre d’hommes d’Église ont tenté, ici ou là, des interprétations de la situation présente. Il est troublant de ne trouver presque jamais, venant de clercs, une tentative d’éclairage spécifiquement religieux de cette crise. Leurs propos dénoncent : le « système » dans lequel nous vivons, la difficulté à prendre conscience que les ressources ne sont pas illimitées, la course folle et trop rapide de notre monde, la machine financière, la crise écologique, l’égoïsme, l’individualisme, la recherche du profit, le consumérisme outrancier, le manque de solidarité, l’avidité du gain, les guerres et les injustices, le cri des pauvres et de notre planète gravement malade… Pour être sans doute réelles, ces causes invoquées ne visent que des facteurs socio-économiques. Venant d’hommes d’Église, détachés de responsabilités temporelles pour se consacrer aux choses de Dieu, cela ne revient-il pas à battre la coulpe des autres, sans faire retour sur soi et voir si notre propre responsabilité spirituelle de clercs n’est pas aussi concernée ? Ne nous exonérons-nous pas de l’effort que nous réclamons du monde ? Ne faudrait-il pas chercher dans l’épidémie actuelle un message de Dieu pour son Église ?
L’inouï de cette crise
Le coronavirus Covid-19 est à la fois très contagieux et faiblement mortel (la courbe de mortalité dans les pays atteints augmente à peine, si on la compare aux années antérieures à la même époque de l’année : il meurt habituellement 17 millions de personnes de maladie infectieuse par an dans le monde). Mais il interrompt le culte public de l’Église. N’est-ce pas là l’inouï de cette crise ? Personne ne conteste le bien-fondé de l’interdiction actuelle des rassemblements pour limiter la propagation du virus. Il faut bien faire tout ce qu’il est possible pour l’enrayer et les assemblées de fidèles dans les églises ne sont pas raisonnables à ce moment. Pas de messe publique à Saint-Jean-de-Latran, à Saint-Pierre de Rome, ni au Saint-Sépulcre à Jérusalem dans aucun des rites liturgiques – et Dieu sait qu’elles sont suivies par une foule dense –, ni dans la quasi-totalité des cathédrales et églises du monde. Quel événement spirituel majeur ! En deux-mille ans d’histoire de l’Église, cela n’est jamais arrivé. Au pire des persécutions, on célébrait dans les maisons. Là, non. Il faut remonter à la grande crise des années 167-164 avant Jésus-Christ, dont parle le livre de Daniel et les livres des Macchabées, pour trouver le dernier épisode de l’interruption du culte public de Dieu dans son peuple.
Dans cette situation extrême, même les courants du christianisme les plus strictement attachés à l’observance de la loi de Dieu ne se distinguent plus des autres : les communautés catholiques traditionalistes ont aussitôt emboité le pas à la Conférence des évêques de France, sans mot dire ; le Saint-Synode permanent de l’Église orthodoxe de Grèce avait commencé par déclarer que la communion eucharistique n’était pas le danger mais le remède, avant de revenir huit jours plus tard sur ses déclarations, invitant chacun à rester chez soi. Tous ont fini par s’y résoudre : le culte public de l’Église est suspendu. Comment ne pas penser qu’il y a là un message que Dieu nous adresse ? Comment ne pas souligner en plus que cette suspension du culte public de l’Église a lieu précisément en cette période liturgique-là : la célébration du mystère pascal ?
Lien permanent Catégories : Actualité, Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, liturgie, Santé, Spiritualité 2 commentaires -
Un cadeau pour Pâques : "Donner sa vie"
Pâques - Donner sa vieNuméro offert
vendredi 10 avril 2020
La rédaction de France Catholique est heureuse de vous offrir la lecture en ligne gratuite de ce numéro de Pâques !
-
Semaine Sainte en confinement; feuillet du Samedi Saint (11 avril 2020) : la foi dans l'oeuvre de Joseph Malègue
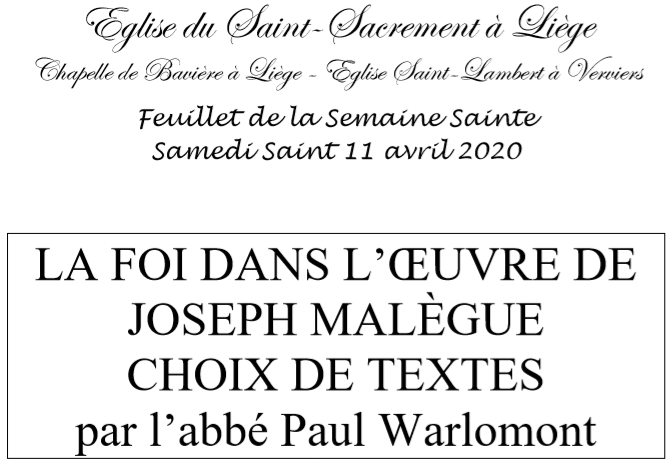 Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -
Le grand silence du Samedi Saint
Le grand silence de Dieu...(source)
Jour de passage entre le Vendredi Saint et le dimanche de Pâques, le Samedi Saint est célébré par l’Église comme le jour du silence de Dieu. Dieu est silence. Saint Jean de le Croix, le grand mystique espagnol, a contemplé dans le silence du carmel l’Amour silencieux de la Trinité : « Le Père n’a dit qu’une parole : son Fils. Il la dit toujours dans le silence, un silence sans fin. C’est dans le silence qu’elle peut être entendue. »
Par ailleurs, le silence du Samedi Saint nous renvoie à tous les moments tragiques de notre histoire où Dieu semble se taire dans un silence incompréhensible tandis que des cris jaillis de notre âme montent vers Celui qui peut nous sauver : silence de Dieu au cours des maladies, des accidents, des injustices et en dernier lieu de la mort.
La liturgie l’office des Lectures reprend en ce jour de deuil une homélie ancienne pour le grand et saint Samedi : « Aujourd’hui grand silence sur la terre ; grand silence et ensuite solitude parce que le Roi sommeille. »
La mort de Jésus de Nazareth, Roi des Juifs, comme l’indiquait sur le poteau de la croix l’écriteau rédigé par Pilate, est comparée au sommeil dans les profondeurs de la terre. Enseveli, le Fils de Dieu fait homme attend l’Esprit-Saint, Amour silencieux du Père et du Fils, que le Père va envoyer pour le relever de la mort au troisième Jour. En tant qu’homme, Jésus le Christ a attendu la résurrection comme les hommes croyants l’attendent au moment de leur décès. Jésus le Christ a attendu l’Esprit-Saint en mettant sa confiance dans le Père : « Père, en tes mains je remets mon esprit » (Lc 23,46).
Lors de la création du monde en six jours, Dieu s’était reposé le septième jour, origine du sabbat, jour de repos en Dieu et à l’exemple du Créateur. Le Samedi Saint, jour de repos, « tout est accompli » (Jn 19,30).
Dans les enfers
La liturgie du Samedi saint célèbre aussi la descente du Christ aux enfers : « Il est allé prêcher même aux esprits en prison » (Première épître de saint Pierre, 3,19). Dans le silence tragique de la mort de ce Samedi Saint, l’Église se réjouit déjà de la rencontre du Christ avec les captifs de la mort symbolisés par Adam et Ève. Une belle icône orientale offre à nos yeux ce grand mystère de la résurrection du Christ qui prend par la main Adam et Ève qui représentent tous les défunts qui ont attendu la venue du Messie, pour les relever des ténèbres et les placer à la droite de son Père. Jésus ne ressuscite pas seul.
Sur la terre
Alors que la dépouille mortelle de Jésus repose dans le tombeau offert par Joseph d’Arimathie, membre du Conseil, homme droit et juste, la Vierge Marie attend dans la foi la résurrection de son Fils.
Le Samedi Saint représente un passage difficile entre les ténèbres du Calvaire et la lumière de la Nuit pascale. La Vierge Marie veille en ce samedi méditant dans son cœur les paroles et les événements du fruit béni de ses entrailles, Jésus. C’est pourquoi la liturgie catholique aime à faire mémoire de la foi de la Vierge Marie précisément le samedi, jour de « passage », temps de l’attente dans l’espérance, afin d’inviter les chrétiens à imiter la foi de la Mère de Dieu, qui est aussi la foi de l’Église. Proche de nous, la Vierge Marie intercède pour les hommes dans les passages douloureux de leur existence.
Marie est aussi celle qui prépare les venues du Seigneur dans l’Évangile : Annonciation, Noël, Cana, Calvaire et Cénacle lors de la Pentecôte. Femme de désir, habitée par la Parole révélée à Israël, Marie vit tournée vers Dieu, disponible comme l’humble servante du Seigneur.
Aujourd’hui elle prépare par sa prière maternelle la venue du Christ glorieux à la fin des temps lors du Jugement dernier. Elle désire aussi que le Christ vienne maintenant inonder nos cœurs de la lumière de sa Résurrection.
Le Samedi Saint, les cloches des églises se taisent. Puissions-nous consacrer du temps à l’adoration silencieuse du Christ Jésus en méditant dans notre cœur l’Évangile à l’exemple de la Vierge Marie.
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, liturgie, Spiritualité 0 commentaire -
Célébrations et Ostension du Saint Suaire sur vos petits écrans ce Samedi Saint
Samedi Saint à 17h, ostension exceptionnelle du Suaire de Turin
« Samedi Saint, le Saint-Suaire sera exposé à la vénération des fidèles lors d’une prière en direct sur les réseaux sociaux et à la télévision » a annoncé Mgr Cesare Nosiglia, archevêque de Turin et évêque de Suse (Italie). Mgr Nosiglia, dirigera la liturgie dans la chapelle de la cathédrale où est conservée la précieuse relique pour demander la grâce de vaincre l'épidémie de Covid-19. Production CTV.
Samedi SaintLien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, liturgie, Médias, Spiritualité 0 commentaire