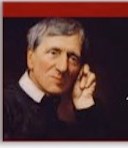De Religion en Libertad (José María Carrera) :
Les prêtres progressistes menacés d'extinction : "La jeune majorité se définit comme très orthodoxe", selon une étude

En ce qui concerne les fondements de l'Église, la polarisation croissante de ces dernières années semble suivre une tendance claire : alors que les prêtres qui se définissent comme théologiquement progressistes se rapprochent de la non-pertinence - numériquement parlant - la fidélité à la pureté doctrinale de l'Église semble être la priorité. nouveau cadre adopté par un clergé également plus jeune.
Ces derniers jours, Ruth Graham l'a rapporté dans le New York Times à travers une étude réalisée par l'Université catholique d'Amérique auprès de 3 500 prêtres aux États-Unis : alors que 80 % des personnes interrogées étaient ordonnées en 2020, ils admettent être théologiquement « conservateur /orthodoxe » ou « très conservateur/orthodoxe », pas un seul prêtre ordonné après l’année de la pandémie ne s’est défini comme « très progressiste ».
Le courant théologique semble aller de pair avec ses considérations politiques , puisque presque tous les ordonnés depuis 2020 se définissent comme « modérés ou conservateurs ». Quelque chose qui contraste avec les progressistes, ordonnés après les années 1960 et déjà âgés, dont la moitié se décrivent comme « politiquement libéraux » et une plus grande proportion « théologiquement progressiste ».
Le clergé progressiste, vers l’extinction
L'analyse du journaliste spécialisé dans l'information religieuse ne laisse aucun doute : "Dans un avenir proche, le prêtre catholique libéral pourrait disparaître aux Etats-Unis."
Ce n'est pas seulement elle qui le dit. Les catholiques considérés comme progressistes, comme l'ancien séminariste et chroniqueur du National Catholic Reporter Michael Sean Winters , confessent que "dans les églises, il y a moins de libéraux avec des familles nombreuses " et que les parents qui ont plus d'enfants ont tendance, en général, à se réjouir de l'apparition de nouvelles vocations. de vos familles.
Des études soutiennent la tendance. En novembre 2023, The Catholic Project a publié certains résultats de son étude nationale sur les prêtres catholiques , un vaste rapport dans lequel 10 000 prêtres ont répondu à des questions concernant la polarisation et la dynamique générationnelle.
L'étude, qui peut être consultée sur le portail The Catholic Project , conclut que dans le premier des aspects susmentionnés, les résultats ont montré « une division significative entre l'auto-identification politique et théologique des prêtres plus âgés et plus jeunes ».
"La proportion de nouveaux prêtres qui se considèrent comme politiquement 'libéraux' ou théologiquement 'progressistes' est en baisse constante et a désormais pratiquement disparu", note l'étude.
Une diminution qui s'explique principalement par les réponses sur l'affinité théologique, puisque lorsqu'on leur a demandé de positionner leurs points de vue sur des questions liées à la théologie et à la doctrine sur une échelle allant de « très progressiste » à « très orthodoxe », plus de la moitié d'entre eux Les ordonnés depuis 2010 ont été affectés à la matrice orthodoxe et aucun des personnes interrogées et ordonnées depuis 2020 ne s'est défini comme « très progressiste ».
Seulement 1% des nouveaux ordonnés se considèrent comme « très progressistes »
Bien que l'étude ait été confrontée à la difficulté relative - progressiste ou conservateur par rapport à quoi ou qui -, il a été démontré que la tendance politique comprend une grande proportion de « modérés », 52% des nouveaux ordonnés se considèrent comme « conservateurs » ou « très conservateurs ». » et 44 % de tous les paramètres sont définis comme « modérés ».