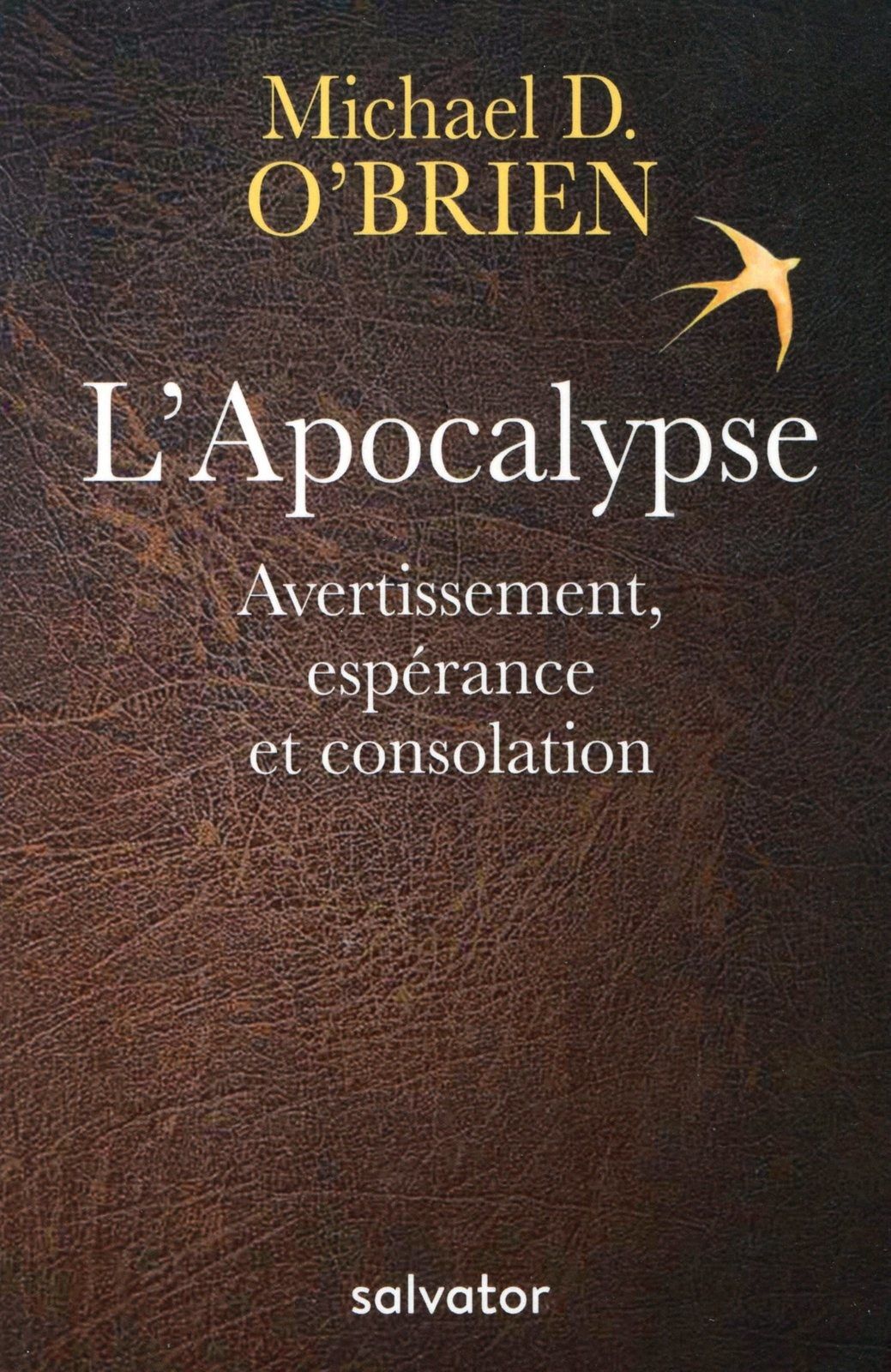D'Anne-Laure d'Artigues et Samuel Pruvot sur le site de l'hebdomadaire Famille Chrétienne (15 juillet) :
Exclusif. « L’abandon à la Providence m’a sauvée » confie la sœur de Vincent Lambert
Pour Famille Chrétienne, la sœur de Vincent Lambert, Anne Lambert, a accepté de revenir sur ses années de combat pour son frère et sur l’importance de la prière dans cette épreuve.
Quel est votre état d’esprit ?
J’ai une grande tristesse, comme une chape de plomb sur moi. Mais je suis aussi soulagée que Vincent ne soit plus entre les mains de son médecin…
Que retenez-vous des funérailles religieuses de votre frère ?
Nous avons été mis au courant de la date et du lieu des funérailles très tard. On supposait que tous les frères et sœurs seraient là, mais il n’y avait rien de sûr… En fait, on ne savait rien. Je me suis demandé si ceux qui habitaient loin pourraient être présents. Mais, sur les lieux, j’ai constaté que tous mes frères et sœurs étaient là, y compris ceux qui habitaient très loin.
▶︎ À LIRE AUSSI : « J’ai cinq Vincent Lambert dans mon service », témoigne le Dr Kiefer
Le fait que toute la famille soit réunie est-il un signe d’apaisement ?
La division est toujours là. Extérieurement, c’est vrai, nous étions tous là pour entourer Vincent. Mais cela n’était qu’extérieur. La division, je peux vous le dire, est toujours là et elle sera là encore longtemps... Le fait d’entourer Vincent, ces derniers jours avant son décès, aurait pu être l’occasion de renouer certains liens. Mais, c’était trop difficile pour nous, après ces six années de combat. Le jour des funérailles, il y avait clairement deux groupes distincts. On a bien vu que la famille restait divisée, même le jour de l’enterrement. Mais cela dit, il n’y a pas eu d’esclandres, pas de manifestations de colère excessive. C’était quand même « digne. »
Comment surmontez-vous ces années de combat et de procédures ?
Aujourd’hui, il y a les retombées psychologiques qui sont là. Nous garderons, je crois, des séquelles à vie. Ces six années ont été très longues, très dures, pour tout le monde. Dures pour nous, comme pour les autres. Le plus difficile fut de voir partir Vincent dans ces conditions. Cela a été inhumain. Les neuf jours qui ont précédé sa mort ont été très intenses. Nous avons donné à Vincent tout notre temps. Maintenant, la vie continue ; elle reprend son cours. Mais cela va être très difficile, c’est sûr. Notre entourage est là pour nous aider, notre famille aussi et nos enfants.
▶︎ À LIRE AUSSI : Mgr Matthieu Rougé : « Il ne faut pas tourner la page Vincent Lambert mais s’interroger sur le mystère de la vie et de la mort »
La foi a-t-elle été un secours pour vous ?
Oui, bien sûr, c’est tout à fait exact. La foi a été d’un grand soutien ces dernières semaines. Nous nous sommes sentis vraiment portés par des milliers de personnes. On sait que beaucoup de messes ont été dites pour Vincent avant son décès. Il y a eu un grand nombre de veillées de prières partout en France. Cela nous a beaucoup aidés au jour le jour. On se sentait soutenus, c’était presque quelque chose de physique ! On n’aurait pas pu supporter une telle situation sans la prière. Moi la première. Quand je me suis retrouvée seule, je me suis demandée comment j’allais faire pour supporter tout ça. J’ai douté de moi. Je me suis dit que je ne pourrai pas tenir le coup. En fait, on supporte l’épreuve grâce à notre foi personnelle, à notre prière. Il faut tout remettre entre les mains du bon Dieu. S’abandonner à la Providence : cela m’a sauvé. Il y a aussi la force de la prière des uns et des autres : nos amis, nos familles, la communion des saints.
On n’aurait pas pu supporter une telle situation sans la prière. Moi la première.
Redoutez-vous que la mort de votre frère soit instrumentalisée ?
Malheureusement, cela est déjà le cas. Vincent a été un bouc émissaire. Cela n’était pas du tout notre volonté. Dès le départ, nous n’avons jamais souhaité une telle médiatisation. J’insiste sur ce point. Mais, dans notre famille, il y en a toujours qui ont la tentation de courir après les micros pour déclarer des choses plus ou moins justes. Ce qui a été le plus indécent, c’était de déballer des choses ignobles quelques jours même avant le décès de Vincent. Et puis le jour même. Cela n’aurait jamais dû arriver. Malheureusement, les médias déforment beaucoup de choses. Mais je pense que les gens sont assez intelligents, ils ont assez de recul pour juger par eux-mêmes des événements et de l’histoire de notre famille.
Que souhaitez-vous dire à ceux qui vous ont soutenu ?
Je leur dis un immense merci, à chacun d’entre eux. Je ne dis pas seulement ma gratitude à un groupe de 300 000 personnes. Je le dis à chacun et chacune d’entre eux : les adultes, les enfants qui se sont associés à notre peine, tous ceux qui ont porté Vincent jusqu’au bout. Je leur dis ma grande reconnaissance. Je suis certaine que les grâces, en retour, retomberont sur eux. Je prierai pour eux mon chapelet aujourd’hui. Sans eux, on n’aurait pas tenu.
Anne-Laure d'Artigues et Samuel Pruvot