De Jean-Marie Guénois sur lefigaro.fr :
Le pape François s'apprête à statuer sur les apparitions de la vierge à Medjugorje
La commission qui a travaillé sur les apparitions de la vierge Marie à Medjugorje s'apprête à rendre ses conclusions.
Au cours de la conférence de presse donnée dans l'avion au retour de son voyage d'une journée à Sarajevo, le pape François a révélé que l'enquête lancée par Benoît XVI sur les phénomènes constatés dans cette localité de Bosnie-Herzégovine depuis 1981, avait rendu ses conclusions. Il lui appartenait donc de prendre une décision en tant que pape.
Jamais la décision sur Medjugorje n'a été aussi proche. Cette localité de Bosnie Herzégovine abrite un sanctuaire marial qui attire depuis 1981 des millions de visiteurs venus du monde entier le jour où des «voyants» ont affirmé y avoir «vu la vierge» certains assurant toujours recevoir des «messages» particuliers. Alors que Jean-Paul II, puis Benoît XVI avaient été saisis du dossier, le pape François en répondant à une question de journaliste dans l'avion qui le ramenait samedi soir de Sarajevo, a révélé que l'Eglise était sur le point «de prendre une décision» sur la nature de ces phénomènes.
Un dossier mûr pour une décision
Le pape a expliqué que la commission d'étude, composée de théologiens et de pasteurs, sous la responsabilité du cardinal Ruini - nommé par Benoît XVI - lui avait rendu ses conclusions après «un beau travail de trois ou quatre ans». Il a aussi dit que le cardinal Müller, préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, venait de consulter sa congrégation sur cette question et sur l'enquête menée par la commission. Et que le dossier était par conséquent mûr pour une décision.
Si cette décision était prochainement annoncée elle mettrait fin à une controverse complexe qui existe depuis les débuts des phénomènes. Le débat est d'abord théologique comme pour tout phénomène marial. Mais il est aussi ecclésial en raison d'une sourde concurrence entre le clergé diocésain local et l'ordre des franciscains très implanté dans cette région pour des raisons historiques mais aussi très impliqué à Medjugorje. La question est aussi personnelle, en raison de la personnalité des voyants et de leur premier guide spirituel, un franciscain qui a été depuis réduit à l'état laïc par l'Eglise. D'un autre point de vue, l'Eglise constate des «fruits» étonnants car de nombreuses conversions se dérouleraient en ce lieu.
Des pèlerinages officiels jusqu'ici interdits
Jean-Paul II comme Benoît XVI se sont toutefois toujours montrés très prudents sur Medjugorje, même si le pape polonais était réputé être personnellement attiré par ce sujet. Ils ont simplement accordé aux fidèles la possibilité de s'y rendre à titre privé mais ont interdit l'Eglise d'y organiser des pèlerinages officiels. Une attitude cohérente du reste, avec la lourde procédure habituelle de discernement menée par l'Eglise catholique sur ce genre de dossier. Rome se refuse en général de statuer avant la fin des phénomènes, lesquels dureraient encore pour certains «voyants» de Medjugorje, qui tous n'habitent plus sur place.
En marge de cette conférence de presse, le pape, 78 ans, fatigué par sa longue et dense journée de visite à Sarajevo mais faisant preuve d'une impressionnante vitalité, a confirmé qu'il tiendrait la promesse faite «aux évêques français d'aller en France» mais il n'a précisé aucune date.
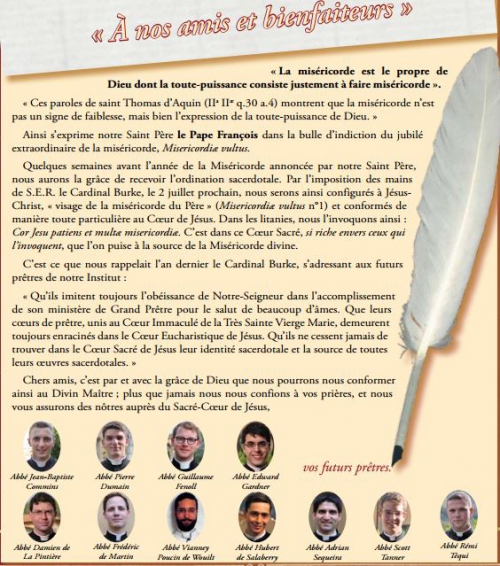
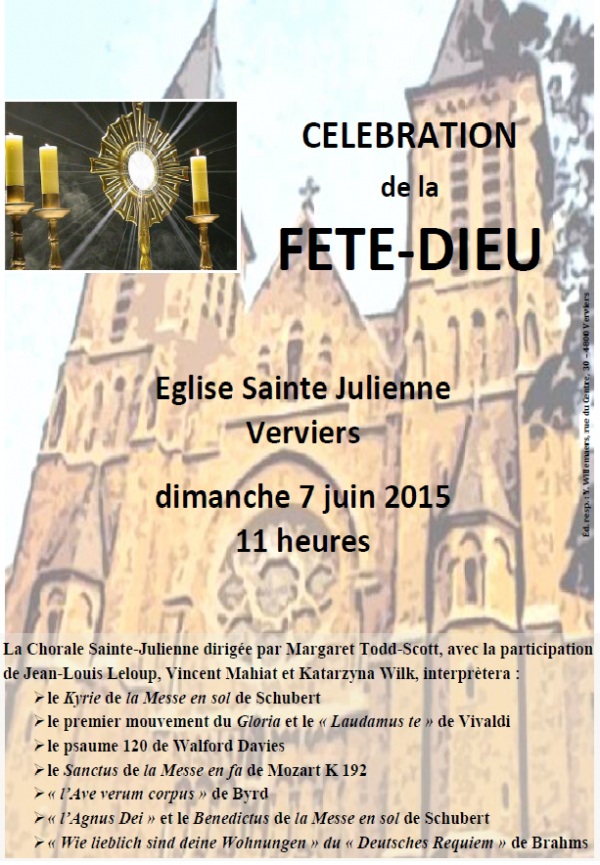

 "Cité du Vatican, 3 juin 2015 / (Actualités CNA/EWTN).
"Cité du Vatican, 3 juin 2015 / (Actualités CNA/EWTN).