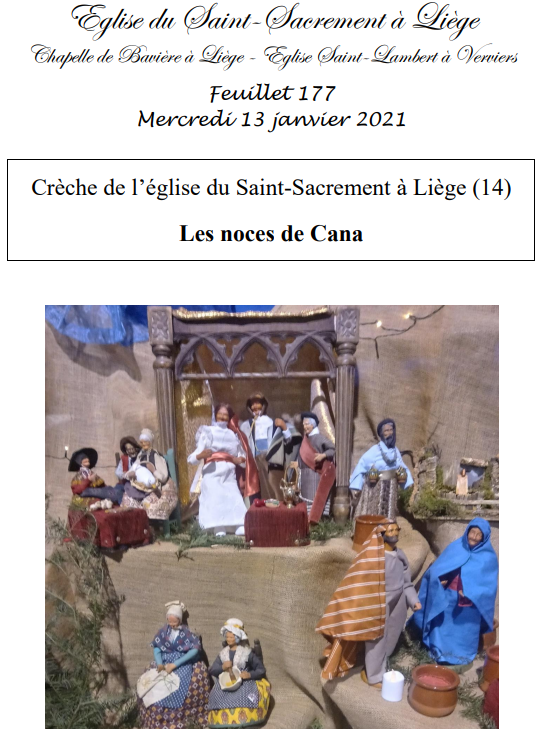Du site des Missions Etrangères de Paris :
Les autorités municipales de Pékin annoncent la fermeture de 155 lieux de culte
12/01/2021
Le 8 janvier au Bureau d’information de la municipalité de Pékin, les autorités municipales de la capitale ont annoncé la décision de fermer les 155 lieux de culte à Pékin, dans le but d’éviter la propagation de la pandémie. La nouvelle décision semble avoir été provoquée par une nouvelle vague de plus de 300 cas rapportés dans la province du Hebei, et notamment à Shijiazhuang, capitale de la province. Certaines publications anonymes sur les réseaux sociaux ont accusé les catholiques de répandre le virus. Dans un communiqué, l’Association patriotique des catholiques chinois de Shijiazhuang a dénoncé ces affirmations.
Les autorités municipales de Pékin ont décidé de fermer les 155 lieux de culte de la capitale chinoise afin d’éviter la propagation de la pandémie du Covid-19. La décision a été annoncée lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi 8 janvier au Bureau d’information de la municipalité de Pékin (Beijing Municipality’s Information Office). Les responsables du Bureau d’information, aux côtés du Bureau pour les Affaires religieuses et ethniques et du Front uni local, ont décidé que « dorénavant, tous les 155 lieux de culte de la ville seront fermés au monde extérieur et toutes les activités religieuses collectives seront suspendues ». Curieusement, le Bureau d’information a pourtant reconnu que « pour l’instant, il n’y a pas eu de nouvelles infections au coronavirus ou de suspicions de nouveaux cas parmi les 155 centres religieux de notre ville, et le but ‘zéro contagion’ a été atteint ». Les églises et les temples, tout comme les particuliers chinois, ont été sujets à un confinement radical depuis janvier 2020.
Ce n’est qu’en juillet dernier que les lieux de culte ont pu rouvrir, alors que les centres commerciaux, les boutiques, les marchés et les cinémas étaient déjà à nouveau ouverts depuis un moment. Et les lieux de culte ont pu rouvrir mais dans des conditions drastiques – nombre de paroissiens limités durant les célébrations publiques, avec le respect des distanciations physiques, des célébrations plus courtes, des prises de température à l’entrée des églises, etc. – afin d’éviter les risques d’infection. Le Bureau d’information de la municipalité de Pékin a également reconnu que « durant les fêtes religieuses importantes, comme la naissance du Bouddha, l’Eid-al-Fitr, Noël ou autres, les activités religieuses sont restées stables et ordonnées dans les divers lieux de culte ». D’autant plus que face aux conditions sanitaires drastiques et aux visites constantes de la police, beaucoup de prêtres ont choisi de garder les églises fermées, en choisissant de poursuivre les activités paroissiales en ligne. La nouvelle décision des autorités pékinoises semble avoir été provoquée par une nouvelle vague de plus de 300 cas de Covid-19, rapportée la semaine dernière dans la province de Hebei, et notamment à Shijiazhuang, capitale de la province.